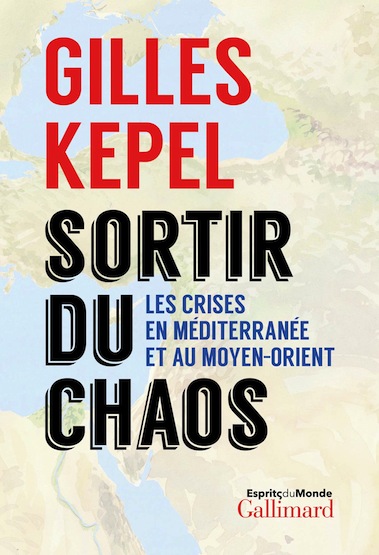
Le célèbre arabisant, Gilles Kepel, arpente inlassablement les territoires de l’islam dans tous les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient, depuis 1977, date de son séjour de formation à Damas. Dans son dernier livre, le plus complet et le plus achevé, il décrypte la situation de cette vaste zone, telle qu’elle s’est établie depuis la guerre d’octobre 1973 dite du Kippour ou du Ramadan.
En effet, après avoir traversé – par surprise – le canal de Suez et repris quelques arpents de désert aux Israéliens, l’Égypte d’Anouar el-Sadate a relevé le moral des Arabes et leur a redonné une plus grande maîtrise de leur destin. Car très vite pour endiguer la contre-offensive israélienne, les pays arabes producteurs de pétrole, réunis à Koweït, le 17 octobre 1973, ont décrété un embargo sélectif à l’encontre des alliés d’Israël. C’est de ce moment que date l’islamisation de la politique du Moyen-Orient. Les monarchies pétrolières de la péninsule Arabique, menées par l’Arabie saoudite, vont redoubler d’efforts pour saper l’idéologie du nationalisme arabe, symbolisé par le colonel Nasser qui n’avait pas hésité à incarcérer et exécuter les leaders des Frères musulmans.
Mais ce n’est qu’à partir de l’année 1979 qu’un véritable tournant s’est opéré avec la survenance de trois événements majeurs. L’arrivée, tout d’abord, au pouvoir, de l’ayatollah Khomeiny en Iran, qui instaura aussitôt une république islamique et fit de la divulgation de son idéologie dans les terres d’islam une obligation individuelle sacrée. Ce prosélytisme chiite, qui se heurta au traditionnel wahhabisme saoudien, sema les graines d’une discorde, la fitna, qui n’a fait que s’approfondir et s’exacerber avec le temps. Puis en novembre 1979 eut lieu la prise d’otages de la Grande Mosquée de La Mecque, par des Bédouins fustigeant le mode de vie « impie » des élites saoudiennes qui s’étaient livrées au « Grand Satan ». Après avoir repris les lieux grâce à l’aide du GIGN, le pouvoir saoudien institua un strict contrôle des mœurs et lâcha la bride à la puissante politique religieuse, politique sur laquelle entendait revenir précisément le prince héritier Mohammed ben Salmane. Enfin, après s’être fait ardemment prier, durant une année, le politburo soviétique décida d’intervenir en Afghanistan afin de sauver le régime communiste qui avait pris le pouvoir par la force en avril 1978. Cette intrusion massive, des « impies », ou infidèles (kouffar) marxistes, et matérialistes, en terre d’islam (Dar al-Islam) renforça considérablement le mouvement de résistance islamique, apparu dès l’été 1978.
La CIA et les monarchies du Golfe financèrent, armèrent, soutinrent le djihad international. Le Moyen-Orient structuré jusque-là essentiellement par le conflit israélo-arabe et la cause palestinienne trouva dans les terres afghanes une cause sacrée, et mobilisatrice. Les guerres s’enchaînèrent : Iran/Irak (1980-1988, première guerre du Golfe (1990-1991), provoquée par l’envahissement du Koweït, le 2 août par les armées de Saddam Hussein, qui s’était levé contre l’expansionnisme chiite et qui estimait n’avoir pas été payé suffisamment en retour. Elles furent à l’origine de l’apparition de la deuxième génération de djihadistes, celle d’Oussama ben Laden et de ses affidés, créateur d’Al-Qaïda, la « base ». Ces derniers, choqués par la présence massive, de troupes étrangères, américaines, surtout sur cette terre sacrée de l’islam qu’ils profanaient ouvertement dénoncèrent avec violence la trahison de la monarchie saoudienne qui s’était compromise avec les « mécréants, les juifs, les impérialistes… ».
Après un exil au Soudan et en Afghanistan, Oussama ben Laden, ayant fait de la lutte « contre l’ennemi lointain » son objectif, organisa les attentats du 11 septembre 2001, ouvrant par cet acte spectaculaire le troisième millénaire. Persuadé que le djihad, qui avait bouté les Soviétiques d’Afghanistan dont ils se retirèrent le 15 février 1989, viendrait également à bout de l’empire américain, il espérait un soulèvement massif des masses musulmanes… qui n’intervint jamais.
On connaît la suite : intervention des États-Unis et d’une vaste coalition internationale en Afghanistan le 7 octobre 2001, dont les premiers ne se retirèrent qu’en octobre 2011, faisant de ce confit la plus longue guerre de leur histoire. Puis seconde guerre du Golfe, menée en mars-avril 2003 par les faucons et néoconservateurs américains de l’équipe présidentielle de George Bush. Ces derniers étaient persuadés qu’en éliminant Saddam Hussein et son régime, ils parviendraient à instituer sur les bords du Tigre une démocratie, stable, dont l’exemple ne tarderait pas à rejaillir sur l’Iran voisin, alors que c’est l’inverse qui finit par se produire. Pire encore : de ce terreau irakien du fait de la « revanche » exercée par la majorité chiite qui s’était installée au pouvoir, naquit, par démembrement d’Al-Qaïda, ce qui allait constituer par la suite l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), puis Daech.
La troisième génération de djihadistes émergea à partir de 2005, démontre Georges Kepel, à force de pages et de commentaires des écrits des principaux dirigeants et penseurs de cette mouvance aux multiples ramifications. Cette génération, déjà identifiée par les arabisants, par les textes, n’a pas été suffisamment prise en compte, insiste-t-il, par la plupart des décideurs occidentaux, notamment lors du déclenchement de la guerre civile syrienne. Alors que Vladimir Poutine avant de s’y engager, le 30 septembre 2015, a été à l’écoute de l’école orientale russe, dont le représentant le plus éminent fut Evgueni Primakov, qui avait été envoyé par Gorbatchev à Bagdad, en janvier 1990, afin d’éviter la guerre, devenant sous Eltsine, ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Avant l’irruption de Daesh à partir de 2013, le califat fut proclamé, le 24 juin 2014, à partir du minaret d’al-Nouri, aujourd’hui détruit, intervinrent les « printemps arabes » que la plupart des analystes, si friands d’analogies historiques, ont comparé au « printemps des peuples ».
« C’est pareil que la chute du mur de Berlin, les Arabes sont entrés dans la démocratie », devint le cri de ralliement. En fait, lesdits printemps arabes, qui avaient été initiés par les jeunesses urbaines diplômées, frustrées par l’absence de perspectives, la montée des inégalités, le népotisme, ont été vite canalisées puis récupérées par les classes populaires pieuses, encadrées par les Frères musulmans, appuyés par Al Jazeera, le Qatar et la Turquie, dont l’opposition à l’hégémonie wahhabite n’était guère dissimulée. D’où cette fissure à l’intérieur du camp sunnite, sur laquelle s’étend l’auteur qui y consacre la troisième partie de son livre. Il replace un ensemble de faits récents et marquants dans ce contexte. Ostracisme contre le Qatar, qui semble avoir tourné court bien que Riyad veuille à tout prix empêcher la tenue de la coupe du monde de football en 2022 ; « révolution » du Ritz-Carlton à Riyad ; débâcle sunnite et cogestion du chiisme en Irak. C’est tout l’enjeu planétaire du conflit au Levant qu’il décrypte par la suite.
Maintenant que l’insurrection islamiste semble totalement défaite, en dehors de la poche d’Idleb, où se massent encore 70 000 combattants, parmi 3 millions d’habitants, quel avenir prévoit-il en Syrie et dans la région ? Il part du constat que, contrairement à l’Irak dont le chiisme offre une porosité à l’influence iranienne, que ce soit par la continuité territoriale ou la prééminence de Najaf et Kerbala comme Lieux saints pour les fidèles des deux côtés de la frontière, la minorité alaouite aux commandes en Syrie n’a qu’une relation distancée avec la doctrine et les croyances de l’islam duodécimain. La connexion entre le régime post-baathiste de Bachar el-Assad et la République islamiste est d’abord d’opportunité. Si l’on considère que les Kurdes, bien qu’ayant constitué le gros des forces terrestres combattant Daech, avec l’appui des États-Unis, demeurent l’ennemi principal d’Ankara, qui ne saurait tolérer la persistance d’une enclave kurde, le Rojava, à sa porte, quelle solution émergera en Syrie ?
S’agissant de l’Iran, il est difficile de prévoir l’avenir de la République islamique, à laquelle maints analystes attribuent la volonté de se maintenir durablement en Syrie et aussi près des frontières d’Israël afin d’être en mesure d’exercer sur lui des actions de représailles en cas de bombardement de son territoire par les États-Unis. L’engagement extérieur de l’Iran qui maintient sur le terrain 2 000 combattants de la force Al-Qods et assure le financement des 10 000 miliciens chiites de toutes obédiences auxquelles s’ajoute son soutien au Hezbollah et aux houthistes au Yémen serait évalué entre 6 et 15 milliards de dollars par an, somme gigantesque par rapport au coût estimé de l’intervention russe en Syrie estimée depuis 2015 à 4,5 milliards. Privé de son pactole pétrolier Téhéran sera-t-il acculé au retrait partiel de ses forces ou à la négociation, que lui a d’ailleurs proposé Donald Trump ?
L’alliance turco-russe en Syrie paraît instable et soumise à bien des aléas conjoncturels. Ne sous estime-t-il pas la force des liens qui unissent désormais les deux dirigeants et les deux pays. Un commerce bilatéral de 21,6 milliards de dollars en 2017, contre 2,5 milliards entre la Russie et Israël et de 1,7 milliard entre la Russie et l’Iran. La construction de la centrale atomique d’Akkuyu, dans la province de Mersin dans le Sud du pays, du gazoduc Turkish Stream, la livraison des S-400… Entre Moscou et Riyad, premiers exportateurs de pétrole du monde qui œuvrent conjointement à la stabilité du marché, une entente semble s’être réalisée sur l’avenir de la Syrie à condition que l’Iran en soit écarté. Quant à l’entente entre Israël et la Russie, qu’il qualifie d’étrange, on voit que pour le moment elle a résisté à l’incident de l’Il-20 qui a causé la mort de quinze militaires russes.
La défaite territoriale de Daech qui régna sur une bande de territoire de 700 à 800 km de large incluant 8 millions d’habitants, a achevé son effondrement moral. Les Frères musulmans ont subi une défaite historique après le renversement de Mohamed Morsi au Caire, le 3 juillet 2013. L’islamisme politique subit dans ses diverses variantes ainsi l’une des grandes épreuves de son histoire récente. A-t-il pour autant épuisé son modèle de mobilisation politique lorsque l’on observe la situation des masses paupérisées vivant dans des pays dévastés comme la Syrie, l’Irak, la Libye ou le Yémen. D’où l’urgence d’une reconstruction de ces pays, sans laquelle aucune stabilisation et un retour massif des réfugiés ne sera possible. Cela suppose qu’une solution politique soit trouvée, ce à quoi s’attellent Russie, Turquie, France et Allemagne, laissant pourtant de côté États-Unis et Grande-Bretagne, sans parler d’autres acteurs de poids, régionaux ou pas. La réinsertion vertueuse de toute la région, ravagée par plus d’un demi-siècle de conflits, de crises, et de soubresauts qu’a admirablement analysé Gilles Kepel, est à ce prix.






