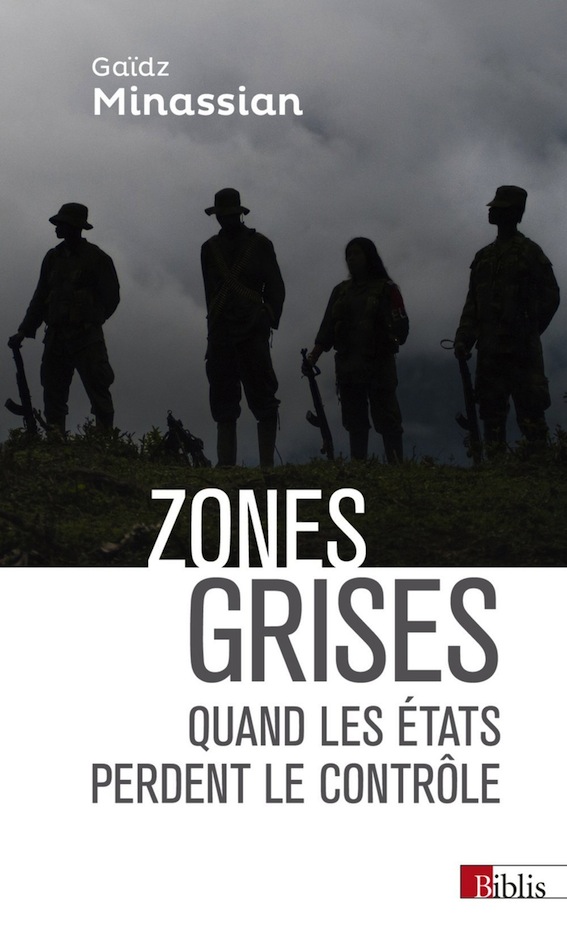
Ukraine, Ossétie du Sud, Gaza, trois guerres pour des zones grises, et rares ont été les observateurs à avoir remarqué que ces crises ont eu pour épicentre des zones grises. Si ces trois exemples sont les plus connus, bien d’autres zones grises se sont répandues sur notre hémisphère. En Amérique latine, voilà des décennies que des zones sont gangrenées par les gangs de la drogue qui se livrent à de sanglants affrontements pour le contrôle des territoires, de production et des axes d’acheminement de leurs psychotropes. Au Sahel, dans le Sahara, dans le Nord-Est du Nigeria, de telles zones couvrent de larges espaces.
Gaïdz Minassian, enseignant à Sciences Po Paris, dresse un état des lieux complet de ce phénomène que le droit international ne prend pas en compte. L’organisation interétatique a-t-elle atteint ses limites ? Car à l’heure de la mondialisation de telles zones ont tendance à proliférer. Elles sont de nature fort diverses, économie souterraine, séparatismes, terrorisme, criminalité organisée, rongent les fondations des États, affaiblis par la globalisation des échanges, et la dérégulation de la vie économique, dont savent fort bien s’accommoder les réseaux illégaux.
Mais qu’est-ce qu’une zone grise, dont la sociologie et la science politique n’ont intégré dans leur vocabulaire que depuis la fin des années 1980. On a parlé de « non-pénétration du centre dans la périphérie ». L’État westphalien aurait perdu le monopole de l’architecte de l’ordre mondial et l’on a eu tendance à utiliser à satiété l’expression de zones grises pour qualifier pratiquement l’ensemble des conflits intraétatiques : Abkhazie, Haut-Karabagh, Gaza, Darfour, Somalie, Afrique sahélienne, vallée de la Ferghana en Asie centrale, Afghanistan, Triangle d’Or, Cachemire, Waziristan, vallée du Swat, Transnistrie, plaine de la Bekaa, au Liban, zones sous contrôle des Farc en Colombie. On a même parlé de zones grises, pour les territoires contrôlés par Daech en Irak et en Syrie. Or, le Califat, proclamé en juillet 2014, entre dans la catégorie des sociétés guerrières et a été, un laps de temps, un « pseudo État ».
Une société guerrière est un espace social qui vit par la guerre et pour la guerre, pour détruire tout ou partie de l’ordre mondial, contrairement à la zone grise qui s’accommode parfaitement de l’existence des États, pourvu que ceux-ci lui laissent la paix et permettent à ses acteurs de continuer à faire leurs affaires. La zone grise comprend pourtant des espaces non militarisés tout aussi préoccupants pour la paix sociale, comme les périphéries des mégapoles, comme Lagos, Mexico, Karachi, Rio de Janeiro, ou les agglomérations précarisées en France au cœur des zones urbaines sensibles, notamment dans le département francilien de la Seine-Saint-Denis appelé le 9-3. D’où la définition qu’en donne l’auteur qu’il convient de citer en entier tant elle est éclairante. « Une zone grise est un espace de dérégulation sociale, de nature politique (autodétermination, séparatisme, ou sanctuarisation) ou socio-économique (espaces de criminalité, espaces déshumanisés, espaces désocialisés) de taille variable – de la poche à la province essentiellement terrestre, parfois maritime, dépendant d’un État souverain dont les instances centrales ne parviennent pas – par impuissance ou par abandon – à y pénétrer pour affirmer leur domination, laquelle est exercée par des autorités alternatives. Ces entités rivales et non reconnues instaurent un ordre de substitution plus ou moins violent, structuré, achevé et accepté par les populations qui s’y trouvent, avec une volonté de privatiser le territoire sous contrôle en vue de se séparer de l’État de tutelle pour en construire un autre ou de le rançonner pour jouir de ses richesses matérielles sans pour autant le désintégrer ».
Cette définition permet à l’auteur de dégager une gamme de zones grises à partir de deux sous-ensembles, l’un statocentré, l’autre socioéconomique, qui peuvent parfois se recouper. Le premier se fonde sur la guerre, la violence politique, la contestation. Soit il s’agit de désintégrer l’État dont on ne reconnaît plus l’autorité, soit il s’agit de renverser le régime sans casser l’assiette de l’État. Ce sous-ensemble se divise en quatre cas : la zone grise de type guérilla (Colombie, Tchétchénie), la zone grise de type terroriste (Pakistan, Sahel, Gaza, Tchétchénie), la zone grise de type maritime (côte de la Somalie, mer de Chine) et la zone grise de type proto-État (Haut-Karabagh, Transnistrie, Gaza). Le second sous-ensemble de zones grises s’appuie sur la criminalité organisée et son capitalisme aventurier, selon l’expression de Max Weber, des considérations socio-économiques ou l’appât du gain règne en maître sans que soit remise en question l’intégrité de l’État, puisqu’il faut le saigner et non l’abattre. Quatre exemples : la zone grise aux mains des mafias (Italie, Albanie, Triangle d’Or, etc.), la zone grise aux mains de gangs violents issus des pays riches (États-Unis, Mexique, etc.), la zone grise propre à ces poches violentes dans certaines banlieues à risque en France et enfin la zone grise au milieu des bidonvilles ou « jungles de béton » des mégapoles du tiers-monde (Rio de Janeiro, Karachi).
La zone grise dérègle l’organisation du monde, contrarie son processus de construction et désarticule le système international tel un virus attaquant un réseau informatique. C’est le grand mérite de Gaïdz Minassian que de nous avoir livré une analyse aussi complète, articulée d’un phénomène longtemps ignoré ou considéré comme marginal ou périphérique ; or il tend par son caractère disruptif à occuper une bonne partie de l’agenda stratégique international. Pour le moment, la communauté internationale a répondu à la menace des zones grises, par ce que Bertrand Badie, a appelé les 3C : contenir, combattre, complaire. Avant que de pouvoir intégrer ces zones dans la mondialisation et la civilisation, il convient de les contenir en tant que moindre mal. Plus il s’est agi de les éradiquer, ce qui a été poursuivi après le 11 septembre, lorsque les néoconservateurs américains ont proclamé la guerre contre la terreur, mais leur action ne s’est déployée que dans un espace relativement restreint – Afghanistan et zones tribales pakistanaises, avec des résultats, somme toute peu probants. Complaire consiste, enfin après les échecs de deux approches précédentes, de tolérer un petit pourcentage de zones grises sur les territoires administrés par les États en prenant le risque qu’elles s’étendent.
S’appuyant sur de nombreuses études de cas qu’il a développé dans son livre (zones grises mouvantes des Farc, Haut-Karabagh, proto-État de moins en moins gris, Somalie, un État gris convoité, Gaza, une zone grise verte ? Zone grise en mers de Chine, le Pakistan, un État, deux systèmes), Gaïdz Minassian définit quelques principes prometteurs visant à traiter ce phénomène qui gagneraient à être mis en œuvre. Un principe d’harmonisation : il revient au système international d’accompagner le phénomène de zone grise au lieu de le rejeter, de le marginaliser, et le cas échéant, de le combattre. L’accompagner signifie d’abord le comprendre de l’intérieur puis, dans un effort collectif, évaluer les ressources et les ressorts promoteurs que renferment ces espaces de dérégulation. Un principe d’inclusion : il revient aux décideurs de faire preuve d’une compréhension fine, nuancée et inclusive des questions d’identité, en acceptant l’Autre tel qu’il est et non pas tel que les Nations dominantes voudraient qu’il soit. Enfin un principe de régulation : les États seraient bien avisés d’apprendre que la déréglementation autoritaire du haut vers le bas de la hiérarchie sociale ne fonctionne plus, pour peu qu’elle ait un jour fonctionné ; et que la réglementation doit désormais céder sa place à une régulation. Il serait en effet beaucoup plus pertinent, avant de produire un texte de loi, d’analyser les capacités de résistance des différents groupes sociaux qui y seraient hostiles pour faire en sorte que ce texte soit appliqué par ces mêmes groupes sociaux.
Donnons-lui la parole pour conclure tant il est vrai que ses paroles apparaissent prémonitoires : « La corde sociale qui dans un jeu dangereux sépare les appareils d’État des populations résistantes peut à tout moment rompre, disséminant à travers nos sociétés des zones grises à retardement, prêtes à exploser à la face du monde, à la moindre secousse globale (famine, pauvreté, dérèglements climatiques). Il n’existe cependant pas de fatalisme chaotique, pour peu que l’on parvienne à rééquilibrer les rapports entre l’État et la société en substituant au prisme international un prisme intersocial – à savoir une intégration d’acteurs non étatiques dans les processus de décision, une politique de responsabilisation des groupes concernés, une réappropriation de la sécurité par les sociétés au service des populations et non des appareils d’État, et une réelle adaptation de l’État à la mondialisation. Bref, de quoi jeter les fondations d’un nouveau contrat social, local, puis global et, pourquoi pas, d’une déclaration universelle des droits des sociétés civiles. » Nul doute que l’étude, par maints côtés pionnière de Gaïdz Minassian, sera examinée avec attention par une série d’acteurs concernés par cette réalité, avec laquelle la société des nations devra vivre de longues décennies et de s’efforcer d’y apporter des réponses efficaces.






