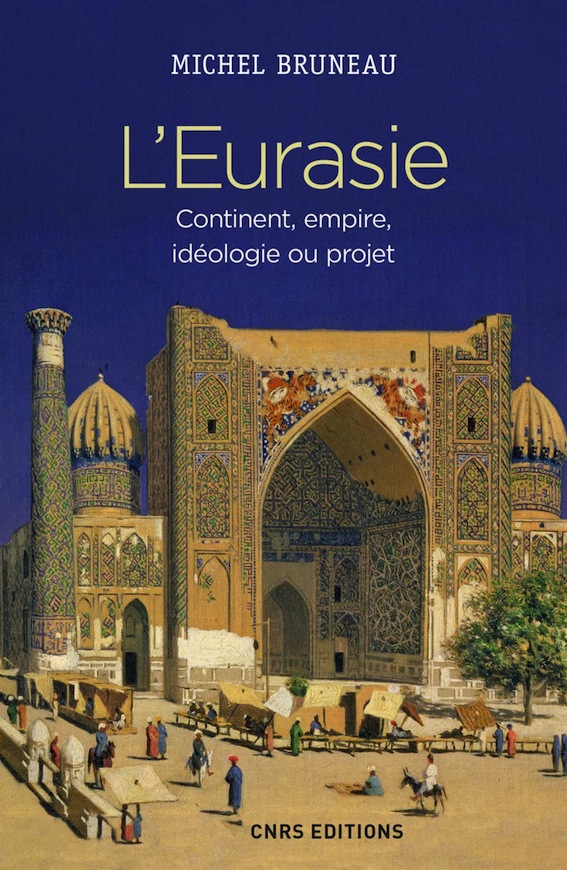
L’Eurasie, ensemble territorial le plus vaste du monde s’étendant sur 54 millions de km², rassemblant 4,5 milliards d’habitants, a été pendant des siècles un espace continental de manœuvres, d’invasions et de conquêtes aux mains des populations nomades qualifiées de barbares par les populations sédentaires environnantes. Son étirement sur plus de 11 000 km de plaines et de plateaux steppiques, sans obstacles majeurs, mais uniquement le long de la vaste plaine allant de la mer du Nord à celle de Sibérie orientale a conféré une importance accrue au rôle structurant de la circulation au sens large : transports, mobilités, migrations, connexions de toutes sortes d’une extrémité à l’autre de l’Europe que Paul Valéry avait qualifié de cap extrême de l’Asie.
C’est d’ailleurs cette liaison entre les deux extrémités, les plus peuplées, celle de l’Europe méditerranéenne et occidentale, reliée au Moyen-Orient, un des grands berceaux des civilisations, des empires, des religions, et celle du monde chinois assuré par l’ancienne route de la Soie, qui a donné à l’Eurasie son sens et sa consistance. On le retrouve aujourd’hui avec l’ambitieux projet de Xi Jiping, des nouvelles routes de la Soie (OBOR, One Belt, One Road), rebaptisé RBI (Road and Belt Initiative). Durant des siècles, cet espace fut le domaine d’excellence des cavaliers-archers, lesquels jusqu’au XVIe siècle ont su dominer leurs adversaires par leur soudaineté, leur mobilité et leur dextérité.
L’Eurasie a été le domaine des grands empires, que décrit savamment Michel Bruneau, géographe, spécialiste de géohistoire, directeur de recherche émérite au CNRS, il est notamment l’auteur de Diasporas et espaces transnationaux (2004), L’Asie d’entre Inde et Chine (2006) et De l’Asie Mineure à la Turquie (2015). Puis à partir du XVIe siècle, le courant s’est inversé : c’est d’Ouest en Est que s’est effectué le mouvement de colonisation d’origine européenne. Il s’est fait par voie de terre, par la conquête de la Sibérie, Sibir, qui amena vite la Moscovie sur les rives du Pacifique. Mais pour les puissances maritimes coloniales, ce fut un espace de contournement par le Sud, la voie maritime autour de l’Afrique d’abord, puis par Suez ensuite qu’ils empruntèrent successivement (Portugais, Hollandais, Britanniques, Français) pour se forger de vastes empires coloniaux de l’Atlantique au Pacifique, de la Méditerranée aux mers du Japon, de Chine, à travers les détroits de l’archipel indonésien (Malacca, de la Sonde, Lombok) et isthmes. D’intrépides marins, des aventuriers, suivis par les commerçants et les missionnaires ont construit la route des épices, celle qui est aujourd’hui rebaptisée par la Chine « collier de perles ». La voie continentale (« Routes de la Soie ») et la voie maritime (« Routes des Épices ») en tant qu’axes majeurs de communication ont alterné dans l’histoire, ont été concomitantes, complémentaires, mais la seconde a tendu à prévaloir sur l’autre d’un point de vue commercial et militaire.
Aujourd’hui, ce qui redonne à ce vaste ensemble géopolitique toute son unité et sa cohérence, c’est que la Chine y ajoute résolument la voie maritime du Nord, reliant la Scandinavie à l’Extrême-Orient, via le détroit de Behring découvert, à la demande de Pierre le Grand, en 1727 par le danois Virtus Behring, un des « choke points » appelé dans les décennies à venir à être un des épicentres du commerce mondial. Aux côtés du projet chinois, figure, de moindre ampleur, le projet russe d’Union économique eurasiatique (UEEA), lancé en 2011, ne regroupant qu’un nombre restreint d’États (Russie, Belarus, Kazakhstan, Tadjikistan et Kirghizstan) auxquels l’Arménie s’est associée. En mai 2015 les Présidents russe et chinois ont décidé de connecter les deux projets.
D’où la question que pose Michel Bruneau en faisant œuvre d’historien, de géographe, d’anthropologue, d’expert des questions culturelles et des civilisations, d’économiste parfois, en définitive de géopolitologue dans le plein sens du terme. L’Eurasie n’est-elle qu’un espace géographique, autre que purement nominal, autre qu’un simple méga continent, le plus vaste du monde ? Jusqu’à présent le regard du chercheur, du diplomate, du stratège ou du soldat, de l’homme d’affaires n’a porté par nécessité que sur des aires restreintes de ce très vaste espace : Europe, Proche et Moyen-Orient, sous-continent indien, Asie du Sud-Est, Extrême-Orient, Japon. Mais il est légitime de dépasser ces approches régionales qui gardent toute leur valeur en se demandant comment il s’est structuré, dans la longue durée et pourquoi il est en passe d’acquérir une plus grande réalité, surtout à la lumière, phénomène qu’a à peine effleuré, faute de recul, du retrait américain de la région du Moyen-Orient (Syrie, Afghanistan). Le grand géographe Élisée Reclus (1894) a montré que cet immense espace a été, pendant plus d’un millénaire de notre ère, coupé en deux parties, qui sans s’ignorer totalement, communiquaient très peu, de part et d’autre des hautes terres et des déserts de l’Asie centrale bercés sur le rythme des pas du chameau de Bactriane chanté par Borodine : Dans les steppes de l’Asie centrale.
Le terme « Eurasie » n’est entré que tardivement dans le vocabulaire géographique ou géopolitique. Apparu d’abord pour désigner les enfants métis des administratifs britanniques mariés à des indiennes, le terme eurasien a été repris plus tard en 1919-1920 par Halford J. Mackinder dans son article séminal, peut-être le plus célèbre de la géopolitique, où en 1907, dans le cadre du Grand Jeu qui opposait Empire russe et Empire britannique, il définissait le Heartland comme « pivot géographique de l’histoire », sorte de centre géographique de l’histoire se situant en Asie centrale et dans une zone à cheval entre la Russie et la Sibérie. C’était en réalité prendre compte de l’importance acquise par le Transsibérien et un avertissement lancé aux stratèges britanniques : vous ne pourrez répondre aux défis de l’empire russe qu’au moyen de la seule force navale. L’excès de la population rurale en provenance de la partie européenne de l’Empire russe a permis de peupler ces immensités sibériennes, vides d’hommes, peu organisées, où se trouvaient des collectivités n’ayant pas connu d’États, dispersées sur de longues distances et subissant les rigueurs d’un climat. Mais ce n’est qu’à la faveur du Transsibérien, dont la construction a commencé en 1881 et fut achevée qu’en 1913, que le pouvoir a pu assurer le contrôle de ses territoires en y acheminant troupes, administrateurs, forçats et pionniers. Transsibérien qu’Élisée Reclus avait dénommé fort justement la « ligne de chemin de fer eurasiatique ». Les eurasiates russes, émigrés des années 1920, ont plutôt désigné l’Eurasie comme l’Empire russe, puis, l’URSS, un ensemble unique, le seul qui a su réaliser la synthèse de Byzance (Moscou, troisième Rome), de l’Empire mongol dont il a assumé l’héritage et capté certains traits (autocratie), le seul qui aussi a réalisé l’union de la forêt (d’où seront issues les tribus slaves à partir du VIe siècle de notre ère) et les steppes, dominées durant quatre siècles par les Tataro-Mongols.
Ainsi l’empire russe est devenu, au regard de la profondeur historique, le plus grand après celui des Mongols, et surtout le plus durable car il s’est étiré en fait sur cinq siècles et non sur deux comme son prédécesseur. S’il a duré aussi longtemps c’est qu’il disposait d’instruments de pouvoir s’appuyant sur l’autocratie, sur son armée, composée surtout de Cosaques, héritiers de l’art militaire des intrépides et audacieux cavaliers-archers, sur une Église orthodoxe, toujours proche et dévouée à la cause impériale. Les Mongols, n’ont pas disposé d’une structure religieuse unique, politiquement comparable, ayant oscillé entre le chamanisme, le bouddhisme, le christianisme nestorien et l’islam sans choisir l’une ou l’autre confession comme clef de voûte de leur construction impériale. L’importance de disposer ainsi d’un ciment idéologico-religieux, comme d’une armature appuyant le pouvoir civil, s’est bien vérifié par la suite, car au-delà de l’habileté politique de la politique nationalitée mise en place par Staline, c’est bien l’idéologie marxiste-léniniste, la construction du socialisme, la création d’un homme niveau, avant d’en venir à la Glorieuse guerre patriotique, qui a servi de liant, de stimulant et de guide à tous ces groupes ethniques, qui ont composé l’URSS. Autre grande différence : les Mongols n’ont pas disposé d’une langue forte, base culturelle indispensable, telle que le chinois et le russe mais durent emprunter d’autres langues comme le turc, le persan, ou le chinois dans leurs divers États. Enfin les règles successorales de partager entre les fils du souverain mongol ont fragilisé l’empire alors que les Russes ont disposé dans la durée d’un pouvoir dynastique fort.
Ainsi les espaces russes sont très largement eurasiatiques et il n’est pas étonnant qu’à deux reprises dans les années 1920 et dans les années 1990, l’idéologie eurasiatique ait resurgi avec force au point d’avoir été adoptée largement par Vladimir Poutine et ses plus proches conseillers. En tout cas, la Russie-URSS est le seul État impérial qui ait réussi à intégrer dans une même nation des composantes démographiques slaves-européennes et turco-mongoles, sa société de caractère eurasiate a été la plus durable sur le continent. L’Empire ottoman a été également un grand empire eurasiatique, qui a débordé largement sur les Balkans menaçant l’Europe centrale et danubienne. On peut aujourd’hui clairement le revoir aux vues de ses ambitions néoimpériales au Moyen-Orient.
Contrairement à l’idéologie eurasiatique russe, la pensée turque ne semble pas avoir élaboré une vision nouvelle ou originale se démarquant de la précédente. La Turquie se fonde sur la turcophonie, la synthèse turco-mongole et l’héritage d’un Empire qui s’étend sur les deux continents. Après des tentatives opérées après la chute de l’URSS, en Asie centrale, dont tous les pays en dehors du Tadjikistan sont de langue turcique, ne parvenant pas à ses fins, notamment en n’étant pas parvenu à exporter son système linguistique, Ankara, a réduit, pour le moment, ses ambitions. Mais il est fort probable qu’à la faveur du rapprochement actuel qu’elle a effectué avec la Russie à propos de la Syrie, qui n’apparaît pas de circonstance, la Turquie se révélera plus ambitieuse. Bien d’autres pays se considèrent comme pleinement eurasiatiques, au premier chef le Kazakhstan qui avait une population d’origine russe s’élevant à 37 % (réduite à 20 % aujourd’hui) qui, à l’intersection de l’Europe et de l’Asie, du Nord et du Sud, se veut un carrefour des cultures et des religions, et prône un dialogue et un avenir partagé, ligne appréciée qui lui a valu d’être le premier pays de l’ex-URSS à présider l’OSCE.
Voilà donc l’Eurasie, devenue un réel objet géopolitique. Sans reprendre la vision simplifiée d’une compétition mettant aux prises l’île (l’Amérique) au continent mondial, force est de constater que c’est aux extrémités maritimes de ce dernier (mer de Chine méridionale et orientale, Taïwan) ou ses péninsules ou archipels que s’aiguisera le duel sino-américain.






