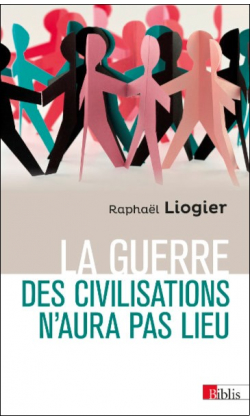
C’est en 1957, que le futur orientaliste de renom Bernard Lewis, au lendemain de la crise de Suez, qui marqua l’éclipse de l’Europe, employa le terme de choc des civilisations, concept, qui connut sous la plume de Samuel Huntington la diffusion mondiale que l’on sait.
Entre les puissances européennes coloniales et le jeune nationalisme arabe, symbolisé par Nasser, ce fut bien un choc de représentations qui s’est juxtaposé à la lutte traditionnelle pour l’influence et le pouvoir. Aujourd’hui qu’en est-il, alors qu’au-delà des différentes civilisations, cultures ou identités nationales, une civilisation mondiale semble peu à peu émerger.
Dans tous les coins de la planète on consomme les mêmes produits, on utilise les mêmes smartphones, ordinateurs, on regarde dans les mêmes téléviseurs, on se divertit à peu près des mêmes films, on s’habille de manière assez identique et l’on est plongé chaque seconde dans le grand bain informationnel. Au même titre que la nostalgie des traditions perdues, qui s’exprimait déjà chez Jean Jacques Rousseau, le fondamentalisme religieux ou non, est une réaction de ceux qui sont écrasés par la mondialisation. La société s’enferme dans une véritable mise en scène collective avec quatre acteurs principaux : le peuple trompé, le héros qui parle en son nom (journaliste, homme politique, simple citoyen), l’ennemi qui menace l’identité du peuple, par excellence le musulman et son allié (« l’idiot utile », le multiculturaliste, le bobo).
Pour Raphaël Liogier, professeur à Sciences Po d’Aix-en-Provence et qui enseigne à Paris au Collège international de philosophie, aucun doute : tous les fondamentalistes sont partisans de la thèse du choc des civilisations. C’est parce que l’Europe est devenue fondamentaliste – en quête d’un fondement perdu qui serait attaqué par le reste du monde – que l’adhésion à la thèse y est plus forte qu’ailleurs. Pourtant, montre-t-il, contrairement aux apparences, le religieux est de moins en moins un facteur d’opposition des valeurs, même s’il peut être l’objet volatil de revendications extrêmes. Car il existe aujourd’hui trois polarités religieuses, le spiritualisme, le charismatisme et le fondamentalisme. Le charismatisme, qui met l’accent sur l’émotion collective, est répandu en Amérique latine. On le retrouve à la fois dans le protestantisme, mais aussi dans le bouddhisme (la Söka Gakkai), ou même dans l’islam (en Égypte il y a des télécoranistes qui ressemblent sur certains points à des pasteurs évangélistes américains). La polarité spiritualiste traverse également les différentes confessions religieuses : un néo soufi musulman sera plus proche d’un bouddhisme occidentalisé que d’un musulman salafiste (polarité fondamentaliste).
Ce qui a changé par rapport aux grands courants du XXe siècle c’est que les identités se construisent et peuvent se déconstruire quasi immédiatement et simultanément sur les réseaux sociaux. Ces espaces de désir collectif sans territoire créent des phénomènes d’attraction planétaire mais ils créent surtout un marché global de la terreur avec des entreprises terroristes. Cela crée un effet de vitrine global alors que cela ne mobilise qu’une très infime partie des fidèles de toutes obédiences. Aussi l’auteur nous incite à nous délester de la tentation, si forte, de penser en termes de choc de civilisation tout en ne prenant plus en compte les seules relations entre États. Il lui paraît urgent de penser la perméabilité des frontières, de faire disparaître la figure de l’Autre radical, l’étranger, le barbare qui se situe au-delà de notre horizon existentiel, séparé de notre espace de vie. En fait aucun Autre, n’est complètement autre. C’est parce que la civilisation « occidentale » s’est voulue universelle qu’elle a fédéré contre elle toutes les autres. Mais maintenant que l’on assiste à l’émergence d’une sorte de méta civilisation mondiale, certes, loin d’être répandue ou partagée et que l’on assiste à la vigoureuse promotion des valeurs asiatiques, le choc simpliste de civilisation contre civilisation perd de sa consistance.
Certes cette mutation est loin d’être achevée et prendra des décennies pour atteindre ses pleins effets. En attendant, le djihadisme a de beaux jours devant lui car il recourt à une gamme de moyens et recourt à différents ressorts d’ordre émotionnel. Idéologie antioccidentale, anticapitaliste, antiaméricaine, il se répand dans les réseaux sociaux et répond à un sentiment collectif d’insécurité. Il contribue à la dissémination planétaire de la frustration des peuples. Le spectacle planétaire de la cruauté réunit bien de spectateurs. Ce phénomène, est qualifié par l’auteur d’individualo-globalisme, il ne s’agit plus donc d’un affrontement collectif, territorial mais d’un réseau hors sol qui diffuse une religiosité apparente, mais fait appel aux réactions primaires des individus.
Il résulte de cet ouvrage, parfois difficile, mais toujours stimulant, une image de miroir brisé. Il ne met plus en scène des catégories globales auxquelles nous sommes tant habitués : Occident, Europe, colonialisme, capitalisme, socialisme, Nord, Sud, islam, guerres, mais déconstruit ces entités pour les disperser dans le temps et dans l’espace. Il nous force à mieux penser, l’Autre, l’altérité, expérience difficile mais qui doit apporter ses fruits. Préconise-t-il, quelque remède salutaire à notre désarroi provisoire ? Il ne le semble pas, car nous enjoindre de sortir du Moyen Âge du XXIe siècle relève de la rhétorique et prôner un Parlement universel relève de la simple utopie, sinon de la chimère, aussi loin que l’on peut porter son regard. Non seulement un État universel, n’est pas possible, il est tout simplement dangereux, car il allongera considérablement la distance, entre le haut et ceux d’en bas, qu’il s’agit précisément de réduire.






