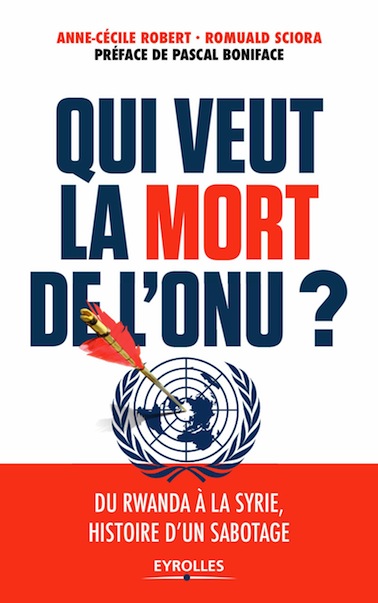
Il ne convient pas de prendre au pied de la lettre le titre de cet ouvrage écrit par deux journalistes. La première française, membre du comité de rédaction et du directoire du Monde diplomatique, le second franco-américain, auteur de plusieurs ouvrages co-édités sur les Nations unies et qui a interviewé à plusieurs reprises les cinq derniers Secrétaires généraux.
En effet, il est peu probable qu’on ait affaire à une action concertée, de longue haleine, visant à saper la légitimité de l’ONU et de l’ensemble des organisations de son système et les vider de tout leur contenu. Certes, Donald Trump représente un réel danger pour le multilatéralisme. Sous sa houlette, les États-Unis se sont déjà retirés de l’UNESCO, du Conseil des droits de l’homme, ne financent plus l’UNWRA (United Nations Relief and Works Agency), l’agence établie en 1948 pour venir en aide aux réfugiés palestiniens.
Washington ne fait pas grand cas de l’OMC, dont elle bloque le fonctionnement de son organe central, l’Office de règlement des différends. En gelant la nomination de ses juges, il n’en subsiste plus que trois sur sept, à ce rythme un seul restera en poste en 2019 ! De plus les États-Unis qui n’ont jamais fait grand cas de la Cour pénale internationale, dont ils n’ont pas ratifié les statuts, redoublent de critiques à son égard. De même en dénonçant, le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), en date symbolique du 8 mai, Donald Trump remet en cause l’expertise et l’action de l’AIEA, créée en 1957, comme symbole de la volonté des deux Grands, d’agir en commun dans le domaine stratégique de l’énergie nucléaire.
Pourtant les États-Unis n’hésitent pas à utiliser la tribune du Conseil de sécurité, et ne touchent guère à ce que l’on dénomme les IFI, institutions financières internationales, Fonds monétaire international (FMI) où ils disposent d’un droit de blocage et Banque mondiale, (BIRD) dont ils assument la présidence depuis 1946. Il n’en demeure pas moins que l’ONU – ou plutôt ses États-membres, mais c’est la première qu’on a coutume d’incriminer – n’a pas su créer un véritable système de sécurité collective, alors que c’est la réalisation de cet objectif suprême qui fut à l’origine de la Charte de San Francisco de juin 1945.
Après 1990, lors de la fin de la guerre froide et l’effondrement de l’URSS, l’espoir d’un nouvel ordre mondial, garant de la paix, de la coopération et du développement s’est vite dissipé. Les auteurs s’étendent sur cette faillite et en analysent les causes qui relèvent essentiellement des tensions croissantes qui se sont instaurées entre Washington et Moscou. Très vite les « échecs » ou le détournement des principes inscrits dans le marbre de la Charte, se sont accumulés. Génocide au Rwanda, bombardement de la Serbie, en 1999, sans autorisation formelle du Conseil de sécurité, engagement américano-britannique en Irak, interprétation extensible du mandat de l’ONU, en Libye, en mars 2011, bombardements en Syrie… Ce constat étant dressé, qui n’est pas récent, les auteurs avancent des propositions de réformes pour empêcher l’ONU de sombrer dans l’oubli et l’inaction.
La première, porte sur l’élargissement du Conseil de sécurité. Tout le monde semble s’accorder sur la nécessité d’y introduire un représentant par région, au premier chef de l’Afrique où se déroule huit des OMP sur dix. Mais quel pays représentera le continent, l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Égypte ou encore l’Éthiopie, où siège l’Union africaine ?
Il s’agit pour la deuxième d’accroître les pouvoirs du Secrétaire général, qui exerce depuis l’origine de l’organisation, le métier le plus difficile du monde. Peut-on pour sa nomination passer outre au veto des cinq permanents et le faire élire directement par l’Assemblée générale, option qui comporte le risque d’un éloignement supplémentaire des grandes puissances et de l’ONU ?
La troisième vise à doter l’ONU de ressources propres, à l’instar de l’UE. Elle ouvre une piste intéressante, mais est-elle réaliste ? Il est sûr que bon nombre de puissances, au premier chef les États-Unis, qui n’ont cessé d’y recourir bien avant Donald Trump, hésiteront longtemps avant de renoncer à leur levier financier. Nous avons évoqué le rééquilibrage entre ONU et IFI.
La quatrième offre des perspectives peut-être plus prometteuses. Il s’agirait de doter le Conseil de sécurité d’un Conseil militaire et de constituer une force d’intervention d’urgence. Sur ce point on observe une politique affirmée de la Chine qui participe de plus en plus en hommes et en financement aux opérations de maintien de la paix (OMP), en étouffant en contrepartie toute discussion sur la protection des droits de l’homme ou sa présence croissante en mer de Chine méridionale. En abandonnant ce terrain, les États-Unis de Donald Trump risquent d’ouvrir un nouveau boulevard à la Chine ce qui n’est pas l’objectif d’endiguement de Pékin qu’ils poursuivent par ailleurs.
La dernière suggestion des auteurs, experts en la matière, porte sur la politique de communication de l’ONU. Il est certain qu’en ce domaine, l’ONU et ses agences ont pris un grand retard, leurs slogans, messages, images, brochures ont vieilli et sont peu opérants. Mais ont-ils les moyens de se lancer dans une campagne mondiale en ce domaine, à moins qu’un consortium d’agences de communication ne le fasse gracieusement à leur place. Après tout la Fondation Bill et Mélina Gates dispose d’un budget annuel supérieur à celui de l’OMS.
Peut-être que l’ONU commencera à se sortir d’affaire si elle se montre capable de se réformer elle-même, en réduisant et rationalisant le nombre de ses programmes, de ses agences, en déléguant plus ses prérogatives à la base et aux organisations régionales. Il apparaît urgent par exemple d’instaurer des passerelles entre le Conseil de sécurité et le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine. Mais sur ce point comme tant d’autres, beaucoup dépend des États-membres. Tout le monde s’accorde sur le fait que l’ONU est l’unique organisation universelle, la seule tribune, et l’organe donnant la légitimité aux actions de ses membres. La difficulté est de donner du sens à ces nobles proclamations et d’insuffler un dynamisme nouveau au multilatéralisme, qui n’en est pas à sa première crise.






