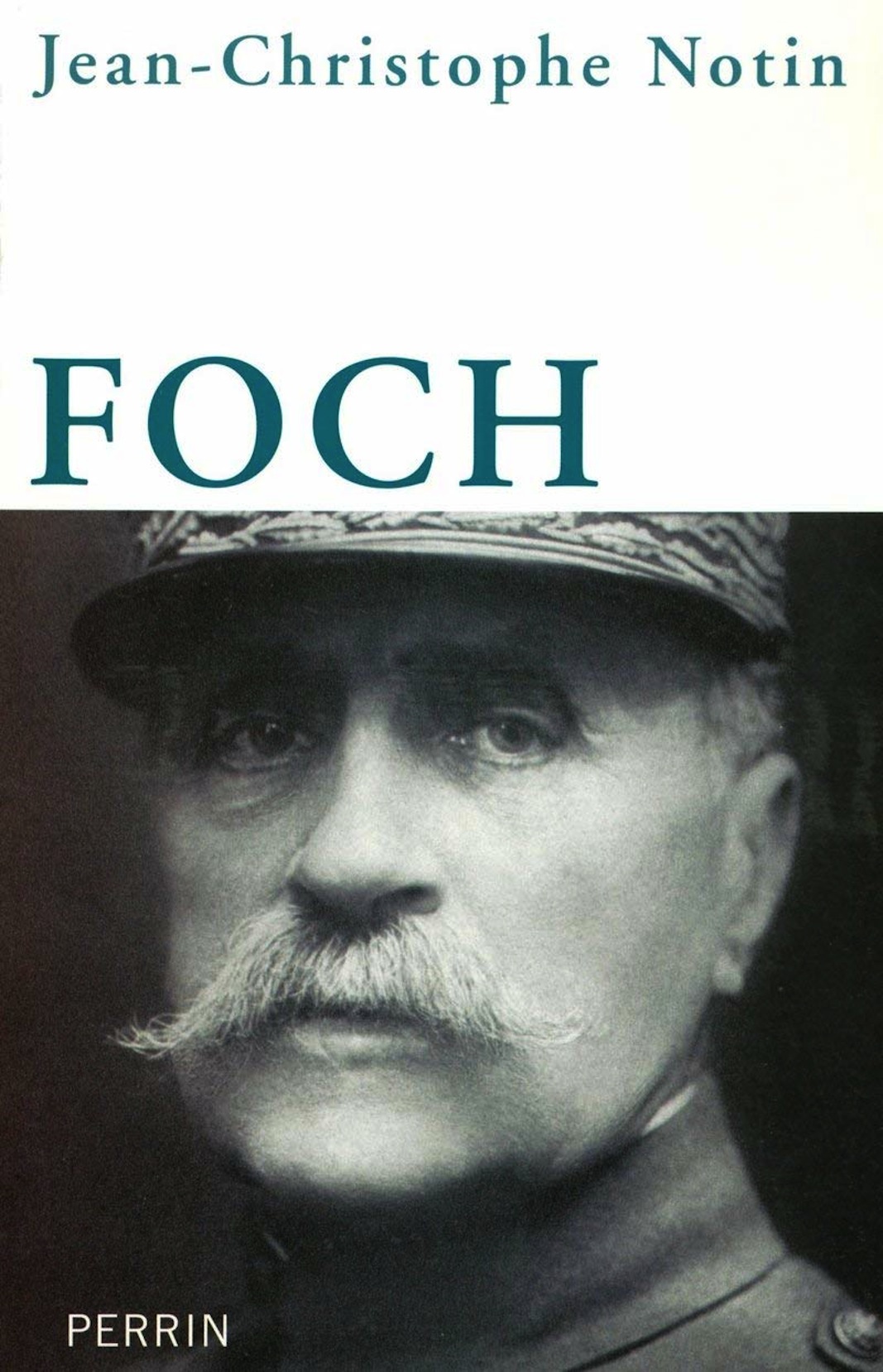
Élevé sur le pavois en 1918 parce qu’il dirigeait les armées alliées, le maréchal Ferdinand Foch (1851-1929) a reçu après la guerre en France et à l’étranger la plupart des lauriers de la victoire. Il en résulta une floraison de récits hagiographiques où la part du mythe et celle de la réalité devinrent très vite impossibles à discerner. La biographie fouillée et équilibrée de Jean-Christophe Notin permet enfin de dégager un portrait objectif d’une figure emblématique de l’histoire de notre pays.
Si les enseignements théoriques du colonel Ferdinand Foch à l’École supérieure de guerre (ESG) semblent avoir annoncé une défaite en 1914 plus qu’ils n’ont préparé la victoire de 1918, le général Foch s’est révélé, dans la pratique, « au dire de ses propres subordonnés, un piètre tacticien et un stratège pas toujours avisé » considère Notin. En ce sens, pour l’auteur, « conférer au maréchal, comme le firent tant d’hagiographes, une influence sans égale, presque mystique, sur le cours des événements est excessif. La révolution technique de l’armement, l’afflux des Américains, l’effondrement militaire et civil de l’Allemagne, sont les facteurs prépondérants » dans la victoire. Si Foch ne fut pas le génie militaire que l’on a prétendu après-guerre, il sut par contre, contrairement à beaucoup d’autres, faire évoluer sa conception de la bataille, en abandonnant le dogme de l’offensive au profit de la méthode scientifique, avant de triompher en 1918 avec sa conception d’offensives répétées.
La biographie de Notin est dense et il nous faut ici faire un choix. Nous n’évoquerons donc que deux moments de l’action de Foch : la bataille de la Marne, et l’instauration du commandement unique après la réunion de Doullens le 26 mars 1918, deux moments qui nous permettront de cerner toutes les facettes du personnage.
Avant la Marne, il y eut la bataille des frontières, avec, en ce qui concerne Foch, une première polémique, liée à sa défaite de Morhange en Lorraine le 20 aout 1914, à la tête du XXe corps et une inimitié avec Castelnau qui persistera durant toute la guerre. À Morhange, Foch fit la guerre offensive comme il l’avait enseignée à l’ESG, s’appuyant sur le primat de la volonté (hérité, selon Notin, de son éducation chez les Jésuites, mais aussi du bergsonisme, philosophie alors en vogue). Pour Foch, en effet, l’action est « la loi primordiale de la guerre. Faire la guerre fut toujours attaquer. De toutes les fautes une seule est infamante, l’inaction ». Ce qui appelle les critiques de Fayolle, son camarade de l’X : « Décidément, Foch a plus de caractère que de talent. Se battre, attaquer, quelle que soit la situation, quel que soit le terrain, tout est là pour lui. » Rappelons que dans les années 1910, Fayolle dans son cours d’artillerie à l’École de guerre décrivait déjà un champ de bataille organisé défensivement avec des kilomètres de tranchées et où l’artillerie remplirait un rôle primordial. Autre lacune du général Foch à Morhange, son mépris à l’égard des renseignements. « Les renseignements ? dira-t-il après la guerre. Mais c’est inutile, ils sont presque tous faux ; on ne sait qu’après ceux qui étaient vrais. »
La Marne. Notin relativise l’action de Foch à la tête de la 9e armée sur les marais de Saint-Gond. La phrase célèbre, « Ma droite est enfoncée, ma gauche cède, tout va bien, j’attaque » qui aurait été prononcée le 8 septembre est une phrase apocryphe, comme Foch le reconnaîtra lui-même après la guerre. Elle possède malgré tout son fond de vérité, ainsi que l’explicite le tableau de la situation qu’il dresse à Joffre : « La situation est donc excellente ; l’attaque dirigée contre la 9e armée apparaissant comme un moyen d’assurer la retraite de l’aile droite allemande. » Weygand, son chef d’état-major expliquera ainsi le « tout va bien » par le constat que les Allemands, ayant été refoulés par la 5e armée française (située à gauche de la 9e), étaient de toute façon condamnés à refluer. « Ça ne va pas fort. Bien sûr ! avoue Foch au député Tardieu. Nous ne sommes pas brillants. Mais l’ennemi non plus. La journée sera à qui tiendra le plus. On gagne les batailles avec des restes. »
Le 10 septembre, l’ennemi a subitement abandonné le champ de bataille. « Foch… y voit l’action de Dieu, mais, pour Notin, il faut plus sûrement y déceler la conséquence du coup de maître de Gallieni ». Pour le Kronprinz en effet, « l’armée allemande ne fut point battue à la Marne, mais elle fut ramenée en arrière par ordre de l’autorité militaire, qui, en la déclarant perdue sans qu’elle le fût, a définitivement scellé son sort… ».
Foch est nommé chef du GAN (le Groupe d’armées du Nord) en 1915. Après la bataille d’Artois, des officiers critiquent « des offensives hasardées, tronquées, dangereuses et sans but ». Son style intrigue ses interlocuteurs. Dans les états-majors, on s’amuse à raconter qu’il aurait donné pour ordre d’« attaquer surtout à droite et principalement à gauche » !
La qualité de ses relations avec les commandants en chef britanniques est le principal atout de Foch à ce poste. En effet, nous explique Notin, « sa principale influence s’exerce par le biais d’encouragements et de conseils tactiques ; inspirer, motiver, tel est son ministère depuis l’automne 1914 ». Ainsi, en novembre 1917 après la défaite de Caporetto, Foch conseille les chefs de l’armée italienne. Son apport est remarqué par l’ambassadeur de France à Rome : « Il a rendu au commandement supérieur italien un service inappréciable. Il a relevé le moral de tous, fait partager sa confiance et son optimisme de bon aloi à ses collègues et aux hommes politiques qu’il a approchés. Il a… fait pénétrer dans tous les cœurs la foi dans l’attaque et la victoire. Sans lui, je ne sais comment auraient tourné les choses. »
Le colonel Serrigny, chef d’état-major du général Fayolle qui succède à Foch en Italie, voit cependant l’intervention de Foch tout à fait différemment. Il écrit dans une lettre à Pétain : « Le général Foch, suivant son habitude, n’a jeté ici que le désordre. Il n’a rien organisé, s’est contenté de distribuer des paroles d’énergie… » Des officiers de l’état-major de Foch racontent même comment il est « brouillon », avec des décisions « prises brutalement et ne s’appuyant sur aucune donnée sérieuse, bref donnant l’impression d’une agitation sénile ».
Un chapitre conséquent du livre est consacré à la nomination du général Foch à la tête des armées alliées, à commencer par l’évocation de la réunion de Doullens du 26 mars 1918, décidée en urgence face à l’attaque allemande qui a commencé le 21, où Foch est chargé par les gouvernements britannique et français de « coordonner l’action des armées alliées sur le front Ouest ». À Doullens sa mission n’a pas encore l’ampleur d’un commandement unique. Foch devra à chaque fois s’entendre avec Pétain et Haig sans pouvoir leur imposer ses décisions. Ce rôle de « coordination » apparaîtra très vite insuffisant pour Foch qui fait approuver le 3 avril à Beauvais par le Conseil suprême allié une formulation qui avait déjà été adoptée en 1814 par la coalition anti-napoléonienne ayant abouti à la nomination de Blücher comme commandant en chef chargé de « la direction stratégique des opérations ». Finalement le 14 avril, Foch sera nommé « général en chef des armées alliées ». Pétain et Haig, les deux commandants en chef nationaux, conservent la conduite tactique de leurs armées et un droit d’appel à leurs gouvernements respectifs au cas où ils estimeraient leurs troupes mises en danger par les décisions de Foch. Jusqu’à la fin toutefois, sous la façade d’un commandement unifié, persistera une forte résistance britannique, et même au sein de leur GHQ une forte hostilité à la personne même du généralissime.
Pourquoi donc Foch a-t-il été choisi alors que Clemenceau, avant l’offensive allemande, penchait plutôt pour Pétain ? Il est vrai, pour l’auteur, depuis le 21 mars : « Pétain par ses propos prudents à l’excès, n’avait pas su le rassurer alors que, sur le terrain, ses décisions portaient ses fruits. » Effectivement, « Pétain en voudra à Foch… d’avoir récupéré le mérite de la défense acharnée, et finalement efficace, des Alliés ». Il aurait dû, plutôt pour Notin, « s’en prendre à ce destin complice qui veut que chaque nomination du Tarbais, toujours décidée dans l’urgence, s’accompagne presque immanquablement de la réussite sans que l’un soit vraiment la cause de l’autre ». Il est ainsi assez ironique que le commandement unique soit mis en place au moment même où le péril venait d’être endigué. En effet, estime Notin, « comme en 1914 avec Castelnau ou bien French, Foch jouit de circonstances heureuses. Au moment même où il sermonne les généraux, les armées se rétablissent in extremis, ou tout au moins évitent le pire ». À la fin du mois de mars 1918, le salut vint plus vraisemblablement de la diligence avec laquelle Pétain est venu à l’aide de Haig, que de l’intervention de Foch. Ce dernier ne parvint finalement à transférer sur le front anglais que 12 divisions quand Pétain en avait déplacé pas moins de 40.
Le président du Conseil résumera ainsi après la guerre son arbitrage en Foch et Pétain : « Je me suis dit : essayons Foch ! Au moins nous mourrons le fusil à la main ! J’ai laissé cet homme sensé, plein de raison qu’était Pétain ; j’ai adopté ce fou qu’était Foch. C’est le fou qui nous a tirés de là ! »
En réalité, la nomination de Foch était également souhaitée par le gouvernement anglais qui avait pu apprécier son énergie et ses bonnes relations avec ses homologues britanniques dès 1914. Le général Haig, dont les armées reculent devant la poussée allemande, s’en fit le premier avocat, alors qu’il y était auparavant fermement opposé. Il a en effet besoin de renforts français et « s’il demande à étendre les pouvoirs de Foch, c’est bien pour élargir au maximum le vivier d’unités qui pourront lui être concédées ». L’état-major britannique est, quant à lui, plutôt réservé sur la nomination de Foch. Le seul général allié ouvertement hostile à Foch est Pershing, le chef du corps expéditionnaire américain.
Sur le terrain, Foch entrevoit très bien les limites des tactiques d’infiltration développées par le général allemand von Hutier : « Ils se précipitent comme des fous sur un point qui cède un peu ; ils s’engouffrent dans cet entonnoir dans lequel ils s’encombrent et qui rétrécit de plus en plus. Ils ne peuvent plus faire arriver les vivres et les munitions, les troupes sont incapables de manœuvrer et au bout de peu de jours, je n’ai qu’à mettre un pain à cacheter pour boucher l’entonnoir. »
Ses relations avec Pétain restent bonnes et s’inscrivent sous le signe d’une certaine complémentarité, comme nous l’explique Notin : « Le 15 juillet 1918, Pétain n’a pas plus été le défenseur impénitent que Foch l’attaquant intrépide. Plutôt qu’une opposition simpliste décrite par certains historiens, c’est une complémentarité qui lie les deux hommes et leur action. En organisant une défense efficace, qui, le 16, arrête l’ennemi à peu près partout, le premier a permis au second la réalisation d’un projet tant attendu depuis des mois, la contre-attaque massive. »
En 1918, l’armée américaine reste encore à la traîne des Alliés, et ce en raison de « leur ignorance de la guerre moderne », selon les termes employés par Douglas Haig, le généralissime britannique. Ils apprendront vite.
Après la guerre, Foch nous expliquera la manière, tout en souplesse, avec laquelle il convient de diriger une coalition : « Il faut savoir conduire les Alliés. On ne les commande pas. Il ne faut pas faire avec les uns comme avec les autres. Je leur apporte une solution ; je ne la leur impose pas. Ils sont contents. Autrement, ils secoueraient leur chaîne si je voulais leur faire trop sentir. C’est ça le commandement interallié : on cause, on explique, on discute, on persuade. On ne donne pas des ordres… on suggère. »
La fin des combats apparaîtra à certains comme prématurée alors qu’une offensive avait été planifiée en Lorraine. Foch considère au contraire que, dès lors que les autorités allemandes acceptent les conditions d’armistice imposées par les Alliés, « le but étant atteint, nul n’a le droit de faire répandre une goutte de sang de plus ».
Lors des négociations du traité de Versailles, Foch mène campagne afin que la rive gauche soit occupée par la France, avec, il faut le reconnaître, une prescience étonnante. Ainsi, il déclare dans une interview au Daily Mail britannique : « Les Allemands sont un peuple à la fois envieux et guerrier. Dans cinquante ans, ils seront comme ils sont aujourd’hui. Qu’est-ce qui a sauvé les Alliés au commencement de la guerre ? La Russie. Eh bien, de quel côté sera la Russie dans le futur ? Avec nous ou les Allemands ? […] Et la prochaine fois, n’oubliez pas, les Allemands ne feront pas d’erreur. Ils traverseront le Nord de la France et s’empareront de ports de la Manche pour en faire la base d’opérations contre l’Angleterre. » De plus en plus incompris après la guerre, Foch se montrera très critique vis-à-vis des institutions de la IIIe République.
Quel fut le rôle de Foch dans la victoire ? Un rôle capital selon la plupart des observateurs mais certainement pas le rôle que l’on imagine. Poincaré et Millerand déclarèrent ainsi en 1922 : « Foch n’est ni l’homme des détails, ni l’homme de l’organisation, mais […] si nous ne l’avions pas eu en 1918, nous aurions perdu la guerre. » Effectivement, nous explique Jean-Christophe Notin, « Foch n’était certainement pas le meilleur stratège du conflit, encore moins le meilleur tacticien. Mais il a incarné, et fait vivre, ce lien aussi indispensable que fragile entre la France et la Grande-Bretagne, puis l’Italie, les États-Unis et l’ensemble des nations alliées. » En 1918, poursuit l’auteur, « éloigné des champs de bataille où il n’avait guère brillé, il s’est révélé un fédérateur d’énergies sans pareil, salutaire, inlassable ».
Cette biographie est aussi l’occasion de se remémorer l’enseignement de Foch à l’École de guerre. Ainsi sur l’importance de la formation des officiers : « La réalité du champ de bataille est qu’on n’y étudie pas ; simplement, on fait ce que l’on peut pour appliquer ce que l’on sait. Dès lors, pour y pouvoir un peu, il faut savoir beaucoup et bien. » Le rôle des états-majors, tel que Foch le voyait avant-guerre (en 1912), explique en effet son style de commandement et la relation étroite nouée avec le colonel Weygand : l’état-major « ne peut être une aide au commandement […] mais bien un complément […] il doit être une élite restreinte et instruite, […] le commandement doit être aux mains de personnalités de caractère d’abord, à vues larges, de beaucoup d’énergie, dégagées et se dégageant de tous les détails. Tels les généraux japonais qui allaient pêcher à la ligne après avoir donné leurs volontés à leurs états-majors qui travaillaient eux jour et nuit, à faire la cuisine, à établir tous les papiers ». L’énergie du chef militaire est finalement sa vertu principale : « Voir clair, ce n’est pas grand chose. Donner l’ordre, c’est le quart. Les trois quarts, c’est de le faire exécuter. »
On l’aura compris, l’ouvrage de Jean-Christophe Notin, que l’on peut lire aussi comme une histoire des relations entre les politiques et les militaires pendant la Première Guerre mondiale, fera date et constitue certainement à ce jour la biographie définitive du maréchal Foch.






