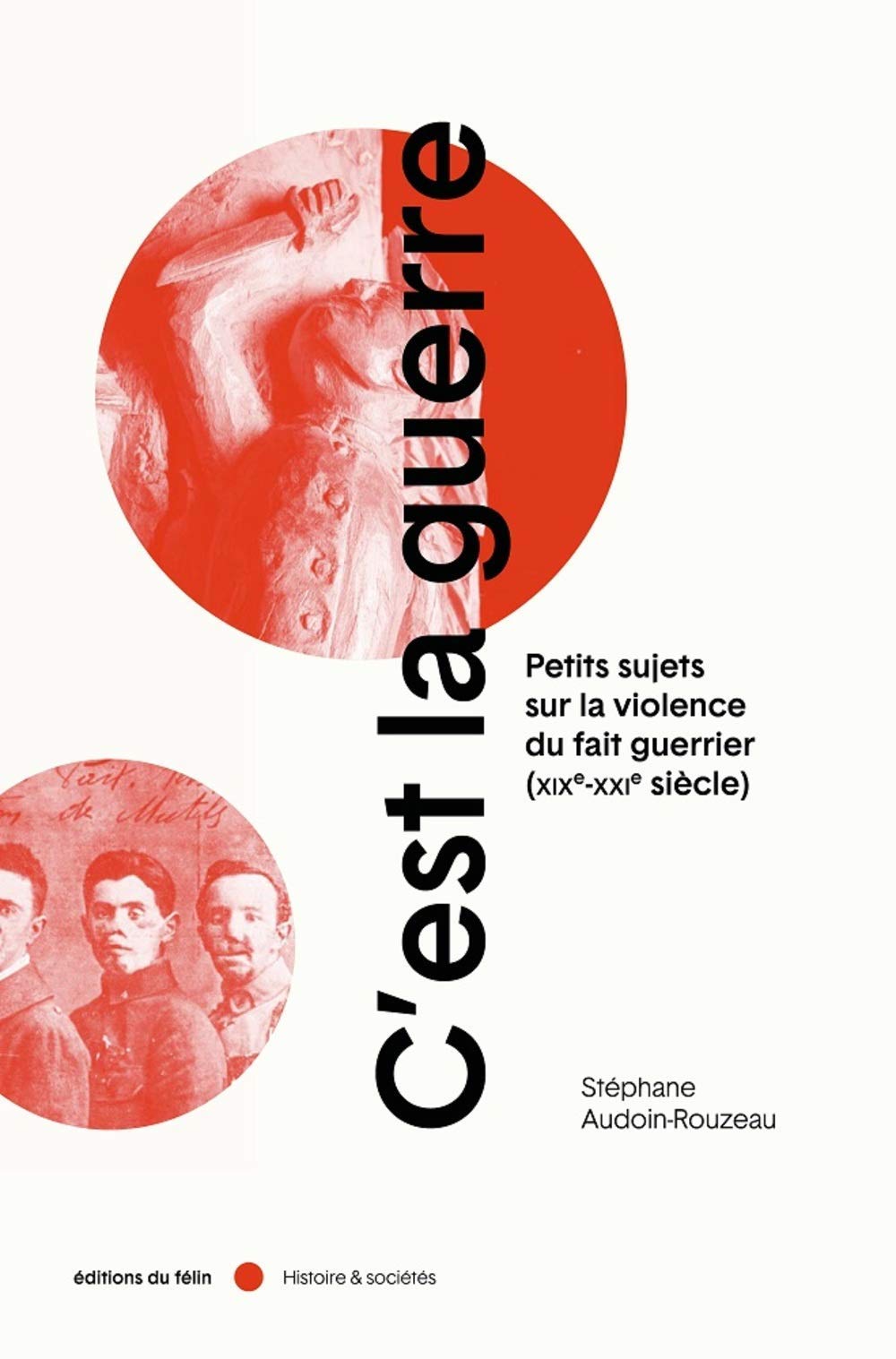
Emprunté à l’artiste Félix Vallotton, qui intitula « C’est la guerre ! » la série de gravures créée début 1915, le titre de ce livre vise à donner au fait guerrier contemporain une sorte d’évidence qui trop souvent lui fait défaut, précisément du fait de l’intensité de l’événement guerrier, des affects puissants qu’il mobilise, de la dimension dans laquelle il fait entrer ceux qui le traversent.
On sait combien le terme de guerre tend à être employé à tout propos (« guerre » contre le coronavirus, le terrorisme, le chômage, etc.) mais en contrepartie, sur les lieux de véritables guerres, sont employées souvent des expressions moins franches (conflit, affrontement, heurt, opération, etc.). Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d’études à l’EHESS et président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre, a passé quarante ans de sa vie à étudier l’activité guerrière, la violence de la guerre, de moins en moins limitée aux seuls combattants. Il avoue que ce qui a le plus attiré son attention fut le temps court (le plus court possible parfois), l’incident souvent mineur, la lettre isolée, l’objet ou l’image unique et non fabriquée, comme le drapeau sur le Reichstag, la rencontre des Américains et des Soviétiques sur le pont de Torgau, en avril 1945. Car ce sont ces gestes brefs, condensés, uniques qui saisissent le mieux ce qu’est la guerre et sa spécificité. Peut-être, avoue-t-il, l’activité guerrière est d’une telle ampleur, d’une telle richesse, d’une telle capacité à transformer, que mieux vaut renoncer à la saisir tout entière pour ne s’attacher qu’à ses anfractuosités.
Son approche est compréhensible, d’un point de vue anthropologique, mais l’est-elle d’un point de vue sociologique, stratégique, géopolitique ? Car à ne voir que le fait isolé, le saisir dans son instantanéité, on perd la vision globale de la guerre dans ses rapports avec l’Histoire, la société et le politique. En fait, les deux approches sont plus complémentaires qu’opposées. Le monument qu’est Guerre et Paix de Léon Tolstoï, l’est précisément parce qu’il a admirablement uni de magnifiques destins individuels, à l’épopée guerrière que fut la campagne de Russie, se déroulant dans de vastes espaces, avec ses variations climatiques, ses décors, ses masses de soldats, ses batailles épiques. Cela dit, contrairement à ses affirmations, l’auteur ne fait pas que saisir la guerre en instantané mais il cherche surtout et avant tout à en saisir la violence. Violence des combats, par nature collectifs, plus ou moins longs ; violence contre les populations, issue des bombardements massifs et souvent indiscriminés ; violence des mots et des représentations, tout se mêle. Ainsi, le lecteur voyage de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 jusqu’à mai 1968. Pourquoi avoir choisi mai 1968 ? C’est que l’auteur y a vu une guerre civile mimétique. En effet, ériger des barricades a constitué au cours de l’histoire un acte de rébellion politique déclenchant une bataille ouverte dans laquelle l’armée régulière entrait en jeu avec ses moyens en armes à feu et son artillerie, et ce, au prix de pertes extrêmes lourdes pour les émeutiers, comme le montre le bilan des combats de rue du XIXe siècle. Il en fut tout autrement dans le Quartier latin. Dans La Révolution introuvable, Réflexions sur les événements de mai (Fayard, 1968), Raymond Aron développait déjà sa célèbre interprétation des événements – celle du psychodrame. Dès lors que le Parti communiste conservait son contrôle sur les ouvriers et n’avait pas d’intentions insurrectionnelles, chacun pouvait se choisir un rôle et se faire plaisir à imiter les grands ancêtres – qui le révolutionnaire, qui Saint Just, qui Tocqueville.
Pour revenir à la vraie guerre, l’ouvrage commence par la bataille de Saint Quentin du 19 janvier 1871, qui a peut-être été le chant de cygne de la « bataille traditionnelle », conforme au « modèle occidental de la guerre », un type d’affrontement qui suppose depuis l’Antiquité grecque la mise en œuvre d’une violence extrême mais momentanée, postulant par ailleurs que les protagonistes tirent de part et d’autre les mêmes conséquences du résultat de la rencontre. L’Étoile belge publiait le 20 janvier un hallucinant compte rendu de son correspondant à Cambrai : « C’était bien là l’armée en haillons ! Par la rue conduisant à la station arrivaient les charrettes de blessés ; les malheureux pâles, l’œil sombre, les uns déjà amputés, les autres n’ayant même pas été pansés, semblaient attendre tranquillement la mort ». La bataille de Saint-Quentin, que suivront de peu la capitulation de la France et la signature de l’armistice, clôt en fait le XIXe siècle militaire. Elle le clôt en France : la défaite contribue à ruiner l’efficacité guerrière du mythe de Valmy, jusque-là vivante dans la mouvance républicaine. La route est libre, désormais pour une forme de circonscription universelle sur le modèle prussien, qui verra le jour en 1872, et permet la mise sur pied de cette armée de masse qui avait fait tant défaut en 1870, mais qui fera ses preuves en 1914-1918.
On a mentionné Félix Vallotton, qui, par ses six gravures, a su rendre plus encore que la photographie les terribles matérialités de la guerre, la Tranchée, Les Fils de fer, le Guetteur, L’Orgie, Les Civils. Bien d’autres témoignages suivent, lettres de conscrits à leur mère, journal d’enfance d’Anaïs Nin, la correspondance de guerre de Fernand Léger, témoignage d’une grande acuité sur la brutalité de guerre absolument nouvelle qui fut mise en œuvre au cours de cet immense conflit. Le célèbre peintre a su rendre la violence de la guerre avec un savoir-dire exceptionnel ; dont la force expressive demeure, malgré les millions d’images qui ont relaté depuis la violence guerrière. « J’ai vu des choses excessivement curieuses. Des têtes d’hommes presque momifiées émergeant de la boue… Les mains surtout sont extraordinaires… C’est ce qu’il y a de plus expressif. Plusieurs ont les doigts dans la bouche, les doigts sont coupés par les dents. Un type qui souffre trop se bouffe les mains. » Puis le peintre abdique devant tant d’horreurs.
La guerre, c’est aussi les champs d’honneur, les mémoriels, les célébrations. Le fameux sanctuaire japonais de Yasukeni est caractéristique à cet égard, qui a bien de fois défrayé la chronique car abritant les tombes de criminels de guerre à côtés de ceux des autres combattants. Est-il décent de s’y rendre, comme l’a fait le président Reagan ? Le terme de Yasukuni, qui associe les mots apaiser (yasunzuru) et « pays » (kuni), signifie donc « apaiser le pays », « maintenir la paix du pays ». Le sanctuaire est devenu la « pierre angulaire du militarisme japonais » en même temps qu’un lieu de culte de l’empereur et de l’État. Tout est là : convient-il d’héroïser les soldats morts au combat, dans une perspective de paix ou dans une perspective clairement affirmée de préparation à la guerre ? Chaque pays, chaque époque, apporte sa réponse à cette éternelle question. Tant que persistera la guerre, les réponses ne seront jamais tranchées. Si vis pacem, para bellum.







