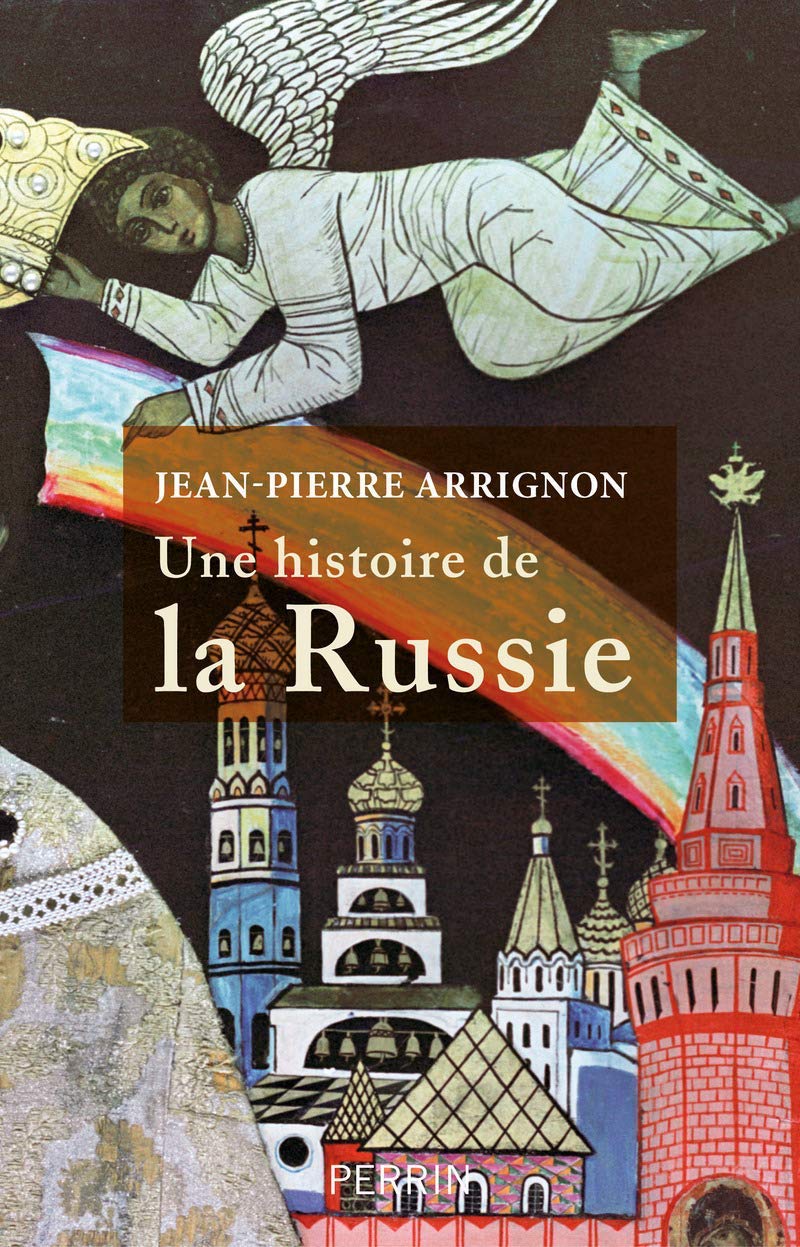
Professeur honoraire des universités, docteur honoris causa de l’université de Iaroslav, auteur de nombreux ouvrages sur la Russie, Jean-Pierre Arrignon a eu raison d’intituler sa dernière et heureuse synthèse, une histoire de la Russie et non l’histoire de la Russie. Car qui peut se targuer d’écrire en moins de 600 pages le récit complet de l’histoire de ce vaste État eurasiatique dont le destin nous a toujours concernés, mais dont bien des pages restent toujours disputées ou controversées.
Les origines mêmes de la Russie, le premier État des Slaves de l’Est, pourtant pas si lointaines (fin du IXe siècle), sont entourées d’un halo de mystère. Une interprétation largement répandue fait de Riourik le fondateur de la dynastie princière russe. Or, les Novgorodiens ne se souviennent d’aucune campagne menée par leur premier prince ; ils ne connaissent pas les circonstances de sa mort comme le lieu de sa tombe. Le premier État « russe » a-t-il été fondé par des Varègues, d’origine scandinave, ou existait-il déjà ? Une question qui n’est bien entendu pas neutre pour un État si attaché à sa souveraineté et sa personnalité. Autre chapitre faisant l’objet d’interprétation divergente, celui du joug tataro-mongol que l’auteur nomme « joug mongol ». Il est vrai que la population d’origine tatare actuelle, la plus importante ethnie non russe, concentrée en partie au Tatarstan (capitale Kazan, où étudièrent Tolstoï et Lénine), ne veut pas toujours être associée à ce chapitre et apparaître ainsi comme les descendants des envahisseurs et oppresseurs du peuple russe. En tout cas, l’empreinte qu’a laissée ce « joug tatar-mongol » qui s’est étiré sur trois siècles (1238-1242, 1480) reste ardemment discutée. La Russie lui doit-elle sa tradition autocratique ? Le « joug mongol » (tatarskoye igo) est devenu une expression courante. N’a-t-on pas entendu dans la bouche de Dmitri Medvedev, alors Président dire « que la Russie doit se débarrasser du joug pétrolier » ? Ainsi, après la chute de Constantinople, on assista au transfert de l’empire byzantin à Moscou comme jadis de Rome à Constantinople. De la provient l’idéologie de la « troisième Rome » et on sait qu’il ne saurait y en avoir de quatrième !
Une expression a traversé l’histoire russe, celle du « rassemblement de la terre russe ». On sait l’attachement mystique que le Russe, le paysan (paysan a la même racine que chrétien) porte à la terre, et donc assister à son démembrement, sa dispersion équivaut à un drame. D’où la nécessité de disposer d’un pouvoir fort, disons même autocratique pour rassembler et tenir sous un même toit, Empire des tsars, URSS, Fédération de Russie, d’aussi larges espaces où coexistent pas moins de 160 ethnies. C’est à partir d’Ivan le Terrible, si l’on excepte la période de saint Vladimir avant l’invasion tataro-mongole, que la future Russie, encore connue comme la lointaine Moscovie, rejoint la famille, sinon le concert des puissances. Cette vaste étendue, non pourvue de défenses naturelles, doit combattre, se défendre ou s’étendre sur trois fronts qui restent jusqu’à nos jours les zones géopolitiques de la présence russe : sur la Baltique où elle se heurte aux Suédois, aux Germains et aux Polonais – un objectif qui sera achevé par Pierre le Grand, avec la guerre du Nord (1700-1721) ; en direction de la Caspienne après la prise de Kazan (1552) et d’Astrakhan (1556). le troisième front sera le franchissement de la Volga en direction de la Sibérie, à la recherche de l’or brun et des fourrures. Ajoutons aussi l’axe caucasien qui occupera les armées russes de longues décennies jusqu’au XIXe siècle.
Après la mort du Terrible, la Russie, entre dans la période du Temps des troubles (1598-1613), de triste mémoire marquée par des luttes pour le pouvoir, épisode des « Faux Dimitri », les interventions étrangères suédoise et surtout polonaise… Le fils de Sigismond III, le roi de Pologne, Vladislav occupera pendant près de trois ans (1610-1613) le trône de Moscou : le pays fut envahi d’un profond sentiment d’abandon et de liberté qui, au travers des siècles, a laissé bien des traces. N’a-t-on pas parlé pour décrire la période 1991 à 1999, de nouveau temps des troubles. Cette lutte polono-russe qui s’est notamment cristallisée autour de Smolensk, n’a cessé de se perpétuer, au travers des divers partages de la Pologne, jusqu’au pacte Ribbentrop-Molotov du 23 août, texte faisant toujours l’objet d’interprétations divergentes entre Varsovie et Moscou.
Puisque nous avons actuellement les yeux braqués sur l’intervention turque au Nagorny Karabakh, il convient de lire avec attention les passages sur les guerres russo-turques, au nombre de onze, auxquelles il consacre près de huit pages. Après l’avènement de la dynastie des Romanov (1613-1917), on peut affirmer que la Russie avec Pierre le Grand entre dans le cercle restreint des cinq puissances européennes, auxquelles il convient d’ajouter l’Empire ottoman qui deviendra vite l’« homme malade de l’Europe », selon l’expression de Nicolas Ier. Pierre le Grand est incontestablement l’une des figures les plus remarquable de l’histoire russe, écrit Jean-Pierre Arrignon, pour ne pas dire la figure la plus prestigieuse. Qui peut lui disputer cette place ? Alexandre Nevski, Catherine II la Grande, Alexandre Ier, Lénine, Staline ? Pourtant le grand homme qui a ouvert une fenêtre sur l’Europe, en fondant Saint-Pétersbourg en 1703, a sorti la Russie de son berceau traditionnel en lui imprimant des traits sociaux culturels qui n’étaient pas les siens, avance toute une école de pensée, que Soljenitsyne a fait partiellement sienne. S’agissant de Catherine II, l’auteur écrit que Voltaire fut son mentor. Elle a certes acheté sa bibliothèque, mais c’est Diderot qui s’est rendu auprès d’elle à Saint-Pétersbourg pour lui dispenser quelques conseils.
Après les convulsions de la Révolution et des guerres napoléoniennes, la Russie s’affirme comme une grande puissance : Jean-Pierre Arrignon consacre d’ailleurs presque les deux tiers de son ouvrage à la période ultérieure beaucoup mieux connue. On en connaît les chapitres principaux, choc de la guerre de Crimée (1853-1856), révolte des décabristes (1825), dont l’échec a entravé l’émergence démocratique pour des décennies, la fin du servage (1861), trois années avant l’abolition de l’esclavage aux États-Unis. Puis on passe d’une révolution à l’autre 1906-1917. S’agissant de la prise du pouvoir par les Bolcheviks, Jean-Pierre Arrignon reste prudent : « grande révolution socialiste d’Octobre » pour les historiens marxistes, alors que les adversaires parlent de coup d’État, de prise illégale du pouvoir et de violences faites au peuple. Une vision binaire, certes exacte, mais qui réduit la complexité de l’événement, car les mencheviks et la plupart des socialistes révolutionnaires étaient contre la prise par la force du Palais d’Hiver. En fait, ajoute-t-il, c’est la dissolution de l’Assemblée constituante, début janvier 1918, qui marque la dissolution de l’Assemblée et non la révolution d’Octobre qu’il relègue au rang de simple péripétie, dans le processus révolutionnaire. C’est pourtant cette péripétie qui a été célébrée pendant près de trois quarts de siècle en URSS et fait toujours l’objet d’un culte par le parti communiste russe. Le dernier tiers de l’ouvrage est consacré à l’URSS, jusqu’à disparition, le 25 décembre 1991. Faute de recul, aussi par ce qu’il ne s’agit plus d’histoire, mais de politique encore controversée, le récit s’arrête en 1993 avec l’attaque contre la Maison-Blanche où s’étaient réfugiés les opposants à Eltsine et l’adoption de la Constitution du 12 décembre.
Nous n’avons rendu compte ici, que des développements purement politiques ou diplomatiques de l’histoire russe. Cependant, ce riche et suggestif ouvrage est loin de s’en tenir à ces seuls aspects et c’est là tout son intérêt. Près du tiers traite de la société et de la civilisation, de la politique, de l’économie, de la culture et de la religion. Science, médecine et architecture ne sont pas aussi négligées. La riche littérature se développe sous nos yeux, avec les cinq « grands » : Gogol, Tourgueniev Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, suivis des prix Nobel Bounine, qui vécut en France, Pasternak et Cholokhov. Qui n’a pas été charmé par les sonorités des compositeurs russes. Sait-on qu’après les pièces de Molière, celles de Tchekhov sont parmi les plus jouées en France, ainsi que la musique de Tchaïkovski après celle de Mozart. Jean-Pierre Arrignon cite de nombreuses expressions typiquement russes, transcrites dans leur phonétique, et livre de nombreux extraits de documents historiques, décret sur la paix, articles constitutionnels, proclamations… On a donc en un volume, relativement condensé, à peu près tout ce qu’on doit savoir sur notre grand voisin, qui a été tour à tour notre adversaire, notre ami, et qui reste, peu ou prou, un partenaire indispensable. Avec Jean-Pierre Arrignon, la Russie cesse un peu d’être une énigme, enveloppée dans une charade entourée de mystère. Car, comme avait ajouté Churchill, la clé pour percer l’énigme on la connaît, c’est l’intérêt national. Cet intérêt national, ou cette identité russe, on le perçoit tout au long de ces pages, au travers des épopées, derrière les murs épais du Kremlin, dans les palais de Saint-Pétersbourg, les milliers de bulbes colorés des églises, au cœur des profondes forêts, le long des grands fleuves, sur les champs de bataille, sur les pages immortelles de la grande littérature ou les notes d’une musique qui n’a cessé de fasciner ou de séduire.







