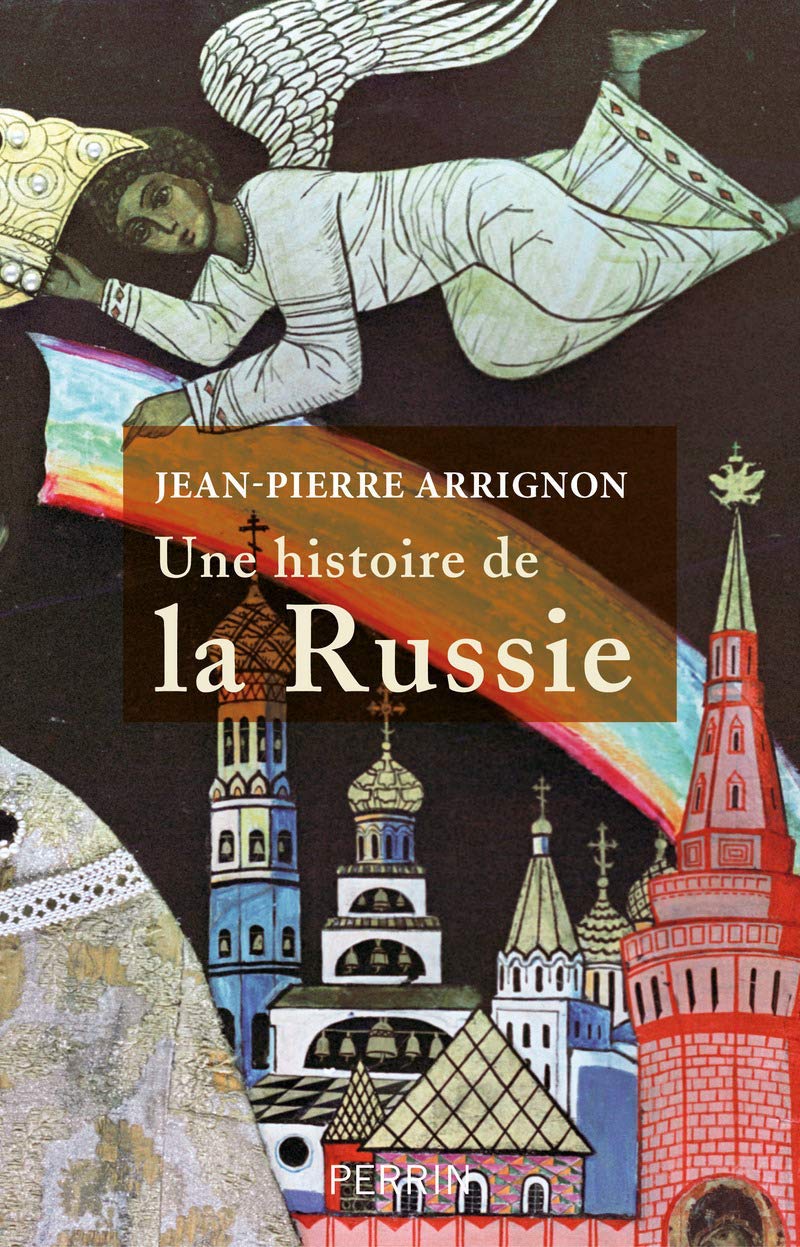
Le dernier livre du professeur Jean-Pierre Arrignon est le résultat de cinquante années de recherches sur le monde russe, et notamment sur la Russie médiévale et l’influence byzantine. Le livre se distingue d’autres histoires de la Russie à deux égards. En premier lieu, Arrignon est parti de l’approche que les Russes se faisaient eux-mêmes de leur histoire. Ce parti pris assumé se ressent d’ailleurs souvent à la lecture du livre. En second lieu, il nous propose une « histoire globale » qui s’étend à l’art, à la littérature et à la culture en général, et qui rompt ainsi avec les approches événementielles souvent rencontrées. L’ouvrage comprend notamment quelques excellents paragraphes sur la littérature russe en son âge d’or (1860-1930).
Nous n’évoquerons ici que quelques points saillants du livre qui n’ont comme point commun que le fait de n’avoir été qu’assez peu abordés dans d’autres histoires de la Russie.
Les aspects religieux sont tout d’abord évoqués en détail. Si le christianisme byzantin est adopté sous Vladimir Ier en 988-989, la Russie subit très longtemps la persistance d’un fonds culturel païen. On a affaire à un « paganisme christianisé » plus qu’à un « christianisme paganisé », souligne Arrignon.
En 860, l’empereur byzantin Michel III confie à deux frères, Cyrille et Méthode, la mission d’inventer un alphabet adapté aux langues slaves. Leur alphabet « glagolithique » ne se diffusant pas vraiment parmi les Rus’, il fallut attendre un siècle pour que deux moines, Naum et Clément, créassent dans les années 950 en Bulgarie un autre alphabet, qu’ils appelèrent « cyrillique » en hommage à leurs prédécesseurs, et qui, lui, se répandit rapidement chez les Slaves de l’Est.
Contrairement au récit national souvent entendu, « la Rus’ de Iaroslav (mort en 1054) est un État multiethnique qui cherche une unité autour de sa foi, sa législation, son art et son économie ».
L’opposition entre Russes et Mongols à partir du XIIIe siècle est de même à nuancer. À l’instar d’autres princes russes, Alexandre Nevski, grand prince de 1252 à 1263, met en effet en œuvre une véritable politique de collaboration avec les Mongols. En contrepartie, ces derniers transfèrent aux princes russes la charge de collecter l’« impôt du Khan ». Pour Arrignon, « l’exploitation des terres russes sous le joug mongol est l’une des causes du retard de développement du pays par rapport à l’Europe occidentale ». On pourrait ajouter à cette première cause explicative une seconde constituée par le servage qui arrivera bien plus tard.
Arrignon développe, s’agissant de la Russie, le concept de « civilisation d’héritiers », notamment entre Byzance et le monde russe. Ainsi, en 1472, Sophie Paléologue, la nièce du dernier empereur de Constantinople, Constantin XI (mort sur les remparts de la ville en 1453), épouse le grand prince de Russie Ivan III. En guise de dot, elle apporte à son mari le blason de l’empire byzantin, l’aigle à deux têtes. Elle introduit aussi à la cour le cérémonial byzantin, « faisant ainsi d’Ivan III l’héritier et successeur légitime des empereurs de Contantinople. Ainsi se réalisait, ajoute Arrignon, le transfert de l’empire, de Constantinople à Moscou, comme jadis de Rome à Constantinople. L’orthodoxie avait désormais un chef politique et militaire ». L’idéologie de la « Troisième Rome », exaltée plus tard par les eurasistes, était déjà en germe dans cette union.
Un peu plus tard, entre 1515 et 1521, le moine Philothée adresse au grand prince Vassili II une lettre qui deviendra célèbre dans laquelle il définit cette idéologie : « Deux Rome sont déjà tombées, la première sous les coups des Vandales, la deuxième sous les coups des Turcs, la troisième, Moscou, est debout, et de quatrième, il n’y en aura pas. » Arrignon nous met cependant en garde. Il ne faudrait pas interpréter cette phrase comme « l’affirmation de la prétention de l’État russe à la souveraineté mondiale ou comme (étant) porteur d’un messianisme universel », mais simplement comme exprimant « sa responsabilité à assumer son existence ultérieure dans le monde ». Cette interprétation reste malgré tout, nous semble-t-il, quelque peu minoritaire…
L’Église russe avait besoin d’un empereur en titre qui prendrait la tête de la chrétienté orientale. Après avoir proposé vainement la titulature impériale à Ivan III, puis à son fils Vassili III, elle réussit à convaincre Ivan IV (« le Terrible ») qui reçut alors formellement les insignes impériaux (le sceptre et le globe) en janvier 1547 et devint ainsi le premier tsar. Avec le couronnement d’Ivan IV, « s’achevait le transfert idéologique de Constantinople vers Moscou, commencé par l’héritage du blason byzantin de l’aigle à deux têtes, poursuivi par le couronnement impérial et achevé par la transformation du siège métropolitain de Moscou en patriarcat en 1589 ».
Le servage, cause principale du retard russe, trouve ses origines au XVe siècle. En 1472 est publié en effet un nouveau code de lois, le subednik, dont l’article 57 interdit aux paysans de passer d’un maître à l’autre. Le système du servage proprement dit sera introduit par un oukaze ultérieur de 1592 ou 1593, puis renforcé en 1649.
Arrignon ne néglige pas les aspects géostratégiques qui sont capitaux pour comprendre l’expansion russe. Il évoque notamment la « grande guerre du Nord » contre la Suède de Charles XII, par laquelle Pierre le Grand s’efforce d’obtenir un accès à la mer Baltique afin d’établir des relations directes avec l’Occident. La stratégie adoptée par l’armée russe, battue initialement à Narva en 1700, sera la même que celle qui sera mise en œuvre lors des invasions suivantes, en 1812 et en 1941, et consistera à battre en retraite dans la profondeur de son territoire afin d’épuiser l’ennemi. Les défaites suédoises de Lesnaïa (1708) et de Poltava (1709) sanctionneront cette approche stratégique pertinente.
En 1719, avec le « privilège de Berg », Pierre le Grand incite les Russes à fonder librement leur entreprise d’exploitation minière. De nouvelles branches industrielles apparaissent : la construction navale, les usines de soierie, de faïence, de verre, de papier… Dans le pays, toutefois, en raison de la prééminence du servage, il n’existait pas d’ouvriers libres, leur statut était celui de serfs. Le travail salarié n’était utilisé qu’épisodiquement, essentiellement en faisant appel à des étrangers qualifiés. Dans les années 1730-1740, le travail forcé devint quasiment la règle dans tous les secteurs de l’industrie. L’industrie métallurgique prend également son essor au début du XVIIIe siècle, ce que l’on ignore souvent. Au milieu du XVIIIe siècle la Russie produisait déjà moitié plus de fonte que l’Angleterre. Les plus grosses usines métallurgiques du monde étaient alors situées à Neviansk, Kamenski et Ekaterinbourg.
On remarque au passage un personnage pittoresque ayant eu une fin tragique, en la personne du tsar Pierre III. Né grand-duc d’une principauté allemande, petit-fils de Pierre le Grand, peu attiré par la Russie, il déclarera d’ailleurs préférer être « colonel d’un régiment prussien plutôt qu’empereur de Russie » ! Il régnera six mois avant son assassinat, pendant lesquels il publiera un total de 192 oukazes sur les sujets les plus divers, de l’interdiction de la barbe pour les popes jusqu’à la limitation à vingt-cinq ans du service militaire qui était alors dû par les nobles. Finalement, l’oukaze du 18 février 1762 libérera la noblesse de ses obligations militaires. Un autre sécularisera les terres de l’Église. Paul Ier, quelques décennies plus tard, connaîtra le même sort funeste. Tous les deux ont comme point commun d’être d’origine allemande et d’avoir eu l’outrecuidance de tenter de reformer la Russie…
Le XVIIIe siècle voit un effort important fait dans le domaine de l’éducation : simplification de l’alphabet, adoption des chiffres arabes, création d’un système d’écoles à destination de certaines couches sociales, les serfs en demeurant exclus, mais pouvant néanmoins entrer à l’université de Moscou (fondée en 1755 par Lomonossov). Au total toutefois, seulement deux enfants sur mille recevaient une éducation… C’est aussi à la même époque que fut introduite la conscription. Dès 1705, vingt « feux » de paysans devaient fournir une recrue pour un service militaire à vie.
À partir de Pierre le Grand la société russe va se partager en deux courants : « le courant occidentaliste qui voit l’avenir de la Russie dans l’adoption du modèle occidental et les slavophiles pour lesquels l’avenir de la Russie se trouve dans le maintien de ses traditions et de sa culture perçues comme les sources de sa modernité et de son développement ».
Dans les années 1830-1840, ces deux courants intellectuels continuent, malgré leurs différends entre eux, de s’opposer au gouvernement. Tous deux souhaitent une monarchie constitutionnelle et l’abolition du servage, même si les slavophiles considèrent que le capitalisme, qui s’est alors imposé en Occident, est néfaste pour le peuple et causerait le déclin de la moralité publique, tout en prônant le développement de l’industrie, de l’artisanat et du commerce et en accordant un rôle important à l’orthodoxie. Pour eux, « l’âme russe » possède un caractère collectif marqué, à l’opposé de l’individualisme occidental. Plus tard, Alexandre Herzen, alors même qu’il rejoignait les occidentalistes sur de nombreux points, reprendra cette idée en considérant que la société russe, habituée à exercer une propriété collective sur la terre et à sa redistribution périodique, était mûre pour passer directement au socialisme en sautant par-dessus le stade capitaliste. À la fin des années 1940, une littérature soviétique nationale, faisant écho à cette slavophilie historique, se développa pour combattre le « cosmopolitisme », lequel était caractérisé par une « inclination en faveur de tout ce qui était occidental ».
Le prince Gortchakov, ministre des Affaires étrangères russe de 1856 à 1882, proposa un programme précis pour son pays : « refus de l’ingérence étrangère dans les conflits internationaux, recherche énergique d’alliés et utilisation des oppositions entre États pour obtenir des avantages en politique étrangère ». Programme toujours d’actualité… Gortchakov est célèbre pour avoir prononcé cette phrase en 1856 : « La Russie n’en veut à personne… La Russie se concentre sur elle-même », leitmotiv de la stratégie déclaratoire russe contemporaine, ce qui nous montre que la diplomatie s’inscrit à l’évidence dans la longue histoire.
Une bonne partie du livre est consacrée à la révolution de 1917 et à la Russie soviétique. Arrignon s’interroge notamment sur les raisons de la victoire des bolcheviks à l’issue de la guerre civile. Pour lui, les Blancs pâtirent avant tout de l’absence de programme unique et concret qui aurait été porté par un chef respecté et obéi. Au contraire, les Rouges réussirent à mobiliser toutes les ressources du pays. Les bolcheviks étaient en outre perçus comme les défenseurs de la patrie et de la Révolution alors que les Blancs ne semblaient défendre que les intérêts des classes nobiliaires et bourgeoises.
Le 26 décembre 1918, Lénine publie un décret sur l’« éradication de l’analphabétisme » en vertu duquel tous les citoyens de huit à cinquante ans avaient l’obligation d’apprendre à lire. Pour les y aider 40 000 « points de liquidation de l’analphabétisme » furent créés. La campagne fut un succès : en 1926, le pourcentage de personnes sachant lire et écrire était déjà de 60 %, il passa à 90 % en 1939 puis à 100 % en 1950.
Après la Seconde Guerre mondiale, d’autres avancées sociales assez remarquables furent accomplies. Ainsi, en juillet 1956, une nouvelle loi fixait des conditions de départ à la retraite assez novatrices. Les travailleurs soviétiques étaient répartis en trois groupes selon la pénibilité de leur poste. Le premier groupe comprenait notamment les mineurs et partait à la retraite à cinquante ans. Le deuxième, les ouvriers travaillant dans des conditions pénibles (métallurgie, industrie pétrolière, etc.) qui partaient à cinquante-cinq ans (cinquante pour les femmes). Le troisième comprenait tous les autres (soixante ans pour les hommes, cinquante-cinq pour les femmes). Les fonctionnaires bénéficiaient des conditions applicables au second groupe.
Arrigon relativise quelque peu l’image réformiste de Nikita Khrouchtchev. Il relève notamment que sous sa direction furent en effet détruites plus d’églises que sous l’ensemble des autres secrétaires du parti réunis !
L’auteur nous apprend également que c’est Youri Andropov (1914-1984), le successeur de Brejnev, qui est à l’origine des termes glasnost (transparence) et perestroïka (reconstruction), qui constitueront les mots d’ordre de la période gorbatchévienne.
Une bonne synthèse de l’histoire d’un pays et d’une civilisation relativement méconnus. L’ouvrage s’appuie sur une bibliographie très complète et est muni d’un index. ♦







