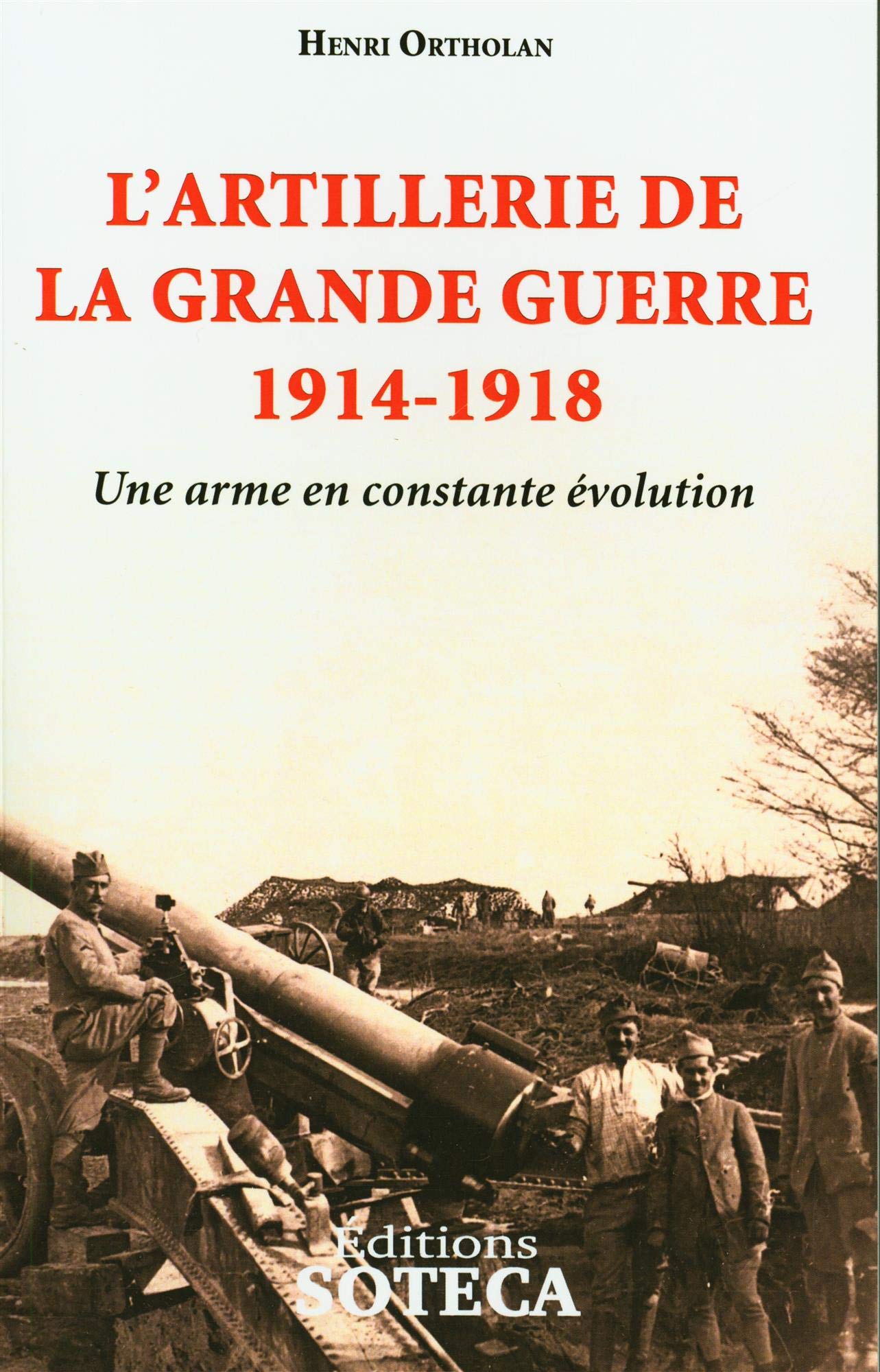
L’artillerie de l’entrée en guerre, celle de l’été 1914, est d’abord une artillerie de campagne qui met en œuvre des matériels conçus à la fin du siècle précédent ou au tout début du suivant. Chaque belligérant en possède plusieurs milliers de pièces et sur le plan technique ce matériel évoluera peu. Une artillerie lourde de campagne existe aussi, en dotation (c’est le cas de l’Allemagne), ou, le plus souvent, seulement en cours d’étude chez les autres belligérants où elle est beaucoup moins développée. Elle montera en puissance par la suite. Il convient de préciser que les nouveaux matériels utilisés en 1914 sont souvent dits « à tir rapide » en raison des améliorations apportées aux affûts pour amortir le recul et limiter le dépointage de la pièce. Le canon français de 75 mm modèle 1897 permettra ainsi une cadence de tir de 15 à 18 coups par minute. Son homologue allemand de 77 mm n’atteindra que 10 coups par minute. Les performances de la pièce française sont telles « en cadence de tir, en portée et en précision, qu’elle paraît être l’alpha et l’oméga de l’artillerie française. Cela jouera auprès du haut commandement français sur la politique à adopter en matière d’armement, et pas forcément dans le bons sens », juge le colonel (er) Henri Ortholan, auteur de cette histoire de l’artillerie pendant la Grande Guerre.
Le nouveau canon permettra de modifier l’organisation interne des régiments d’artillerie. En France, le capitaine Sainte-Claire Deville, le « père » du canon de 75, montre en 1898 qu’une batterie à quatre pièces présente un rendement supérieur à celle de six. Il est suivi par le Comité technique de l’artillerie dans son avis du 6 mars 1899. Chaque corps d’armée français comportait, tous calibres confondus, 120 canons. Entre le régiment et la batterie, on introduit alors un échelon intermédiaire, le groupe, lequel devient ainsi, déjà avant la guerre, le pion tactique de base.
À l’entrée en guerre, la France possédait exactement 3 720 pièces de campagne et 308 pièces lourdes. Si les 75 français domineront les 77 allemands, les 155 mm Rimailho, le 120 mm Baquet et les 120 mm L de Bange ne pourront faire jeu égal avec les 10, 15 et 21 cm allemands (à l’époque les calibres de l’artillerie allemande s’expriment en millimètres).
Le rôle de l’artillerie dans les premières opérations de 1914 fait l’objet d’un chapitre entier du livre. On y relève notamment l’emploi de l’artillerie de siège allemande (deux obusiers de 42 cm et quatre batteries austro-hongroises de 30,5 cm Skoda) dans la prise des forts de Liège, de Namur et de Maubeuge. En rase campagne, l’artillerie lourde allemande de 15 cm fait aussi la différence. Ses tirs de contrebatterie, dirigés, ce qui est une nouveauté, par des officiers d’observation avancée, confirment leur efficacité : « Une batterie de 75 ne peut tirer quatre coups, s’étonne un témoin, qu’elle est repérée et éteinte. » L’artillerie française n’obtient de réels succès qu’au moment des contre-offensives, lorsque l’ennemi offre des objectifs assez rapprochés pour être visibles et observés.
Le 75 français se distingue particulièrement le 25 août au sud de Nancy et le 29 lors de la bataille de Guise. Le 6 septembre, le 15e RAC arrête à lui seul un assaut allemand à Courgivaux. Le général d’artillerie allemand Rohne déclara après la guerre : « L’artillerie de campagne française était considérablement supérieure à la nôtre, non seulement comme matériel mais, ce qui est beaucoup plus important, comme emploi. »
Le chapitre suivant est consacré à la « crise des munitions » de l’automne 1914. Elle touche, à des degrés divers, toutes les nations belligérantes. Les Britanniques, engagés dans les Flandres, doivent ainsi limiter leurs tirs à 9 obus par pièce et par jour. Cette crise frappe encore plus sévèrement la Russie.
En dépit d’un commencement quelque peu laborieux, la France possède dès 1916 la deuxième artillerie de l’époque rapportée au nombre de combattants (273 combattants par canon), juste après l’Allemagne (283 combattants par canon). La Russie est la moins bien dotée (863).
L’emploi de l’artillerie évolue rapidement. Dès le 24 août 1914, la 1re armée française inaugure le tir de barrage de nuit, que les Allemands généralisent le 7 septembre. En 1916, la France prend la décision de constituer une puissante réserve d’artillerie de 5 000 pièces à tir rapide. Les belligérants développent également une artillerie de tranchée (minenwerferet crapouillots) que l’auteur nous détaille dans un chapitre distinct. Le front italien voit également apparaître une artillerie de montagne. L’offensive de la Somme (de juillet à novembre 1916) permet la mise en place par les Anglais du barrage roulant (creeping barrage), même si chaque belligérant en revendique la paternité.
L’ouvrage, qui tend à l’exhaustivité dans son domaine, aborde aussi la question des obus chimiques et de l’artillerie antiaérienne. Il touche même à des questions annexes comme celles de l’utilisation pratique des chevaux et de l’apparition des premiers tracteurs d’artillerie.
On remarque incidemment à la lecture du livre du colonel Ortholan que la plupart des innovations techniques réalisées sont dues à des officiers subalternes. Si le capitaine Sainte-Claire Deville était le concepteur du canon de 75, le capitaine Celerier conçoit de son côté un mortier de tranchée et le capitaine Baillaud un appareil de détection des aéronefs par le son.
En 1917, la France rattrape enfin son retard dans le domaine de l’artillerie lourde de campagne avec des pièces de 155, comme le 155C Mle 1917 de Schneider ou le 155 GPF (Grande puissance Filloux) Mle 1917. Ce dernier, d’une portée de 16 300 m, sera même adopté par l’armée américaine.
L’Allemagne n’est pas non plus en manque d’innovations, techniques ou conceptuelles. Ainsi, la méthode Bruchmüller, mise en œuvre à Riga en septembre 1917, permet le tir sans réglage. Le général Bruchmüller s’appuie d’ailleurs lui aussi sur les travaux d’un capitaine, Erich Pulkowski.
La course à la portée a continué pendant tout le conflit. Au printemps 1918, le Pariser Kanone (faussement appelé la « Grosse Bertha ») bombarde la capitale à plus de 120 kilomètres de distance. La forte élévation du fût (55°) permet à l’obus d’atteindre la stratosphère où la résistance de l’air est moindre (l’obus atteint 40 kilomètres d’altitude à son apogée).
C’est à la fin de la guerre que les artilleries des armées belligérantes atteignent leur niveau maximum, ce qui occasionnera d’ailleurs une seconde crise des munitions en 1918. De 78 régiments d’artillerie en 1914, la France passe ainsi à 400 régiments en 1918, ce qui représente 1 221 batteries d’artillerie de campagne et 1 210 lourdes, soit environ 9 500 pièces. Son influence est énorme dans le camp allié : « Dès juillet 1917, arrivé en France, le général Pershing, commandant le corps expéditionnaire américain, donne l’ordre de former son artillerie selon les méthodes françaises. » La DCA française forme également à partir de septembre 1917 les officiers de l’artillerie antiaérienne américaine.
L’armée allemande n’est pas en reste en termes de capacités. Sur le seul front de l’Ouest elle dispose au printemps 1918 de 11 200 pièces de campagne et de 7 920 pièces lourdes, soit un total impressionnant de 19 120 pièces.
Finalement, on pourrait considérer que le premier conflit mondial fut avant toute chose une guerre d’artillerie. Sur la trentaine de millions de victimes du conflit, plus de deux tiers sont dus à l’emploi de cette arme.
On l’aura compris, cette histoire de l’artillerie pendant la Première Guerre mondiale est d’une exhaustivité tout à fait remarquable. Tous les aspects de cette arme et de son emploi sont évoqués et analysés dans le détail, même ceux que l’on pourrait a priori considérer comme mineurs, comme les mortiers de tranchée ou le repérage par le son, et cela pour tous les belligérants ! Ce livre ne pourra donc que faire référence dans ce domaine.







