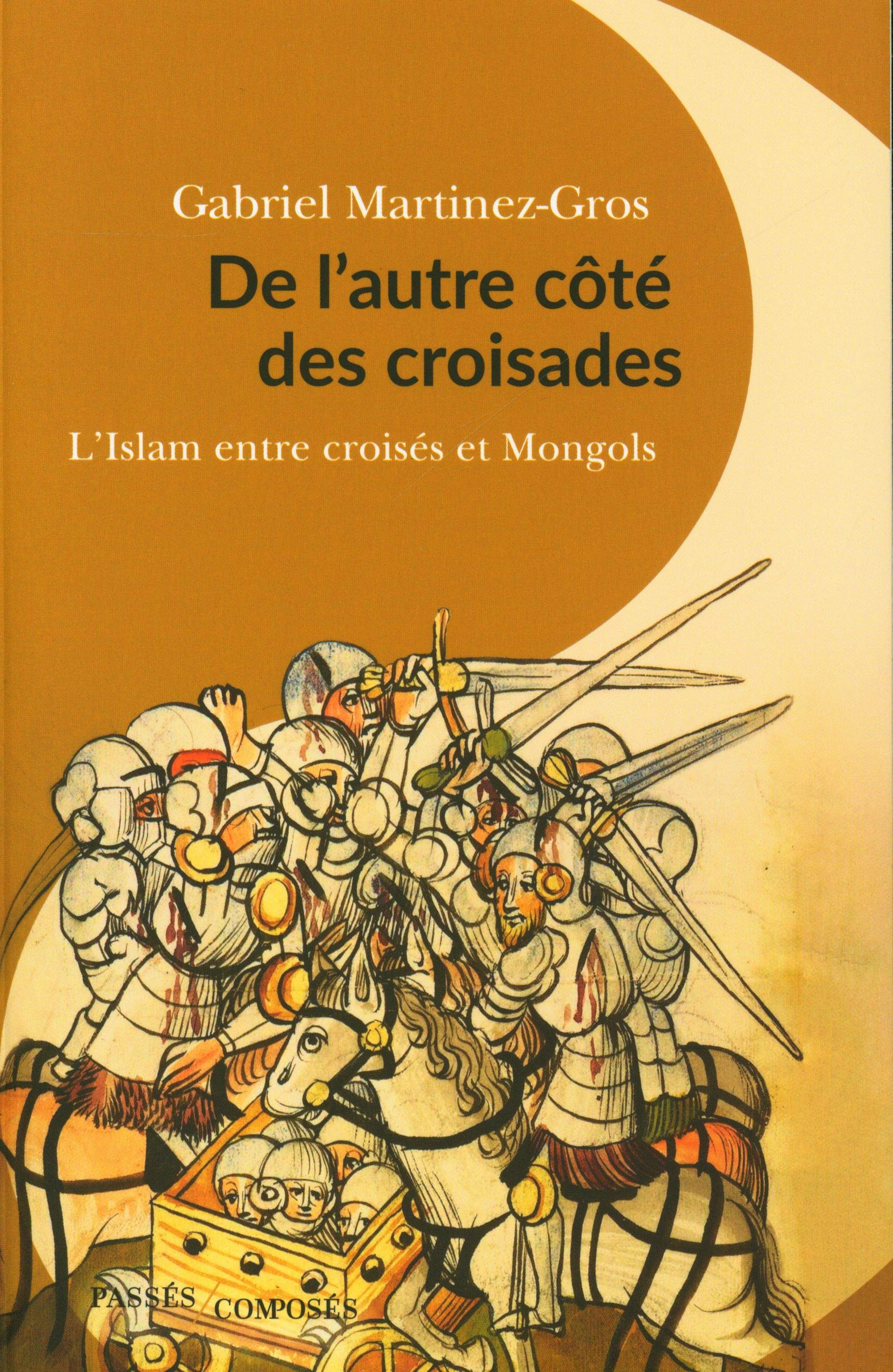
Dans son précédent livre, Gabriel Martinez-Gros, spécialiste de l’Islam médiéval, décryptait l’histoire des cinq premiers siècles de l’Empire islamique, de 632 jusqu’à l’émergence des sultanats turcs au XIe siècle en passant par les conquêtes, la mise en place du califat, l’éclosion et la chute des dynasties omeyyades, abbassides et fatimides (L’Empire islamique, VIIe-XIe siècle, Passés Composés, 2019, 336 p.). L’heure est venue pour lui de poursuivre son analyse un peu plus loin dans le temps et d’évoquer la période des croisades.
Si les Européens ont l’habitude de ne voir dans les croisades qu’un affrontement entre le christianisme et l’islam, une autre vision du conflit est possible. Martinez-Gros nous invite ici à décentrer notre regard et à considérer ces affrontements non plus à partir de l’Occident, mais depuis l’Orient. Pour les historiens arabes, ce que nous appelons les croisades entre dans le récit plus vaste de l’effondrement de l’Empire islamique à la suite de deux assauts conjugués. La grande offensive des Francs en Méditerranée ne constituant que l’une des deux mâchoires de la tenaille qui prend en étau l’Islam aux XIIe-XIIIe siècles. On sait qu’à partir du XIe siècle, l’Occident chrétien connaît une véritable expansion démographique, économique et culturelle, qui prend fin avec les famines précédant la grande peste. Au cours de cette période, la Reconquista ibérique et les croisades appartiennent à « un mouvement plus vaste encore […] de dilatation territoriale de l’Europe, qui porte les colons allemands ou flamands vers la Prusse, la Poméranie et la Courlande balte, et les colons anglais vers l’Irlande ».
L’autre mâchoire, de loin la plus redoutée, apparaît à l’Est avec les invasions mongoles. C’est ainsi à Bagdad que les Mongols vont frapper initialement. Toute la population de la ville sera massacrée, soit environ 100 000 habitants, alors même que la capitale n’a opposé aucune résistance aux envahisseurs. Les quelques témoins survivants feront état de pyramides de têtes coupées. La famille des califes abbassides, descendant du prophète et incarnant l’unité de l’Empire islamique, sera exterminée tout entière. En effet, à l’inverse des Turcs, les Mongols ne se convertissent pas à l’islam, car leur fascination ne se porte pas vers la civilisation musulmane, mais vers la Chine. L’auteur rappelle par ailleurs que la distinction essentielle entre les Turcs et les Mongols est justement constituée par cette conversion dans le cas des premiers.
La prise de Bagdad par les Mongols en 1258 fut ainsi la principale cause de l’effondrement de l’Empire islamique. Il se reconstitue, partiellement, au Caire qui devient au Moyen-Âge le centre de la culture du monde arabe. Face à cette « tenaille », cette double menace mentionnée plus haut, deux victoires presque concomitantes consacrent en effet l’Égypte comme la première puissance de l’Islam : la défaite, et la capture de Saint-Louis à La Mansura (1250), et la défaite des Mongols à Ayn Jalut (1260).
Comme le résume Martinez-Gros, « si l’on considère de plus haut les conséquences pour l’Islam des croisades et des invasions turco-mongoles, c’est d’abord ce naufrage de l’Irak et de son arrière-pays iranien, et la résistance victorieuse de l’Égypte qu’il faut en retenir. Après la destruction de Bagdad par les Mongols (1258), le passage en 1261-1262 du califat abbasside de la vallée du Tigre à celle du Nil fait du Caire l’Arche de Noé de l’Islam, la garde ultime de son héritage ballotté dans le déluge des invasions ».
Tout au long de son exposé, l’auteur oppose deux conceptions de l’histoire en tant que science, celle d’Ibn Khaldûn d’une part, celle du Syrien Ibn al-Athir (1160-1233) et de l’Italien Machiavel de l’autre. Le premier est par excellence l’historien des empires et met en évidence les lois qui régissent leur naissance et leur déclin. Pour comprendre Ibn al-Athir par contre, il faut lire Machiavel, car l’Italien et le Syrien vivent dans des mondes politiques comparables. Ibn Khaldûn sera ainsi le point de départ de la réflexion de l’auteur dans la première partie de l’ouvrage, divisée en quatre chapitres. Quant au second, Ibn al-Athir, il sera la source principale de la seconde partie subdivisée en trois chapitres.
Pour Ibn Khaldun, un empire c’est d’abord une réalité pacifique et désarmée. La civilisation repose sur le paiement de l’impôt qui permet la créativité et la croissance économique. Ibn Khaldûn insiste sur une distinction fondamentale, toujours actuelle, celle qui oppose les « sédentaires », que l’État doit protéger puisqu’il les a désarmés et leur a interdit de recourir à la violence, violence qu’ils pourraient tourner contre l’impôt, et les « bédouins », entendant par ce mot ceux qu’aucun État ne contrôle. C’est auprès de ces derniers que l’État sollicite la violence dont il a besoin pour intimider les « sédentaires », mais surtout pour les défendre contre les menaces extérieures. C’est ainsi que de petits contingents barbares prennent en charge les fonctions militaires et bientôt l’État. La force et la solidarité qui caractérisent les guerriers leur permettent alors de prendre leur revanche sur le plan politique. Ce faisant, les « bédouins » se sédentarisent en cédant à l’attrait de la civilisation, et rompent avec les solidarités traditionnelles du clan. Un nouveau cycle s’enclenche alors, ce qui explique la durée de vie nécessairement limitée des dynasties régnantes qu’Ibn Khaldûn estime à 120 ans : les dynasties de leurs fondateurs se consolident dans la première génération de leur existence, atteignent leur floraison dans la deuxième et agonisent dans la troisième.
Nous ne pouvons que saluer cette parution où grâce à une réflexion profondément originale, nourrie de ses précédents travaux sur la vie et la mort des empires, l’histoire de l’Islam et la pensée historique arabe, Gabriel Martinez-Gros nous propose une nouvelle lecture des croisades. Le livre comporte une chronologie, un lexique, un dictionnaire des personnages et des lieux, et un index. ♦







