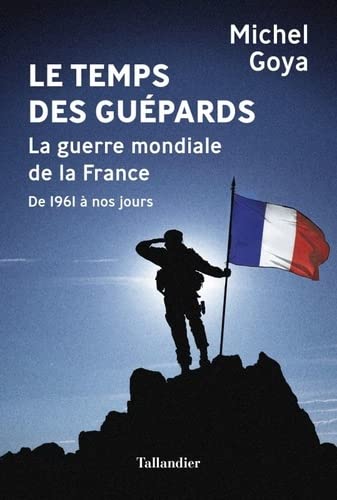
Le 23 novembre 1961, le général de Gaulle réunit à Strasbourg près de 5 000 officiers pour célébrer le dix-septième anniversaire de la libération de la ville. Le climat est lourd après une tentative avortée de putsch militaire à Alger. Tout en évoquant la fin des conflits de décolonisation, le général de Gaulle dessine le nouveau rôle des forces armées françaises « dans les conditions qui sont celles de notre temps » et dans le cadre de la « grande politique » qu’il compte mettre en œuvre pour que la France retrouve son rang. Dans ce contexte postcolonial, il s’agit pour la France d’assurer son rang international en même temps que sa sécurité et son indépendance. Cette autonomisation militaire s’accompagne d’une autonomisation diplomatique à l’égard des États-Unis et vers une Europe des Six qui se doterait d’une personnalité en matière de défense sous leadership français. Ce grand dessein gaullien a suscité finalement moins de transformations qu’espéré, les autres États, ouest européens, préférant dépendre du protecteur américain. A-t-on beaucoup progressé depuis soixante ans ? Telle est l’une des graves questions auxquelles Michel Goya répond avec force.
La « voie française » évolue dans un cadre étroit entre défense des intérêts propres avec ses seuls moyens, promotion d’une entité militaire européenne avec des partenaires réticents et pacifistes, et besoin d’en passer par les États-Unis, dès qu’il est question de guerre majeure. C’est dans ce cadre que l’on réorganise les forces armées pour faire face à ce que le général de Gaulle décrit à Strasbourg comme un « bloc totalitaire ambitieux de dominer et brandissant un terrible armement » (1). L’Union soviétique dispose du feu thermonucléaire et des moyens de le lancer en quelques minutes sur la France, une menace unique dans toute son histoire et qui doit amener une réponse unique.
Le premier axe d’effort militaire de la Ve République, une fois la guerre d’Algérie terminée, consistera à disposer des moyens permettant de dissuader l’Union soviétique de se lancer dans une guerre en Europe, au pire d’envahir ou de ravager le territoire national. Dans la continuité des travaux entamés sous la IVe République, ces moyens seront d’abord nucléaires avec la capacité de frapper à son tour n’importe quel territoire avec la force de frappe française, mais aussi conventionnels avec une force importante dans le nord de la France et dans l’ancienne zone d’occupation en Allemagne, à Berlin-Ouest et au sud-ouest de la République fédérale allemande. Tous ces moyens sont désormais associés à ceux des Alliés et non intégrés depuis la sortie de l’Otan en 1966 avec l’intention, non pas de gagner la guerre contre l’Union soviétique, ce que l’on ne croit pas possible, mais de l’empêcher ou de la limiter au maximum.
La particularité française est, qu’au contraire des autres puissances coloniales qui se sont désengagées militairement de l’Afrique ou ne vont pas tarder à le faire, la France y reste très présente par l’intermédiaire d’une série d’accords de défense bilatéraux, signés entre 1960 et 1962. Ce que le président ivoirien Houphouët-Boigny a baptisé la « Françafrique » est clairement une forme de protectorat consenti par les gouvernements locaux, dont un noyau dur fidèle, Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon et Djibouti. Pour ces États, l’alliance militaire française, c’est l’assurance de la protection contre les menaces étrangères et du soutien à la stabilité intérieure. Pour la France, c’est, avec l’arme nucléaire et toujours dans le cadre de la « grande politique » gaullienne, un surcroît d’audience sur la scène internationale. Comme la France s’interdit de faire combattre les soldats appelés au-delà de la défense de ses frontières, ses forces sont réduites, car on n’imagine pas avoir à mener autre chose que des interventions très ponctuelles. On se trouve ainsi avec un modèle de forces correspondant à deux hypothèses d’emploi parfaitement opposées : d’un côté le scénario d’une guerre apocalyptique dont on espère réduire au maximum la probabilité et, de l’autre, des engagements réduits très probables, mais lointains. Il en résulte que la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies se doit d’intervenir autant que possible dans les affaires du monde. Or, dans le cadre des institutions de la Ve République, il est facile de le faire. Il suffit que le président de la République le décide en Conseil de défense.
Ainsi en soixante ans, les soldats français ont été engagés dans 32 grandes expéditions, guerres, confrontations et opérations de police internationale et une centaine d’opérations de plus petite ampleur. En valeur absolue, ce nombre est seulement inférieur à celui des forces armées américaines durant la même époque. Mais, appliqué à un volume de forces bien moindre, il fait des soldats français les plus sollicités au monde, sautant en permanence d’un point à l’autre du globe dans une sorte de guerre mondiale en miettes au service des intérêts de la France et de son statut de puissance. Le paradoxe est que cette guerre mondiale de la France, que démontre avec éloquence Michel Goya, paraît très peu connue de la nation, peu consultée sur ces engagements lointains, souvent limités en volume et par ailleurs longtemps assez peu couverts par les médias. La France a été engagée dans une petite guerre permanente depuis soixante ans et les citoyens français se croient en paix, au moins jusqu’à ce qu’ils soient eux-mêmes attaqués sur le territoire national par des attentats terroristes.
C’est l’histoire de cette guerre mondiale de faible intensité de la France qui est décrite pour la première fois. Michel Goya privilégie à juste titre l’échelle de l’opération, c’est-à-dire de la campagne militaire sur un théâtre d’engagement donné, entre le niveau stratégique au-dessus où se décident les orientations politiques et en dessous le niveau tactique des engagements ponctuels sur le terrain. Ceux-ci mériteraient pourtant une analyse fouillée, ne serait-ce que pour des raisons de formation et pédagogiques, car l’art français de la guerre est aussi un instrument d’influence. Ces campagnes correspondent aux deux emplois possibles du monopole de la force : la guerre et la police, ce que distingue d’ailleurs l’ONU dans ses différentes opérations de maintien de la paix (OMP). La différence entre les deux est la présence ou non d’un ennemi déclaré, c’est-à-dire une autre entité politique désignée nommément comme adversaire et donc en France désignée par le président de la République. C’est bien cette désignation précise et cette déclaration qui, de tout temps, ont défini la guerre : cet affrontement violent où l’on s’efforce d’imposer sa volonté à l’autre (imposition ou rétablissement de la paix). Dans les autres cas, il s’agit de maintenir ou de rétablir l’ordre et la sécurité (OMP) face à des contrevenants ponctuels à cet ordre, qui sont désormais des groupes non étatiques, bandes, mouvements, etc. On ne dialogue pas normalement avec ces contrevenants, on les empêche de nuire.
L’emploi de la force, désormais de type policier, y est très différent de celui de la guerre classique. On verra que les circonstances vont souvent s’efforcer de brouiller les limites entre ces deux emplois possibles. On affrontera des États, mais sans vouloir dépasser le seuil de la guerre ouverte. On affrontera surtout des organisations armées, mais souvent sans leur accorder le statut d’ennemi, car ce serait avouer la guerre – un mot qui fait peur – et parce que l’on considère que ces groupes ne méritent pas ce statut. On saura gré à Michel Goya d’indiquer que sur les 32 grandes opérations, ou campagnes, menées, on peut considérer que 19 à ce jour relèvent de la guerre tandis que 13 relèvent de la police internationale. Bien sûr, chaque catégorie comprend plusieurs modes opératoires : intervention ponctuelle, campagne de pression, campagne de conquête ou encore confrontation sous le seuil de la guerre ouverte dans le cas des guerres ; engagement humanitaire armé, interposition ou sécurisation des populations dans le second cas, que l’on appelle désormais de manière générique « stabilisation ». Le choix des formes de la campagne et des modes opératoires utilisés dépend beaucoup du contexte international du moment.
On peut ainsi distinguer, de la fin de la guerre d’Algérie en juillet 1962 à aujourd’hui, trois grandes périodes stratégiques. Guerre froide, époque de la suprématie américaine et l’actuelle qui a commencé au tournant de l’année 2000. Il n’est alors question pour la France que de participer à la police internationale, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que les organisations armées, en particulier salafo-djihadistes, sont devenues des acteurs majeurs de la scène internationale puisque des États autres qu’occidentaux sont à nouveau capables de politiques de puissance auxquelles il faut se confronter. Durant la guerre froide, la quasi-totalité des opérations militaires françaises se déroulent en Afrique et au Proche-Orient. L’année 1979 marque alors une première inflexion avec, pour des raisons essentiellement idéologiques, le refus désormais d’intervenir directement et au combat en première ligne contre les adversaires de nos alliés. C’est le début de la longue époque du « soldat de la paix ». Les interventions indirectes qui caractérisent la double présidence de François Mitterrand. C’est également l’époque, dans les années 1980, des premières confrontations sous le seuil de la guerre ouverte contre d’autres États : l’Iran et la Libye. La fin de la guerre froide entre 1989 et 1991, et dans l’immédiat la nécessité d’avoir à mener au loin une guerre contre l’Irak met à bas d’un seul coup toute la vision que l’on avait de l’emploi des forces armées. Toutes les hypothèses sont à revoir dans ce nouveau cadre unipolaire et mondialisé. On espère beaucoup dans un premier temps participer à l’apaisement du monde dans le cadre des opérations dirigées par les Nations unies avant de déchanter, en particulier en ex-Yougoslavie. On s’efforce alors de trouver une autre voie entre guerres contre les États voyous et opérations de stabilisation, dans les Balkans d’abord qui servent de laboratoire à la gestion des crises dans ce « nouvel ordre mondial », puis en Afrique subsaharienne.
Tout change finalement à l’orée du nouveau siècle alors que l’on s’aperçoit que les organisations armées sont les acteurs militaires qui ont le plus profité des flux de la mondialisation – idées, armes, financements occultes – alors que les États avaient eu plutôt tendance à s’affaiblir. Parmi ces groupes, les organisations salafo-djihadistes s’avèrent des adversaires redoutables qui polarisent l’attention après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Sous la pression des événements, la politique française bascule en 2008 dans cette nouvelle ère stratégique en s’engageant pleinement en guerre en Afghanistan pendant quatre ans. Parallèlement, du retournement d’attitude en Côte d’Ivoire en 2010, en passant de l’interposition à l’appui militaire à un camp, aux déconvenues de l’intervention de stabilisation en Centrafrique en 2013 en passant par une dernière guerre en coalition contre un État voyou en Libye, on solde les pratiques du nouvel ordre mondial. Après l’Afghanistan, la France s’engage alors pleinement dans la guerre, au Sahel d’abord contre Al-Qaïda, au Maghreb islamique et ses alliés puis au Levant contre l’État islamique. La France est désormais en guerre ouverte de manière ininterrompue depuis treize ans. C’est un affrontement dont on ne voit pas encore la fin, alors même qu’une nouvelle forme de guerre froide, multipolaire cette fois, s’est installée par ailleurs.
Le chef d’état-major des Armées, ancien de la Légion, Thierry Burkhard, général respecté à l’épaisse expérience opérationnelle, développe sa vision stratégique qui est tournée vers les conflits de demain, qu’il prédit plus durs et plus complexes. Il faut réinventer de nouvelles formes d’action, conclut Michel Goya, qui prennent en compte nos ambitions et nos moyens comptés. Là réside la question. Pour y parvenir, il faudrait avoir une structure consacrée à la mobilisation des forces. En 1991, les trois armées et le Service de santé pouvaient être renforcés en quelques jours de 420 000 réservistes formés et équipés, dont une grande partie en unités complètes. Il n’y en avait plus en 2019 que 33 000, dont un millier utilisé chaque jour pour effectuer des renforts individuels. Au début des années 1990, il y avait trois régiments médicaux dans l’Armée de terre, dont un de réserve. En 2020, il n’en restait plus qu’un seul pour faire face à la pandémie du coronavirus. À titre de comparaison, là encore si la France faisait le même effort que les États-Unis pour les réserves et la Garde nationale, elle dépenserait 2,8 milliards d’euros par an et non une centaine de millions. ♦







