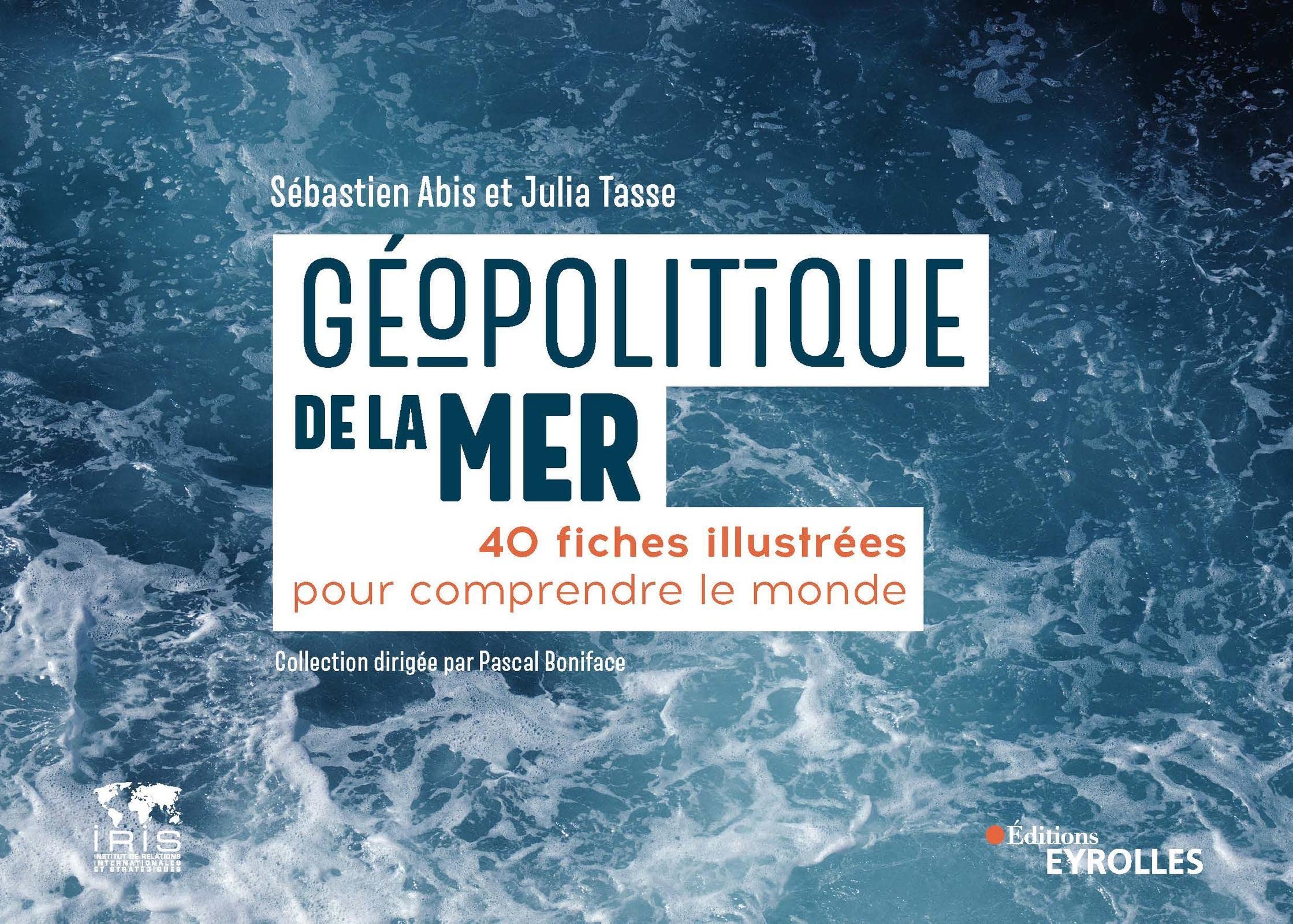
La géopolitique des espaces maritimes est l’étude des océans et des mers en tant que territoires dominés, partagés ou disputés par les États pour des questions de prestige, de domination ou d’exploitation économique. Les espaces maritimes couvrent 71 % de la Terre, soit 361 millions de km2, et constituent le plus vaste des écosystèmes de la planète. C’est le poumon du monde : la moitié de l’oxygène terrestre est produite par le plancton océanique et le quart des émissions de CO2 que nous produisons est aujourd’hui absorbé par la mer. Depuis 1950, l’océan a déjà absorbé plus de 90 % de l’excès de chaleur, ce qui, outre son réchauffement, se traduit par une acidification croissante avec toutes les conséquences que cela entraîne sur les pêcheries, le climat, les courants marins. La montée du niveau des mers, passée d’un taux moyen de 3 à 4 millimètres à 5 ou 6 millimètres par an finira par submerger de nombreuses populations, ce qui provoquera des millions de réfugiés climatiques.
Les espaces marins sont depuis des millénaires des lieux de circulation, de contact, d’échanges et de conflit. Mais avec la mondialisation due aux révolutions technologiques et à l’ouverture des frontières au libre-échange, et avec la découverte et l’exploitation croissante des ressources océaniques, dans le cadre d’un monde multipolaire, les espaces maritimes sont plus que jamais au cœur des convoitises et des jeux de puissance. La géopolitique des espaces maritimes est un sujet d’étude relativement récent en France. Le premier ouvrage paru à ce sujet semble être Le Sixième continent, géopolitique des océans de Pierre Papon en 1996. Depuis cette date, d’autres études ont été publiées, mais le sujet reste en marge des ouvrages des géopolitologues populaires (Yves Lacoste, Pascal Boniface ou Jean-Christophe Victor). Il convient donc de saluer ce petit ouvrage clair et dense qui couvre un éventail très large de questions tout en jetant un regard sur l’avenir.
Dans cet espace commun qu’est l’océan, les Nations unies sont en train de finaliser un traité sur la haute mer, c’est-à-dire la zone au-delà des 200 milles qui constituent les ZEE, les tensions s’entremêlent et les risques se renforcent. Les puissances traditionnelles ou nouvelles rivalisent sur et sous l’eau. D’ores et déjà la Chine détient plus de sous-marins militaires (79) que les États-Unis (68) et la Russie (64). Mais sait-on que l’Iran (29), la Turquie (12) en possèdent plus que le Royaume-Uni (11) ou la France (10), mais seules ces dernières, comme les trois grands possèdent des SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d’engin. Pour le moment, il existe sept bases de rattachement des SNLE dans le monde (2 aux États-Unis et en Russie, 1 au Royaume-Uni, en France et en Chine, et 1 autre est en construction en Inde à Andhra dans le Pradesh. Les canaux ont toujours été au centre des enjeux, mais leur nombre a peu varié. Le projet chinois de creuser un canal au Nicaragua, long de 276 kilomètres, n’a pas vu le jour, et il en est de même du projet mort-né de celui de Kra en Thaïlande dont le projet remonte au XVIIIe siècle. Désormais, du fait de la poldérisation des îlots de la mer de Chine méridionale, une politique poursuivie avec opiniâtreté par la Chine, ce sont les îles qui sont devenues un des objets de préoccupation principale. 460 000 îles sont référencées par une base de données constituée par le programme des Nations unies pour l’environnement et l’Institut de recherche pour le développement, afin de faciliter la protection de ces milieux particuliers.
L’île est un lieu séparé, à l’écart. Dans l’œuvre du géographe Joël Bonnemaison, « l’île se meut dans une autre dimension de l’espace-temps, c’est un lieu nu qui se tient seul et dont les liens naturels avec le reste du monde ont été coupés ». Pour Eurostat, chargé de l’information statistique à l’échelle communautaire au sein de la direction générale de la Commission européenne, une île est une terre d’au moins 1 km2 de superficie, habitée en permanence par une population statistiquement significative (supérieure ou égale à 50 habitants), non reliée au continent par des dispositifs permanents, séparée du continent européen par une étendue d’eau d’au moins 1 km de large. Comme le reconnaît l’organisme, ces limites statistiques peuvent évidemment parfois ne pas répondre aux réalités du terrain, mais cette « définition a l’avantage d’exister ».
Les États insulaires n’ont fait leur entrée en tant que tels sur la scène géopolitique internationale que depuis les années 1950. Auparavant, ces espaces étaient englobés dans des ensembles à dominante continentale. L’admission de l’Islande à l’ONU en 1946 a marqué un tournant décisif dans la création d’une nouvelle classe d’États insulaires.La représentation de ces micro-États dans les organisations internationales pose question : tous les États souverains peuvent siéger à l’ONU, y compris le Liechtenstein (37 000 habitants), Monaco (38 000), Andorre (76 900), avec une voix équivalente à celle d’États beaucoup plus peuplés. En 1992, les petits États insulaires en développement (PEID) sont reconnus comme un groupe spécifique au sein de l’ONU. Bien que l’ensemble de leurs populations dépasse à peine les 50 millions d’habitants, la règle onusienne qui veut que chaque État-membre compte pour une voix, quel que soit son poids démographique, s’applique. Les voix des PEID représentent un enjeu de négociation à part entière, ces États marchandant parfois leurs votes et leurs alliances, tels le Tuvalu ou encore Nauru qui ont récemment reconnu l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, deux territoires géorgiens occupés illégalement par l’armée russe.
Grand pays maritime, fort de la deuxième ZEE du monde (10,2 millions de km2), dont 97 % situés en outre-mer, la France compte 18 000 kilomètres de côtes. C’est désormais vers l’Indo-Pacifique que se situe l’avenir maritime de la France en dépit des déboires qu’elle a subis du fait de l’annulation en septembre 2021 du contrat du siècle des sous-marins australiens et de la création de l’AUKUS. Elle y est présente avec ses départements ou régions français d’outre-mer et communautés d’outre-mer, qui représentent une population totale de 1,65 million d’habitants ; 93 % de la zone économique exclusive française est située dans les océans Indien et Pacifique. Par ailleurs, on compte dans les pays de la zone environ 150 000 Français résidents, plus de 7 000 filiales d’entreprises implantées et 8 300 militaires en mission au sein de forces prépositionnées (Djibouti compris). L’Indo-Pacifique s’impose de plus en plus comme l’espace stratégique du XXIe siècle.
La montée en puissance de la Chine a bouleversé les équilibres traditionnels. Alors qu’un certain nombre de menaces persistent (prolifération nucléaire, criminalité transnationale organisée, terrorisme djihadiste, piraterie, pêche illicite…), la compétition sino-américaine s’intensifie et génère de nouvelles tensions. L’importance de ces enjeux, qui affectent directement la prospérité et la sécurité de la France et des pays de l’Union européenne, renforce la pertinence d’une approche cohérente et structurée. L’Indo-Pacifique est devenu un des axes prioritaires de l’action internationale de la France. Dans son discours prononcé sur la base navale de Garden Island (Sydney, Australie) le 2 mai 2018, le président de la République a exposé la stratégie française pour l’Indo-Pacifique, et son ambition de promouvoir une approche inclusive et stabilisatrice, fondée sur la règle de droit et le refus de toute forme d’hégémonie. La région Indo-Pacifique, au centre d’une concurrence géopolitique qui s’intensifie dans les domaines du commerce notamment, a vu sa part dans les dépenses militaires mondiales passer de 20 % en 2009 à 28 % en 2019. La Commission européenne définit la région Indo-Pacifique comme « une zone qui s’étend de la côte Est de l’Afrique aux États insulaires du Pacifique ». Les routes maritimes majeures qui traversent cette région, comme le détroit de Malacca ou la mer de Chine méridionale, sont d’une importance capitale pour les échanges commerciaux de l’UE. Comptant sept membres du G20 (Afrique du Sud, Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie et Japon), cette zone Indo-Pacifique est devenue le moteur de la croissance mondiale et représente aujourd’hui 60 % du PIB mondial.
Bien d’autres questions sont abordées par les auteurs pour lesquels la mer peut être cruelle, fascinante et impénétrable. ♦







