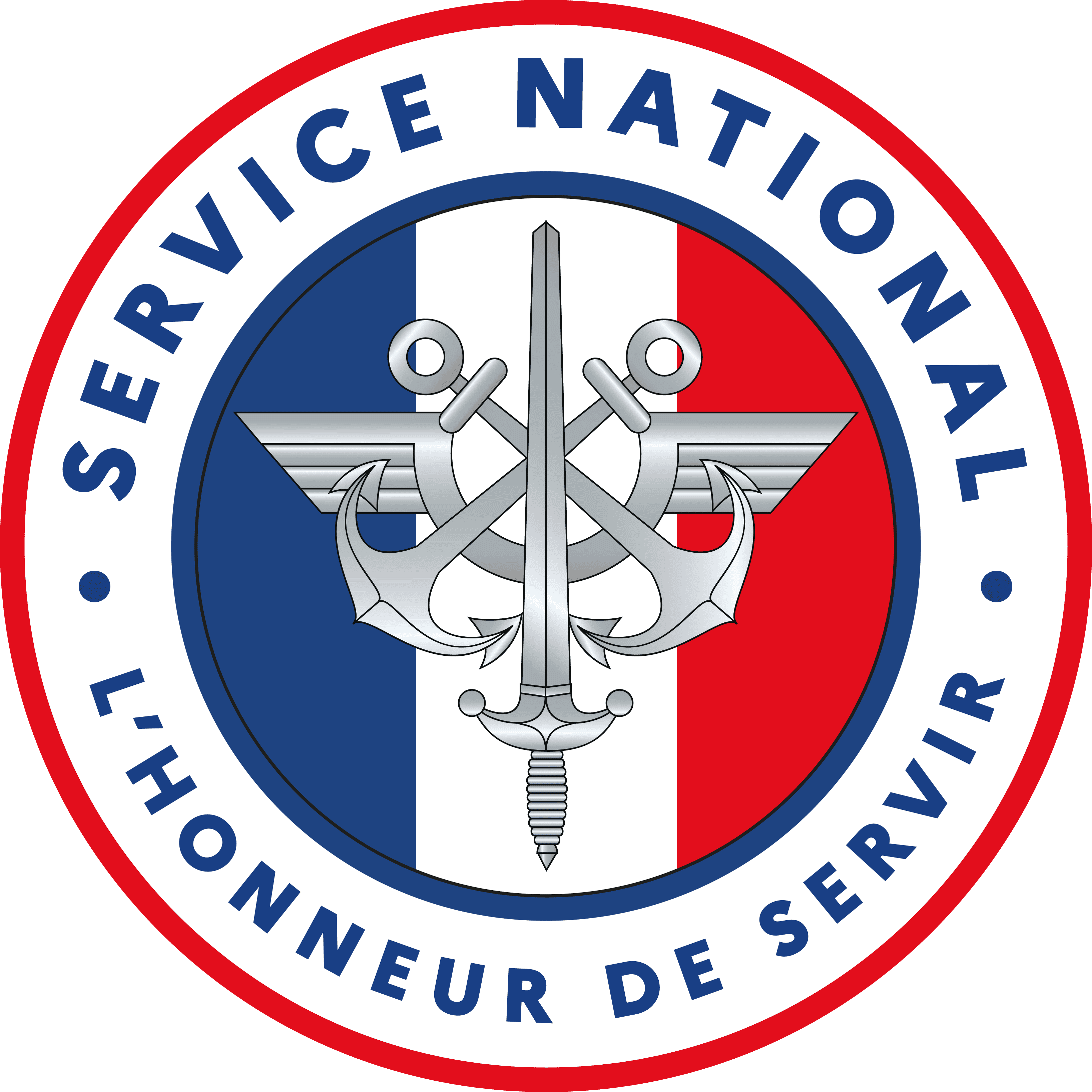Institutions internationales - Le dixième anniversaire de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) - Affrontement aux réalités européennes - L'Otan et Berlin - Réapparition du problème de Trieste
L’année 1970 s’est terminée dans le calme, du moins pour les institutions internationales. L’Assemblée générale des Nations unies s’est séparée dans l’habituel climat de désenchantement, en insistant toutefois plus nettement que les années précédentes sur les difficultés financières de l’Organisation. Soulagés de ne pas avoir eu à s’occuper du problème de Trieste, brusquement réapparu dans l’actualité, et plus encore du nouveau drame polonais, ni des procès de Burgos et de Leningrad, les responsables des Nations unies ont pu étudier loin des bruits et des soucis du monde des rapports sur la situation en Guinée, sur la protection des journalistes, sur le problème des otages. Mais si les Nations unies ont terminé 1970 dans ce calme, d’autres organisations internationales se sont trouvées au cœur de certains des grands problèmes du moment.
Le 10e anniversaire de l’OCDE
Le 14 décembre 1970 a été célébré le 10e anniversaire de l’OCDE – Organisation de coopération et de développement économique – à Paris, en présence du président de la République Georges Pompidou. En dépit de son activité (et de son utilité), cette institution est probablement l’une des plus mal connues, sans doute à cause du caractère très technique de ses travaux, conduits par des experts hautement qualifiés.
Elle est sinon la fille, du moins la proche parente de l’OECE – Organisation européenne de coopération économique. Celle-ci avait été créée le 16 avril 1948 pour permettre le relèvement économique de l’Europe par une utilisation coordonnée de l’« aide Marshall ». En proposant l’aide des États-Unis aux États européens sans distinction de régime (1), le général Marshall avait, le 5 juin 1947, précisé qu’il appartiendrait aux bénéficiaires de cette aide de s’entendre pour sa répartition et son utilisation. Une organisation était nécessaire, ce fut l’OECE, qui groupait seize États, auxquels se joignirent par la suite l’Allemagne fédérale (RFA) et l’Espagne, cependant qu’à partir de 1955, la Yougoslavie y fut représentée (2). Son rôle originel était la répartition de l’aide américaine accordée par le « Plan Marshall » : celle-ci devait être répartie en fonction d’un programme de relèvement établi par les bénéficiaires eux-mêmes. Elle avait, en outre, pour tâche de préparer la libération des échanges, et à cet effet elle établit, en juillet 1951, un « Code de libération des échanges », puis un « Code de libération des transactions invisibles » et un « Code de libération des capitaux ». En troisième lieu, elle organisa entre ses membres un système multilatéral de paiements, dont la gestion incombait à l’Union européenne des paiements (qui fut, en 1959, remplacée par l’« Accord monétaire européen »). Enfin, par ses « comités techniques », l’OECE organisa une coopération dans les domaines les plus divers de l’activité économique des États-membres : agriculture, énergie, main-d’œuvre, productivité, etc. C’est elle, par exemple, qui créa l’Agence européenne de l’énergie atomique et l’Agence européenne de productivité.
Il reste 84 % de l'article à lire
Plan de l'article