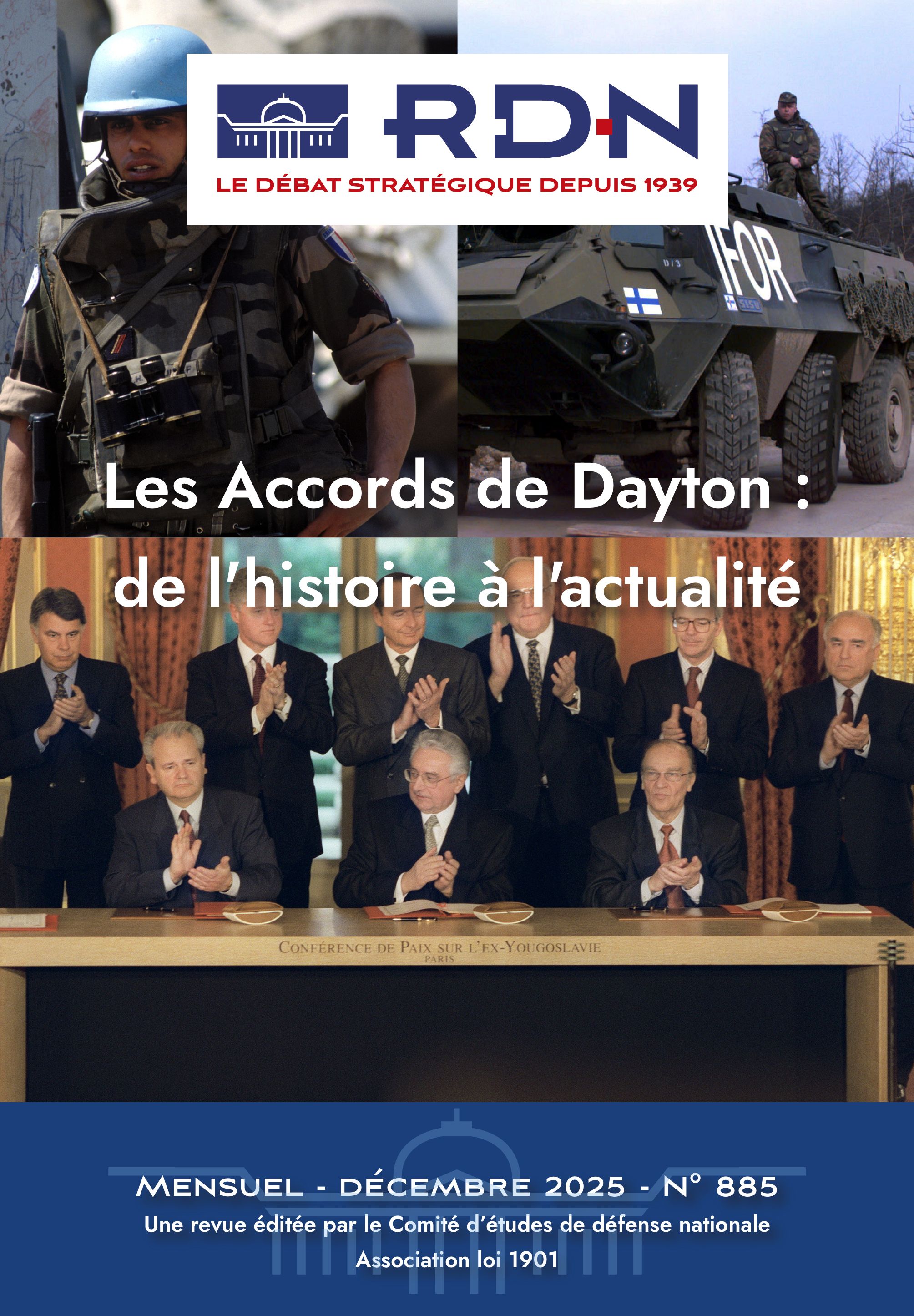Outre-mer - Angola : situation politique au seuil de l'année 1972 - Soudan : le général Nemeiry, maître du Soudan, négocie avec la rébellion du Sud
Après une année de calme relatif, la reprise des activités rebelles dans le Sud de l’Angola coïncidant avec les troubles qui affectent l’ethnie Ovambo dans le Sud-Ouest africain, marque la volonté des populations noires d’Afrique australe de se libérer d’un héritage colonial aussi lourd que lointain. La conquête de l’Angola remonte au XVIe siècle et dès 1700 le pays était organisé en colonie ; celle-ci n’évoluait guère pendant deux siècles et demi et végétait dans la stagnation économique, l’analphabétisme et la ségrégation.
Les Portugais se sont toujours réclamés d’une ancienne doctrine basée sur le principe de l’assimilation. En réalité, l’antiracisme portugais, défini théoriquement par l’ordonnance royale de 1757, n’a jamais été qu’un leurre. Déjà la constitution de 1838 assimilait le Noir libre au citoyen portugais mais le baptême et un certain degré d’instruction constituaient une condition préalable à l’affranchissement. C’est ainsi que, malgré l’abolition de l’esclavage dans le pays, en 1888, l’existence d’un indigénat incapable d’accéder aux postes de responsabilité exigeant une culture, favorisa, dans les faits sinon dans la loi, une discrimination qui existe encore de nos jours.
Les Noirs, théoriquement égaux des Blancs, sont maintenus, sur le plan de l’emploi et de la rémunération, en état d’infériorité ; dans les villes, ils constituent un prolétariat misérable où sévit la délinquance. Le métissage, caractéristique des précédentes vagues de colonisation, est devenu rare. Les différences de classe et de race qui séparent les populations blanche et noire sont peut-être plus marquées en Angola qu’en Afrique du Sud. Le fossé se creuse et s’élargit, éloignant toujours davantage les deux communautés et exacerbant les antagonismes.
Il reste 90 % de l'article à lire
Plan de l'article