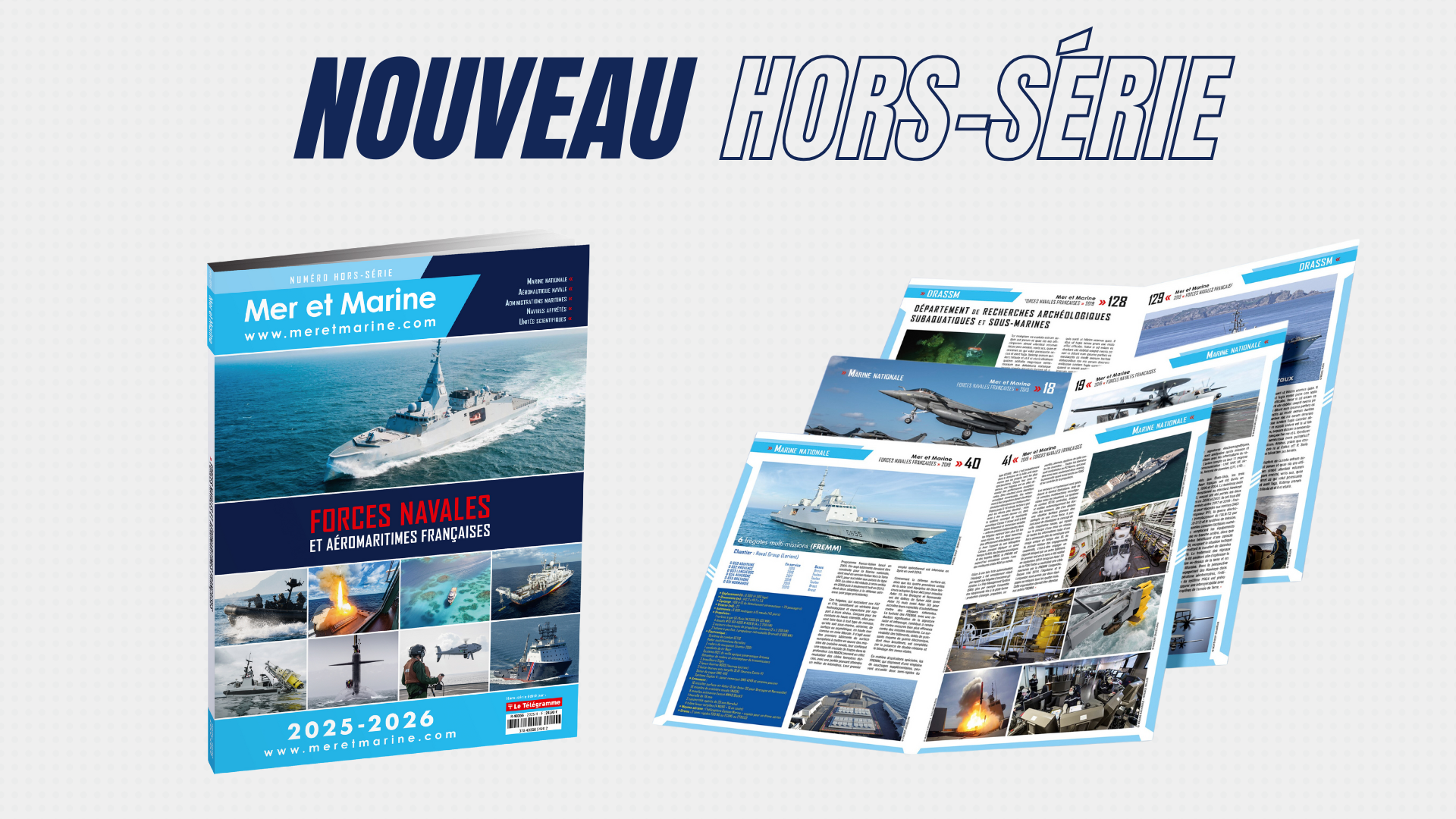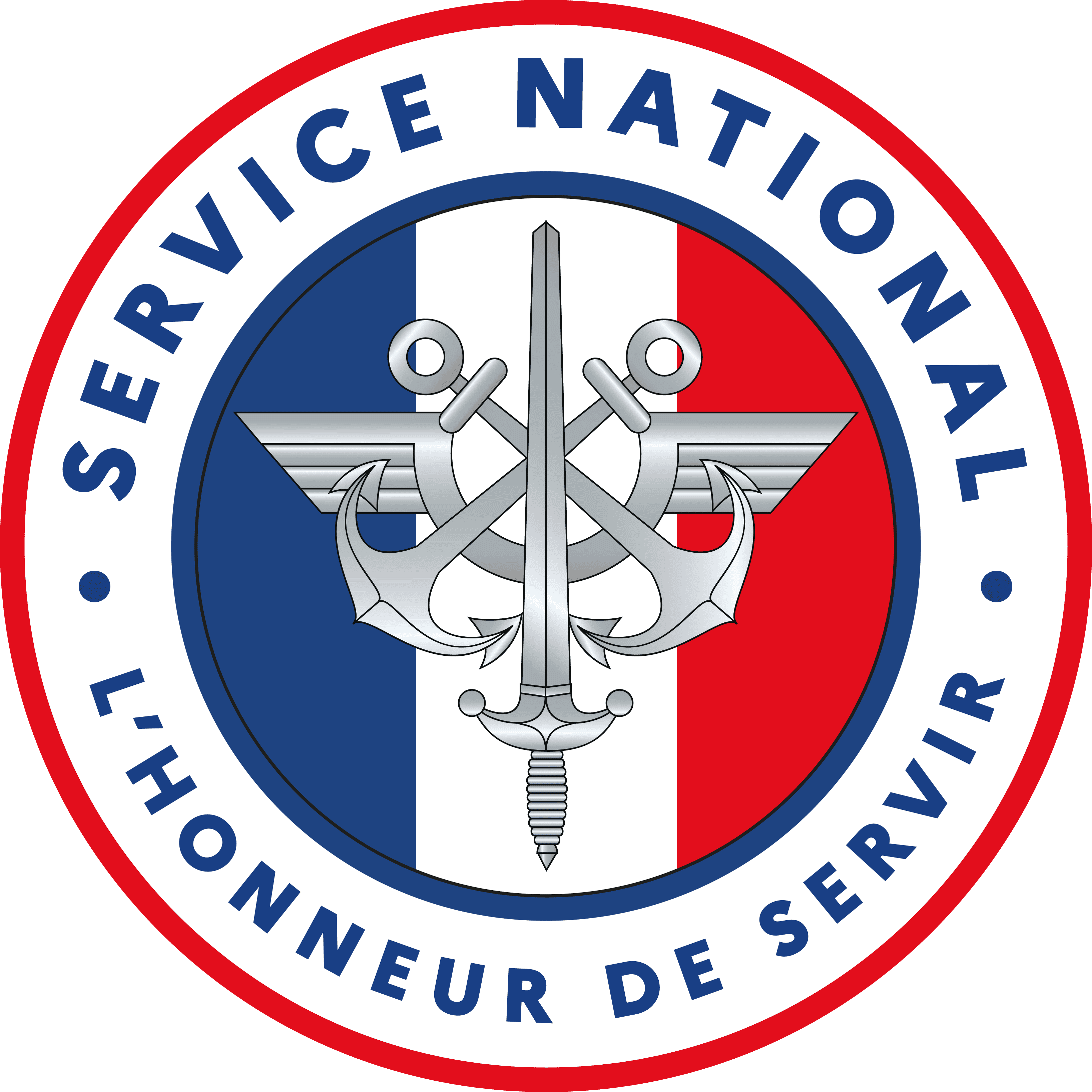Institutions internationales - Les limites de la « Justice internationale » - Une seule voix pour l'Europe ? - Les dix ans de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) - Le Droit de la Mer - Le Comité international de la Croix-Rouge : crise ou mutation ?
Les rencontres Pompidou-Heath, Nixon-Brandt, Brejnev-Brandt, Pompidou-Nixon, etc. sans parler des entretiens Nixon-Brejnev qui, au début du mois de juin 1973, restaient inscrits au calendrier diplomatique en dépit de certaines tensions intérieures américaines, l’éventualité d’un second voyage du président américain Richard Nixon en Chine, etc., ces entretiens de chefs d’État illustrent l’une des modifications fondamentales de la diplomatie. Il y a quelques dizaines d’années encore, les nouvelles ne se répandaient qu’avec retard, et l’on comprenait qu’il avait fallu deux mois pour que Paris apprit la mort de Napoléon ou la bataille de Fachoda. Aujourd’hui, le développement des moyens d’information et de transmission fait qu’un événement est, dans les heures qui le suivent, connu de tous les pays qui sont suffisamment développés pour disposer d’un réseau de réception, et en tout état de cause de tous les gouvernements. L’institution diplomatique bénéficie de ce progrès des moyens de connaissance, mais on peut se demander si le rôle des ambassadeurs ne s’est pas profondément modifié, s’il ne se situe pas plus au plan de l’explication et du commentaire qu’à celui de l’information. Par ailleurs, les facilités des communications permettent aux chefs d’État de se rencontrer bien plus facilement qu’auparavant. Tout chef d’État est aujourd’hui un grand voyageur. Ceci n’est pas étranger au thème général de cette chronique. Deux phénomènes se superposent : la personnalisation du pouvoir, l’importance des institutions internationales. Un exemple illustre spectaculairement cette superposition. Ce que l’on a appelé le « Nixon round » [NDLR 2023 : 7e session de l’accord général sur les droits de douane et le commerce (GATT) de 1973 à 1979] devait théoriquement, comme le « Kennedy round » [NDLR 2023 : 6e session du GATT de 1964 à 1967], se dérouler dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Puis les questions commerciales se sont révélées dans leur véritable nature, celle d’un simple paramètre, et les questions monétaires, militaires et finalement politiques se sont imposées. Du niveau d’une institution internationale, la confrontation s’est, très vite, située au plan des responsables politiques, c’est-à-dire des chefs d’État ou de gouvernement. Il n’y a pas dessaisissement des institutions internationales, mais retour aux autorités nationales des décisions les plus importantes.
La situation se trouve compliquée par le fait que chacun des deux super-grands – les signataires de l’accord du 26 mai 1972 sur la limitation de certains armements stratégiques – ne peut se contenter des garanties provisoires que lui apporte cette bipolarité militaire, et doit œuvrer dans une multipolarité politique où la puissance de ses armes n’est pas l’argument majeur.
Les limites de la « justice internationale »
Ce dessaisissement de facto des institutions internationales a eu une expression juridique avec la décision du gouvernement français de ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de Justice dans l’affaire ouverte par les plaintes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Cette décision a soulevé certaines passions, alors qu’elle se pose en termes relativement simples.
Il reste 90 % de l'article à lire
Plan de l'article