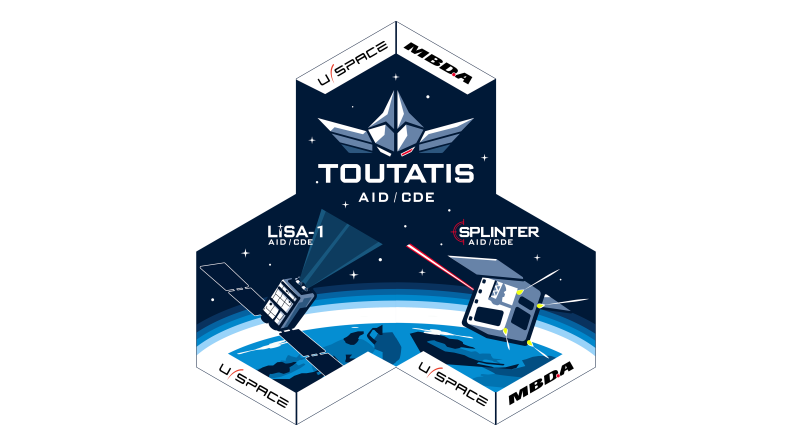Outre-mer - Le onzième « Sommet » de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) - Les élections aux assemblées départementales algériennes
Le onzième « sommet » de l’Organisation de l’unité africaine s’est tenu à Mogadiscio du 12 au 17 juin 1974. La capitale somalienne avait été choisie comme siège de cette conférence lors de la réunion précédente qui, exceptionnellement, avait eu lieu à Addis Abeba, pour célébrer le 10e anniversaire de l’Organisation à l’endroit même où elle avait été créée.
En 1973, malgré les festivités, de durs débats oratoires avaient opposé les Éthiopiens aux Libyens et aux Somaliens ; le représentant de Tripoli reprochait à Addis Abeba son attitude ambiguë à l’égard du problème israélo-arabe et trouvait inadmissible que le secrétariat général de l’OUA fût installé dans un pays qui n’avait pas rompu avec Tel Aviv ; par ailleurs, les Éthiopiens et les Somaliens s’accusaient mutuellement de préparer la guerre pour résoudre leur contentieux frontalier. Une commission de l’OUA devait régler ce dernier litige et Mogadiscio avait été choisie comme siège de la prochaine conférence au sommet afin d’apaiser les susceptibilités somaliennes. Depuis lors, le différend somalo-éthiopien a cessé d’être prioritaire : agissant avec sagesse, la commission continue avec sérénité ses travaux et laisse le temps apaiser les passions. D’ailleurs, l’évolution de la situation en Afrique et dans le monde, qui contribue à renforcer l’unité africaine, assigne aux dirigeants de l’OUA des tâches plus urgentes : à l’exception du Malawi, les États du continent ont rompu avec Israël après le conflit israélo-arabe d’octobre 1973 ; la solidarité arabo-africaine a paru se concrétiser lors de la crise du pétrole puis durant le débat de l’ONU sur les matières premières ; d’un autre côté, l’Éthiopie se relève difficilement d’une crise de régime dont ses voisins n’ont pas intérêt à accentuer le caractère nationaliste ; enfin, le renversement du pouvoir salazariste à Lisbonne est considéré par toute l’Afrique comme une victoire éclatante de l’OUA et comme le prélude de la décolonisation totale du continent. En présence de telles perspectives, les litiges entre États-membres prennent évidemment une importance secondaire.
Les principaux débats auraient dû porter, dans ces conditions, sur l’attitude à adopter à l’égard du nouveau gouvernement portugais, qui s’efforce de trouver une solution au problème de ses territoires africains, et sur la définition d’une stratégie commune pour concrétiser les résultats obtenus à l’ONU concernant les matières premières et le développement. Deux sujets où une unité de vue et d’action aurait pu s’obtenir assez facilement. En réalité, comme toujours, des clivages se sont établis à propos de questions subsidiaires et ont empêché d’aborder avec sérénité tous les problèmes de fonds.
Il reste 87 % de l'article à lire
Plan de l'article