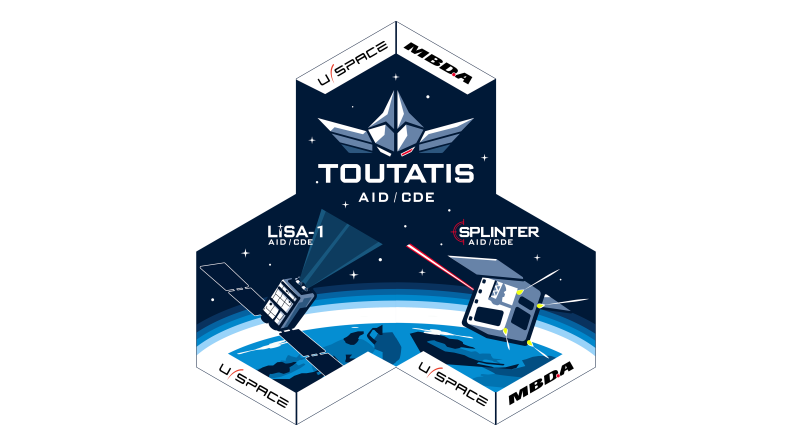Exposé de l'éminent sociologue à la séance solennelle de cinq académies, le 25 octobre 1972.
Clausewitz et la guerre populaire
Carl von Clausewitz passe, à juste titre, pour le plus célèbre des écrivains militaires, le seul dont nul homme cultivé n’a le droit d’ignorer le nom et deux ou trois formules. Gloire posthume, qui semble réparer les injustices dont souffrit l’officier prussien, coupable, aux yeux de son roi, de s’être mis au service du tsar pour combattre Napoléon en 1812. Gloire, en fait, chargée de tous les malentendus que Clausewitz lui-même avait pressentis, dans l’avertissement écrit au moment de fermer à jamais le manuscrit inachevé qu’il laissait à sa femme, née Maria von Bruhl, en lui confiant la tâche de le publier. Combien ont lu De la Guerre parmi ceux qui le citent ? Même en langue allemande, la littérature m’est apparue relativement pauvre. Quels commentateurs se donnent la peine de suivre l’argument du plus systématique, du plus philosophique des traités jamais consacrés à la stratégie ? B.H. Liddell Hart a écrit que Clausewitz usait d’un langage philosophique sans posséder un véritable esprit philosophique. Marx et Lénine en ont jugé autrement. Le 7 janvier 1855, Engels, qui venait de lire Clausewitz, écrivait à son ami : « drôle de façon de philosopher, mais substantiellement très bon » — à quoi Marx répondait quelques jours plus tard : « le gaillard a un common sense, un bon sens, qui confine à l’esprit ». Quant à Lénine, il étudia l’œuvre maîtresse chapitre par chapitre et il en reproduisit de larges extraits sur un cahier, selon sa méthode coutumière, avec des annotations marginales. Ce cahier témoigne d’une rare perspicacité : il assure à Clausewitz, en Union Soviétique, une place au Panthéon, parmi les penseurs bourgeois dont le marxisme-léninisme recueille et enrichit l’héritage.
La carrière de Clausewitz, comme celle de Machiavel, se divise d’elle-même en deux périodes, l’action et la méditation sur les événements vécus. En 1792, il prit part à la campagne de l’armée prussienne contre la France au milieu des soldats, porte-enseigne de douze ans dont le corps d’enfant disparaissait sous les plis du drapeau. En 1815, à la dernière bataille livrée par le « dieu de la guerre » — ainsi l’admirateur-ennemi appelait Napoléon — il conseille la retraite au général von Thielmann, commandant le Corps prussien laissé par Blücher face à Grouchy, avant de connaître la déroute de l’armée française à Waterloo. Ce jour-là, il manqua la dernière occasion de la gloire à laquelle il aspirait de toute son âme. Pendant dix ans, de 1820 à 1830, il commande à Berlin l’Académie militaire, mais, suprême ironie, il n’exerce qu’un commandement administratif, sans influence sur l’enseignement, inconnu des élèves qui le soupçonnent à tort de s’enivrer parce que son nez rougi garde la trace de la campagne de Russie.
De l’expérience historique, de l’échec personnel sortit le penseur : bien qu’il n’ait rien publié de son vivant, au moins sous son nom, Clausewitz n’investissait pas moins de passion dans ses écrits qu’il ne l’avait fait dans le combat ou dans la réforme de l’armée prussienne après Iéna et son retour de captivité. Il l’écrit à plusieurs reprises : ce qu’il veut, c’est une théorie de la guerre, instructive pour les générations à venir autant que pour les contemporains. Le Ktêma eis aei de Thucydide, le monument édifié pour toujours, lui aussi en a rêvé. De cette ambition découle l’attitude commune à l’historien grec et au stratège prussien : le détachement, le refus de toute émotion apparente, l’effort vers la totale objectivité. Lui qui, durant les années de l’action, haïssait le conquérant et, plus encore, ceux de ses compatriotes qui désespéraient de leur patrie, lui qui, dans la profession de foi de 1809, développait avec une éloquence pathétique les arguments de la raison et les raisons du cœur pour reprendre la lutte aujourd’hui, demain, ici. partout, lui le résistant par excellence, il regarde les guerres de la Révolution et de l’Empire, l’écroulement de la Prusse, les triomphes, puis la catastrophe finale de l’Empereur, comme s’il s’agissait d’une histoire déjà lointaine, d’un destin que les hommes auraient subi sans le comprendre et dont il appartiendrait au théoricien de mettre au jour la logique cachée en vue de l’édification de ceux qui assumeront dans l’avenir la responsabilité des États.
Clausewitz, qui n’a pas quitté l’uniforme entre sa douzième année et sa mort, en 1831, avait acquis seul une culture dont témoigne la diversité de ses études et de ses travaux. Prisonnier à Soissons, il étudie les mathématiques. Parmi ses manuscrits figure un essai d’esthétique, influencé, semble-t-il, par La Critique du Jugement. Il ne me paraît pas, cependant, que ni ses lectures, ni les cours d’un vulgarisateur kantien, Kiesewetter, aient déterminé l’orientation de sa pensée. C’est la réalité elle-même de son temps qui l’a peu à peu contraint à s’élever non pas seulement de la tactique à la stratégie mais de la stratégie à la politique et, du même coup, à la philosophie de l’histoire. Entre les manœuvres du XVIIIe siècle et les batailles de masses de l’époque révolutionnaire, il subsiste malgré tout des traits communs. Il s’agit de la guerre, dans l’un et l’autre cas. Quel concept couvre à la fois les guerres où, selon le mot du Maréchal de Saxe, seul un chef maladroit livre bataille et les guerres telles que les menait Napoléon, toujours en quête de l’engagement qui déciderait d’un coup de l’issue de la campagne ? Quel système conceptuel permet de penser simultanément l’unité et les variétés du phénomène guerre ? Comment saisir le concept sans perdre contact avec les singularités de conjonctures qui ne se répètent jamais ? Pourquoi les guerres prennent-elles parfois les formes subtiles du jeu d’escrime pour se déchaîner ensuite avec la violence des tempêtes et la cruauté des instincts primitifs ?
À ces interrogations philosophiques (rapport du concept et du concret) et historiques (rapport des sociétés, de leurs armées et de leurs guerres), le Traité s’efforce de donner réponse et, du même coup, il fonde la primauté de la politique sur la stratégie, du chef d’État sur le commandant en chef des armées, de la fin politique sur l’objectif militaire. La période ouverte par la Révolution française contenait en germe toutes les modalités des conflits politiques, toutes les formes d’hostilité dont l’Europe s’offrit le luxe mortel au cours du siècle suivant. Rien d’étonnant que la théorie clausewitzienne permette de penser, sinon de résoudre, les problèmes posés aux chefs d’État et aux chefs militaires, au moins jusqu’à Hiroshima et Nagasaki, peut-être au-delà.
De la théorie clausewitzienne, la plupart des lecteurs ont retenu surtout l’interprétation de la stratégie napoléonienne. Au début du siècle, les écrivains militaires, des deux côtés du Rhin, disputaient âprement de cette interprétation. Le Prussien avait-il ou non compris l’essentiel ? En revanche, ni d’un côté ni de l’autre du Rhin, on ne voulait se souvenir du chapitre 26 du livre VI, l’Armement du peuple (Jaurès fait exception à cet égard). Or ce chapitre, esquisse d’une théorie de la guerre de partisans, intégrée dans une théorie générale de la stratégie, représente un élément important, non marginal, de la pensée de Clausewitz.
Souvenons-nous, tout d’abord, que, selon lui, c’est la participation du peuple aux affaires de l’État qui constitue la cause décisive du caractère impitoyable, hyperbolique, des guerres révolutionnaires, à la différence des guerres en dentelles, menées par les Cabinets européens au milieu de l’indifférence populaire. La Révolution a fait de tous les hommes valides des soldats avant d’en faire des citoyens actifs. Même la levée en masse n’aboutit pas encore à la mobilisation totale. Il faut que tous, hommes, femmes et enfants, prennent les armes pour que la guerre devienne effectivement celle de la nation tout entière.
Clausewitz, qui n’a pas moins médité sur la défaite finale de Napoléon que sur l’éclat de ses victoires impuissantes, devait donc tourner ses regards vers la Vendée, vers l’Espagne, vers la Russie. Parmi ses manuscrits figure un précis de la guerre d’Espagne, rédigé en français, un récit de la guerre de Vendée. Acteur, il prépara avec Scharnhorst le renforcement de la Landwehr, l’organisation du Landsturm. Il espérait que les Allemands se dresseraient, unanimes et résolus, contre les Français, les paysans avec leurs faux, les ouvriers avec leurs pioches, avec les outils du travail à défaut des instruments du combat. La passivité des Allemands le déçut profondément. Penseur, il mesura justement la contribution de la guerrilla espagnole à la défaite de l’Empereur et il esquissa en quelques pages les règles d’emploi des partisans.
« La guerre populaire, comme quelque chose de vaporeux et de fluide, ne doit se concentrer nulle part en un corps solide ; sinon l’ennemi envoie une force adéquate contre ce noyau et le brise ». Image de l’air et non, comme celle de Mao Tsé-Toung, de l’eau : l’idée demeure la même, la fluidité des partisans, dispersés et insaisissables. L’avantage dont jouissent les partisans sur l’armée régulière, comment l’exprimer plus fortement que par les phrases suivantes : « S’il s’agit de détruire les routes et de bloquer d’étroits défilés, les moyens que des patrouilles ou des colonnes volantes de l’armée peuvent y employer sont par rapport à ceux que fournit un corps de paysans insurgés ce que sont les mouvements d’un automate par rapport à un être humain… Les premiers efforts des levées populaires étant encore faibles, les détachements envoyés par l’ennemi seront peu nombreux en proportion, car il craindra de trop diviser ses forces ; c’est au contact de ces petits détachements que l’incendie de la guerre s’étendra de plus en plus ». De même Clausewitz a formulé rigoureusement le double principe — défense stratégique, offensive tactique — que Mao Tsé-Toung a retenu pour la première phase de la guerre populaire. « Avec ce grand moyen de défense stratégique, il ne faut jamais chercher la défense tactique ou rarement. La troupe populaire, le Landsturm, doit se disperser et poursuivre la défense par des attaques inattendues plutôt que de se concentrer et de risquer d’être enfermée dans un refuge étroit sur une position défensive régulière ». Les règles que formule Clausewitz sur les relations entre partisans et soldats de métier gardent, elles aussi, une valeur actuelle : les Russes, durant la dernière guerre, ont organisé l’action des partisans, encadrés par des détachements de l’armée régulière envoyés derrière les lignes allemandes.
Pourquoi Clausewitz, organisateur et théoricien de la guerre populaire, a-t-il été oublié aussi longtemps ? L’état-major prussien et plus encore le roi, se méfiaient de cette pratique étrangère à la tradition du Roi-Sergent et de Frédéric II. Contre qui le peuple utiliserait-il finalement ses armes ? Après 1815 Clausewitz suivait avec amertume le retour en force du parti conservateur qui, bien loin de songer à la levée en masse, méprisait la Landwehr, les troupes de réserve. Or, ce fils spirituel de Scharnhorst gardait la fierté de la part qu’il avait prise lui-même à l’organisation de ces réserves ; celles-ci n’avaient pas déployé moins de courage et de valeur que l’armée active en 1813, 1814 et 1815. Que faut-il craindre le plus, s’écriait-il avec indignation, l’invasion étrangère ou la révolution ? Un gouvernement assuré du soutien populaire n’a rien à craindre de l’armement de ses sujets. Clausewitz, lecteur attentif de Machiavel, ne conçoit pas une défense confiée aux seuls professionnels, comme si la nation pouvait assister passive aux combats qui décident de son destin. « Aucun État ne doit admettre que son existence même dépende d’une seule bataille aussi décisive puisse-t-elle être… Il est toujours temps de mourir, et de même que c’est par une impulsion naturelle que l’homme qui se noie se raccroche à un fétu de paille, il est dans l’ordre naturel du monde moral qu’un peuple utilise jusqu’au dernier moyen de salut lorsqu’il est poussé au bord de l’abîme ».
Ne l’oublions pas, Clausewitz ne présente l’armement du peuple que comme moyen de défense. Bien plus, il a, pendant deux années, professé le cours sur « la petite guerre » à l’Académie militaire de Berlin et, techniquement, la guerre populaire ne constitue, dans son système, qu’une modalité de la petite guerre, celle que se livrent des détachements forts tout au plus de 200 à 300 hommes. Pour que la guerre populaire seule puisse forcer un envahisseur à évacuer le pays, écrit-il, il faut supposer des espaces aussi vastes que ceux de la Russie et une extrême disproportion entre la force de l’armée conquérante et les dimensions du terrain.
Guerre populaire, ai-je dit, et non pas guerre révolutionnaire. Clausewitz ne sort pas explicitement du cadre de la politique européenne. La petite guerre, avec le concours du peuple, figure parmi les moyens de défense, elle contribue à la supériorité de la défensive sur l’offensive, elle rend sa chance et son avenir au pays qui a perdu la première bataille, elle fixe des limites à la stratégie napoléonienne d’anéantissement, elle exige qu’entre les combattants et la nation une confiance réciproque anime une volonté commune : d’où les réformes de Stein, Scharnhorst, Gneisenau, Boyen après Iéna, par exemple la suppression des châtiments corporels, afin de créer une armée qui, à la différence de celle du Grand Frédéric, fût composée sinon de soldats-citoyens, du moins de soldats conscients de leur allégeance au roi et à la patrie. Clausewitz demeura trop conservateur jusqu’à la fin de sa vie pour craindre ou espérer le potentiel révolutionnaire de l’armement du peuple.
Lénine lui-même ne découvrit nullement le secret de la guerre révolutionnaire dans le Traité qu’il cita si souvent au cours des années cruciales 1917-1921. Il interpréta l’enseignement de Clausewitz en vue de la fin à laquelle il avait voué son existence. Cet enseignement comportait une double relation entre armée et politique : l’armée est un moyen au service de la politique et la politique détermine l’organisation, le mode de combat des armées. Lénine en tire la conclusion que du régime intérieur des États dépend la nature des guerres, justes ou injustes, impérialistes ou non-impérialistes ; il unit en une seule doctrine la théorie de la guerre et celle de la révolution ; civile ou étrangère, la guerre reste un moyen que le stratège doit maîtriser en vue de la Révolution mondiale ou du salut national. Staline, non Roosevelt, mena la guerre de 1939-1945 conformément aux leçons de l’officier prussien.
C’est Mao Tsé-Toung qui, retrouvant ou reprenant les leçons de la guerre d’Espagne, élabora la doctrine de la guérilla et du conflit prolongé. La guerre populaire devient guerre révolutionnaire, moyen d’attaque aussi bien que de défense. Une fois de plus, la logique de l’ascension aux extrêmes emporte les barrières de la coutume et de la morale.
Les professionnels qui, à l’époque, s’opposaient au déchaînement de la violence, qui voulaient maintenir la distinction entre civils et militaires, ne montraient-ils pas plus de sagesse ? B.H. Liddell Hart a plaidé cette thèse. Clausewitz lui-même s’est interrogé sans répondre : aux philosophes de juger si cette forme de guerre ou la guerre elle-même est ou non salutaire pour l’humanité. L’homme d’action, lui, n’hésitait pas : pour le salut de la patrie, il mobilisait tous les patriotes. Résistant, au sens que ce mot a pris au XXe siècle, il n’hésite pas à rallier le camp contre lequel son roi se jugeait contraint d’envoyer un corps prussien, intégré à la Grande Armée. Le plus brillant de ses camarades de promotion à l’Académie militaire de Berlin tomba sous l’uniforme russe, tué par une balle prussienne.
Clausewitz justifie l’armement du peuple par l’efficacité. Quand nous évoquons un passé vieux d’un quart de siècle, peut-être l’argument moral nous convainc-t-il autant que l’argument pragmatique. Vêtu ou non en soldat, l’homme défend son âme quand l’envahisseur lui arrache son pays et sa liberté.
Permettez-moi plutôt de conclure sur deux jugements qui révèlent l’homme au-delà du patriote brûlant de passion, au-delà du théoricien volontairement glacé. Une note, retrouvée dans les papiers de Clausewitz, juge les méthodes recommandées par le terrible Barrére au Comité de Salut Public pour venir à bout de la contre-révolution vendéenne : « méthodes puissantes, mais si cruelles, si dénuées de sensibilité, si contraires à la dignité des hommes et à l’humanité que les Vendéens puisèrent dans le désespoir des forces nouvelles de haïr et de combattre et obligèrent les républicains à revenir à la modération »… « La cruauté laissée à elle-même fait renaître la guerre à mort ». Le deuxième jugement, je l’emprunte à des lettres datées de Paris en 1815.
Clausewitz avait détesté les Français durant toutes les années de l’abaissement de la Prusse. Quand il revint en France, vainqueur et non plus prisonnier, il jugea sans indulgence la conduite de ses compatriotes, il s’opposa à Blücher qui voulait faire sauter le pont d’Iéna, il se querella avec Gneisenau qui souhaitait l’exécution de Napoléon ; il ne trouvait aucune joie au spectacle d’un peuple piétiné par l’occupant. Peut-être comprit-il à ce moment-là la vérité, souvent méconnue, que l’autorité suprême appartient au chef d’État, non aux généraux.
Au début de ce siècle, un commentateur français, Camon, écrivait que Clausewitz était le plus Allemand des Allemands et que l’œuvre plongeait immédiatement le lecteur dans un brouillard métaphysique. À quoi un autre commentateur d’outre-Rhin répondait à peu près : « tant mieux ! Les Français ne comprendront jamais Clausewitz et le secret de notre force ». Les Français en ce siècle, ont à coup sûr enlevé aux Allemands le monopole du brouillard métaphysique, et de victoire en défaite et de défaite en victoire, peut-être les deux peuples ont-ils ensemble découvert un autre secret, plus précieux : celui de la paix. ♦