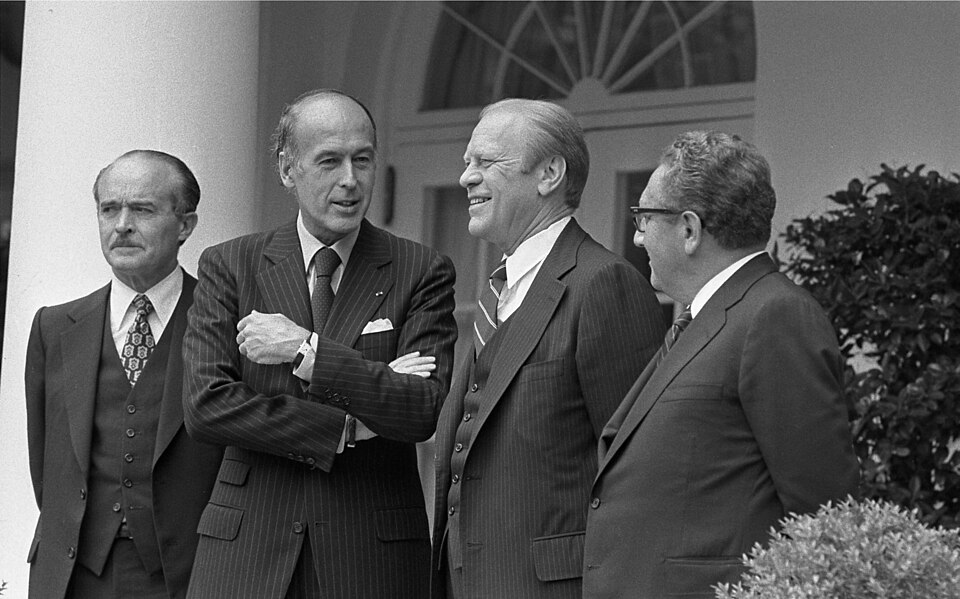Afrique - Afrique : la fin d'une époque - Les déboires du colonel Kadhafi
Depuis le début des années 1980, l’Afrique a presque abandonné l’usage des expressions correspondant à des notions qui étaient souvent seules capables de provoquer son unité en période de crise. Les termes « impérialisme », « néocolonialisme », en particulier, sont sortis de son vocabulaire. L’opinion, sans doute, s’apercevait peu à peu qu’ils ne correspondaient plus à rien de réel ; ou plutôt, il s’avérait évident, à une intelligentsia de plus en plus ouverte, que l’idéologie, qui répandait ces termes, leur avait redonné une vie bien tangible dans les pays où ses militants détenaient le pouvoir. Elle comprenait ainsi que le mal de la dépendance était indéracinable tant que le développement ne permettait pas de l’extirper ; elle se mit donc à pencher vers le camp idéologique qui pouvait favoriser le développement le plus rapide. Elle constatait, d’ailleurs, qu’entre un État dirigé par un régime orienté à l’Ouest et un autre dont les dirigeants se piquaient de marxisme tout court ou de marxisme-léninisme, la différence de comportement à l’égard du citoyen était faible : sous le prétexte de créer l’esprit national, le Parti unique nivelait les ambitions et les initiatives, limitait les candidatures aux élections à des personnalités soigneusement triées et restreignait le débat politique, de peur qu’il n’embrase toute une population, à une enceinte close où le regard du peuple n’était pas convié.
On abandonnait quelquefois insensiblement, dans l’action, les principes de l’idéologie que la propagande continuait à exposer. De toute manière, à cette époque, un État ne pouvait, en général, passer ouvertement d’une idéologie à une autre que par la transition d’un régime militaire : les interventions de l’armée, presque toujours inspirées par des personnalités non militaires, étaient motivées par des luttes intestines dont l’origine était alors plus tribale que politique. Le changement d’orientation se traduisait par des votes différents à l’OUA (Organisation de l’unité africaine) ou à l’ONU et, quelquefois, par une transformation du système de distribution des produits commerciaux. L’homme de la rue n’y trouvait pas grand avantage.
Avec le déclin des engouements idéologiques, avec surtout l’évolution des cadres de l’armée, le rôle que celle-ci se mit à jouer dans certains pays devint différent. Auparavant, les auteurs des coups d’État militaires étaient pour la plupart des personnels de haut rang qui avaient fait carrière dans l’armée du colonisateur ; ils n’avaient bien souvent pour ambition que de remettre de l’ordre, gouvernaient empiriquement et se trouvaient entraînés, par les circonstances ou par des conseillers, à placer leur État sur une ligne idéologique déterminée. Lorsqu’ils perdaient le pouvoir, c’était, comme au Ghana ou surtout au Nigeria, parce qu’ils jugeaient qu’ils pouvaient se retirer, après avoir installé des structures permettant à un pouvoir civil de gérer les affaires.
Il reste 89 % de l'article à lire
Plan de l'article