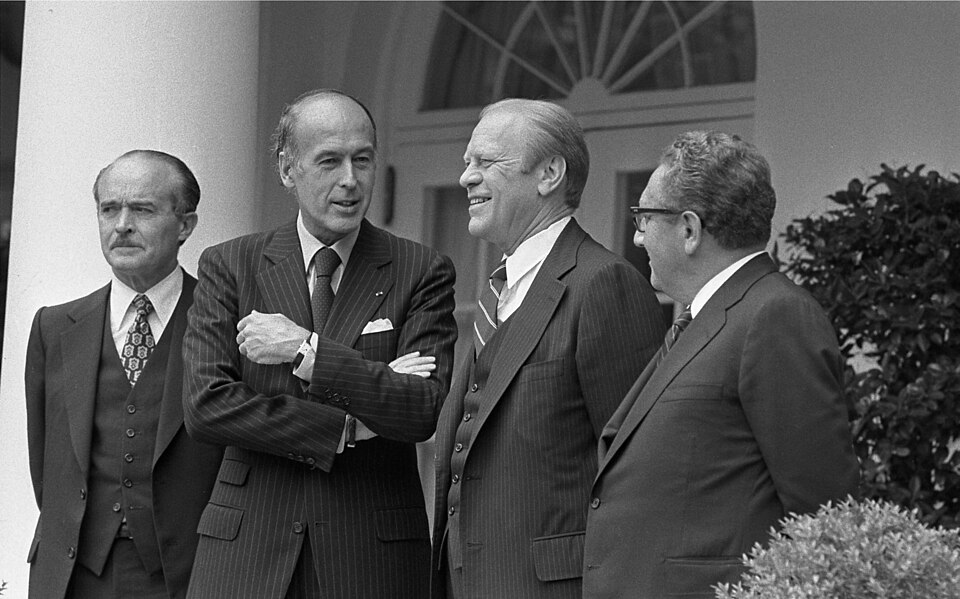Gendarmerie - Le plan « Réserves 2000 » et la Gendarmerie
Dans le prolongement du « plan de valorisation des réserves » établi par le sénateur Hubert Haenel et compte tenu de l’impérieuse nécessité, réaffirmée par le Livre blanc sur la Défense, d’un renouveau de la politique d’emploi des réservistes face aux évolutions géostratégiques, politiques et sociales, une mission « réserves », confiée au préfet Jean-François di Chiara, avait pour objectifs de coordonner et suivre l’ensemble des questions et activités intéressant les réserves, d’en définir et animer la politique au sein des armées, de la gendarmerie et des services (concepts d’emploi, structures de gestion, politique des ressources humaines, dispositifs juridiques, moyens matériels et financiers…), de mener les actions destinées à renforcer le statut social des réservistes, de tirer toutes les conséquences utiles des expérimentations conduites en ce domaine, de suivre et orienter la politique d’information et de communication des armées, d’entretenir des relations avec les associations de réservistes et les instances de concertation qui les regroupent.
Afin de disposer des ressources humaines suffisantes pour faire face, conjointement avec la réduction du format des forces armées, aux missions croissantes qui leur sont confiées, qu’il s’agisse de la préparation et de la conduite d’actions de défense en cas de crise ou de conflit, de la participation aux opérations extérieures menées sous l’égide ou au sein de l’Onu, de coalitions internationales, d’accords bilatéraux et de l’assistance militaire technique, mais aussi des contributions aux tâches de sécurité intérieure au profit de la collectivité nationale (renforcement des forces policières dans l’application du plan « Vigipirate », concours apportés lors de catastrophes naturelles et accidentelles…), un nouveau système de réserves est, à l’heure actuelle, en cours de mise en place. Soumis au Comité des chefs d’état-major et approuvé par décision ministérielle en mai 1995, ce projet d’ensemble est destiné, plus particulièrement, à permettre une participation plus active des réservistes de manière à répondre à trois types de besoins : renforcer ponctuellement les forces d’active en faisant appel à des cadres qualifiés, susceptibles de se substituer, au sein des structures de commandement, de soutien et de sécurité, aux cadres d’active appelés à exercer d’autres fonctions dans le dispositif de défense ; disposer d’officiers et de sous-officiers de réserve suffisamment compétents et expérimentés, pouvant assurer l’encadrement d’unités constituées exclusivement de réservistes ; être en mesure de faire appel, en cas de mobilisation, à tout ou partie du potentiel de réserves, afin de permettre la mise sur pied des formations militaires chargées des missions de défense militaire, civile et économique. Prenant en compte ces différents besoins, le nouveau plan opérationnel « Réserves 2000 » réalise une classification des 504 600 réservistes en quatre grandes catégories (1).
La réserve spécialisée (2 100) : les réservistes « spécialistes » sont recrutés en raison de leur qualification militaire ou professionnelle présentant, pour les forces armées, une certaine rareté et une grande utilité (par exemple, dans les domaines médical, juridique…), et qui, de ce fait, peuvent être employés sans formation complémentaire.
Il reste 77 % de l'article à lire




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)