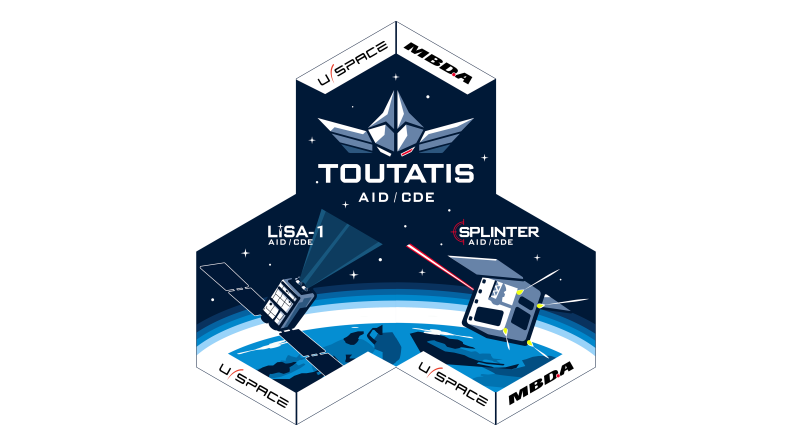Les racines de l’identité européenne
Le hasard de l’indisponibilité d’un confrère à coup sûr plus compétent nous a heureusement mis en main cet ouvrage ambitieux dans son titre comme dans son contenu… et à l’évidence d’une brûlante actualité. Est-il utile ? Sans doute, car si le sujet est communément traité, ce livre aborde les questions de fond sans se contenter d’affirmations complaisantes et fait appel aux connaissances d’une majorité d’universitaires flanqués de quelques diplomates et politiques. Est-il réussi ? Certes, puisque Gérard-François Dumont le déclare dès son paragraphe initial de remerciements et que la note de présentation assure ingénument que la lecture en est « fort agréable », preuve qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Est-il cohérent ? Autant que faire se peut, dans cette réunion de « vingt-trois auteurs de quinze nationalités différentes » où chacun possède sa personnalité et ses domaines d’élection.
Entre une préface de l’ancien président du Parlement européen Gil-Robles, remarquable de clarté et de conviction (il faut parfois lire les préfaces !) et une énumération finale des douze « repères de l’identité européenne » par l’auteur principal, le livre est articulé en deux parties de façon bien cartésienne : une analyse pays par pays suivie d’une série d’études globales que l’on pourrait qualifier de fonctionnelles.
L’étude des composantes néglige une proportionnalité rigoureuse : la Belgique a ainsi droit à 25 pages (dont, il est vrai, la moitié consacrée à un exposé de psychologie sociale de portée très générale) et l’Italie à 6, tandis que l’Irlande fait l’objet à elle seule de deux communications, tout comme la Grande-Bretagne. Quant aux absents, « c’est parce que leur identité européenne ne fait pas de doute qu’ils n’ont pu être pris en compte » (?), amusante pirouette ! Il n’est bien entendu pas question de rendre compte ici de chaque intervention. Nous avons, opinion purement personnelle, préféré certains chapitres comme ceux qui relatent avec concision la situation autrichienne, espagnole ou… française ; suivi avec intérêt les distinctions révélatrices entre « demos », « ethnos » et « genos » ; apprécié des tournures spirituelles (« le mythe gaélique relégué au rang de vache sacrée »… « on chante l’Internationale aux Pays-Bas avec le même recueillement qu’un psaume ») ; regretté enfin quelques coups de patte contraires au devoir d’impartialité de l’université. Si le qualificatif de « réactionnaire », franchement péjoratif depuis le temps d’Albert de Broglie, n’est pas impropre pour désigner Barrès, il n’est pas forcément le plus approprié ; traiter de « jérémiades » les idées d’historiens transalpins qu’on ne partage pas manque de fair-play ; juger « irrationnel » le comportement de la Grèce sans en apporter la preuve formelle sent l’exécution sommaire. Nous avons en même temps beaucoup appris, que ce soit par exemple sur le subtil contenu du terme « finlandisation » ou sur la continuité de l’influence du contagieux « ferment » de l’hellénisme au sein du monde ottoman. Cependant, nous avons parfois douté : va-t-on continuer ad nauseam à centrer sur le nazisme et la « routine de culpabilisation » toute étude sur l’Allemagne, alors que ses dirigeants en place sont nés largement après 1945 ? Comme le reconnaît l’auteur du chapitre en cause, il existe une « autre Allemagne », libérale, progressiste, humaniste et, après tout, chaque pays n’a-t-il pas eu son Sonderweg, ne fût-ce que le nôtre de 1789 à 1815 ?
Les chapitres de synthèse confirment deux conclusions déjà présentes dans l’examen systématique : d’une part, l’Europe, « à géométrie variable », ne possède pas de limites géographiques indiscutables et se définit volontiers négativement, car c’est devant le danger qu’elle sut parfois se rassembler ; d’autre part, véritable idée-force du livre (si notre interprétation est bonne), non seulement « il n’y a pas antinomie entre identités particulières et identité européenne… elles ne s’excluent pas, elles se superposent », mais les apports élémentaires qu’il ne faut ni nier ni contrarier enrichissent l’ensemble. Chacun y gagne : « c’est par la puissance de l’idée européenne que pourra être défendue la survie des spécificités ». Les lecteurs de notre revue s’étonneront, familiers qu’ils sont des mouvements d’estoc et de taille, et même si « personne ne connaît plus les noms des généraux », de ne point entendre parler de défense, sauf par le biais d’allusions éclairs aux chapitres XVII et XXII. Et puisque nous en sommes aux petitesses, signalons que les pertes belges n’atteignirent (heureusement !) pas 878 000 morts à l’issue de la Seconde Guerre mondiale (page 28) et que la reconnaissance de l’indépendance du pays par le roi Guillaume Ier intervint avant 1939 (page 108) !
Le constat encourageant de la réalité de l’identité européenne étant établi, il reste à en convaincre l’Européen moyen qui n’en a guère conscience. Question de temps sans doute, et dépendant plus d’éléments concrets comme ceux qui figurent dans un beau texte de J.A. Fernandez cité page 366 que de catalogues un peu dérisoires de mesures gadgets qui font penser à un « inventaire de stock ». Admettons donc que « la volonté européenne se construit tous les jours » ; il nous semble que la marche vers l’identité ressemble toutefois encore à une aventure, en particulier pour deux motifs : le premier est que, en dépit de l’affirmation de complémentarité (et non de concurrence) entre les différents niveaux de loyauté, l’État nation, présenté ici curieusement comme ne « datant que de deux siècles », est menacé (« les citoyens européens se sentiront moins attachés à lui »), notamment au profit du régionalisme en vogue, conduisant lui-même à un multilinguisme peut-être sympathique, mais bien difficile à pratiquer. On veut bien nous rappeler que « le parisien s’imposa lentement face aux six autres langues qui existaient en France à l’époque de la Révolution », mais Malherbe n’a tout de même pas la réputation de s’être exprimé en patois normand, pas plus que Pascal en auvergnat. Le second motif se situe sur un terrain que connaît bien GFD (s’il est permis de le désigner par le trigramme réservé aux gens de qualité) : le terme d’« Europe ridée » et la contemplation de quelques tableaux comparatifs font froid dans le dos. À quoi bon prophétiser un avenir si les racines se dessèchent ? On ne peut alors que souscrire à cette prévision : « Au XXe siècle, le grand ennemi de l’identité européenne a été le totalitarisme ; au XXIe siècle, ne risque-t-il pas d’être le malthusianisme ? » ♦