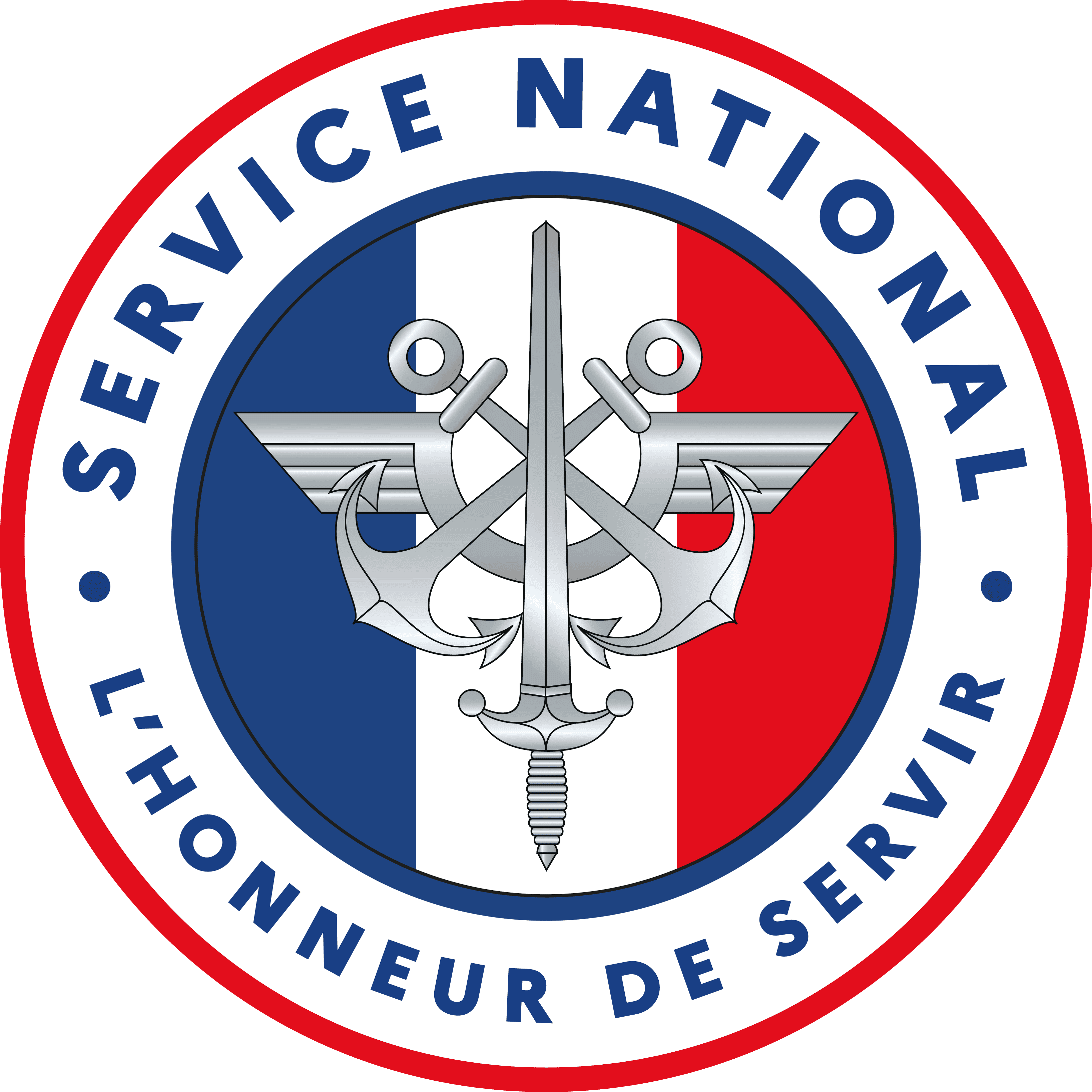Sécurité d’abord, la politique française en matière de désarmement, 9 décembre 1930 – 17 avril 1934
Ce gros livre des publications de la Sorbonne, sous le patronage de l’Institut d’histoire des relations internationales contemporaines (IHRIC) dont M. Durozelle est le président, est tiré d’une thèse présentée par Maurice Vaïsse, maître-assistant à l’université de Paris I, et nous donne une étude approfondie de ce problème mis artificiellement sur les devants de la scène par les Britanniques entre 1930 et 1935 et qui s’appelle le désarmement. C’est d’ailleurs une triste histoire pour tout le monde, et particulièrement pour la France, l’année 1932 marquant, d’après l’auteur, « le début du déclin de la puissance française ».
C’est surtout une suite d’échecs cuisants qui va aboutir au réarmement général et à la deuxième guerre mondiale, dont l’apogée est la conférence qui s’ouvre à Genève le 2 février 1932, la plus grande réunion internationale depuis le Traité de Versailles.
Ce qui a frappé Maurice Vaïsse, et à sa suite le lecteur, mais aussi les acteurs comme Herriot, c’est l’extraordinaire complexité du problème. Le problème du désarmement est hautement technique, mais derrière la technique se cache la politique, ou plutôt le jeu diplomatique. On ne peut séparer le désarmement des autres grands problèmes internationaux. L’étude de la politique française dans ce domaine est donc celle des relations de notre pays avec les autres grandes puissances sous l’égide de ce qu’on a appelé la diplomatie « ouverte », la diplomatie traditionnelle, menée avec discrétion et secret, ayant été accusée d’avoir entraîné la guerre en 1914.
Le centre de l’étude est bien évidemment la conférence elle-même. Dans une première partie, cependant, l’auteur examine la situation de la France « en sécurité précaire », de 1930 à février 1932. La première date est celle de l’évacuation de la Rhénanie (en juin) et de la deuxième conférence navale, celle de Londres, venant compléter celle de Washington en 1922, où la France, à son corps défendant, s’était trouvée placée au même rang que l’Italie, malgré la différence de situation des métropoles et surtout des empires coloniaux. Notre pays se trouve privé de la garantie des États-Unis, puisque le Sénat américain a refusé de ratifier le Traité de Versailles. Quant à l’Angleterre, à l’abri de sa situation insulaire, elle est reprise par son vieux jeu de lutte contre la principale puissance d’Europe qu’elle pense être la France (c’est l’époque où la Royal Air Force justifie ses demandes de crédit en donnant l’aviation française comme son ennemi potentiel). De plus, il y a une incompréhension totale entre les deux points de vues. « L’une veut désarmer d’abord… l’autre veut pacifier d’abord ». Pour rompre le cercle vicieux sécurité-désarmement. Herriot énonce la fameuse trilogie : arbitrage-sécurité-désarmement, alors qu’à Rapallo, Soviétiques et Allemands s’entendent comme larrons en foire. Finalement, la politique extérieure française est paralysée par ses propres contradictions, par son incompréhension de la nature réelle, encore peu apparente à l’époque, du nazisme, et surtout par les faiblesses d’un régime qui ne peut gouverner avec un peu de durée. La France est prise au piège du double jeu de l’Allemagne favorisé par la complicité italienne et l’apeasement mené par les Anglo-Saxons, ce qui mènera à Munich.
On se perd un peu dans le dédale des négociations compliquées menées pendant plusieurs années par des personnages très divers, mais on trouvera dans ce livre une mine de documentation très précise appuyée par des références nombreuses qui permettent de remonter très facilement aux sources. Il apparaît aussi bien des enseignements qu’il conviendrait de méditer pour ne pas retomber dans les mêmes ornières quand il s’agit de recommencer des négociations sur le désarmement. Un autre domaine mérite également réflexion, celui de l’organisation du commandement et de la politique militaire en France. Il est malheureusement difficile de ne pas dire, comme l’auteur, que, vers 1930, « la défense nationale n’existe pas, le haut commandement est inefficace, et la nation en armes un corps flasque », ou comme le dit Weygand à l’époque : « À suivre les errements en cours l’Armée française risque de n’être qu’une façade coûteuse et impropre à la guerre ». Ceci est vrai surtout pour l’Armée de terre. La Marine amorce son renouveau, mais l’aviation est encore sous tutelle. « Le système militaire de la France, fondé sur l’éventualité d’une guerre d’usure, voue l’Armée à la défensive. Et la France atteste, en construisant la ligne Maginot, qu’elle ne prendra jamais l’initiative ».
Le lecteur déjà un peu averti de cette histoire par certains livres français (1) ou britanniques (2) est cependant surpris par certaines affirmations. La première concerne la Marine où Maurice Vaïsse paraît être prisonnier de certaines idées toutes faites. Il est courant d’accuser la Marine de particularisme, et l’existence d’un ministère séparé favorisait en effet l’existence d’une politique différente de celle de l’Armée de terre, mais il est moins exact qu’elle se soit isolée. D’ailleurs, l’isolement est source de faiblesse. Marquée par le rôle effacé joué pendant la guerre, traumatisée par les mutineries de la mer Noire et l’interruption de ses constructions neuves pendant quatre ans, la Marine s’est mise à se reconstruire intérieurement, matériellement et moralement, surtout à partir de 1930, et a su fort bien mener son action dans l’opinion publique, avec les livres de Paul Chack et d’autres (3). La Marine, vivant à l’extérieur et ayant l’habitude des choses internationales, gardait l’amertume du guet-apens où elle était tombée à Washington en 1922, du fait de la manière dont le secrétaire d’État américain Hughes avait ouvert la conférence. Enfin, de 1925 à 1932, elle a eu le même ministre pendant sept ans, et elle en a reconnu la valeur en donnant pour la deuxième fois à un de ses bâtiments le nom de Georges Leygues.
Il est également surprenant de voir utiliser le terme de « pouvoir militaire » qui est peut-être familier aux universitaires, et correspondait, à la rigueur, à une certaine réalité entre 1918 et 1939, si on pense à la timidité des hommes politiques devant certains grands chefs prestigieux, malgré l’incroyable organisation du commandement de l’époque, où subsistaient côte à côte un Chef d’état-major général (Gamelin) et un généralissime désigné (Weygand). Peut-être certains militaires comme le général Bourret se sont-ils servis de cette expression, mais elle est choquante et l’on pense à l’apostrophe de Weygand lui-même dans ses mémoires : « Il n’y a pas deux pouvoirs dans l’État, mais un seul, le pouvoir civil qu’exerce le gouvernement en toute autorité. Il y a un chef militaire n’ayant autorité que sur l’Armée, qui doit obéissance au gouvernement ». ♦
(1) En particulier le livre du colonel Minart : Le drame du désarmement français (ses aspects politiques et techniques) ; La revanche allemande 1918-1939 ; (La Nef 1959) ; mais aussi le très sérieux Vingt ans de politique navale publié en 1942 sous le pseudonyme de d’Espagnac du Ravay, cité par l’auteur mais non repris dans la bibliographie.
(2) En particulier les deux volumes du capitaine de vaisseau S. Roskill : Naval Policy Between the Wars (Collins 1960 et 1976). Maurice Vaïsse ne cite pas l’ouvrage de Brian Bond, Military Policy Between the Wars, probablement trop récent.
(3) Ou le livre de Fernand Boverat : La bataille de l’océan justifiant, sous une forme romancée, la construction des deux Dunkerque.