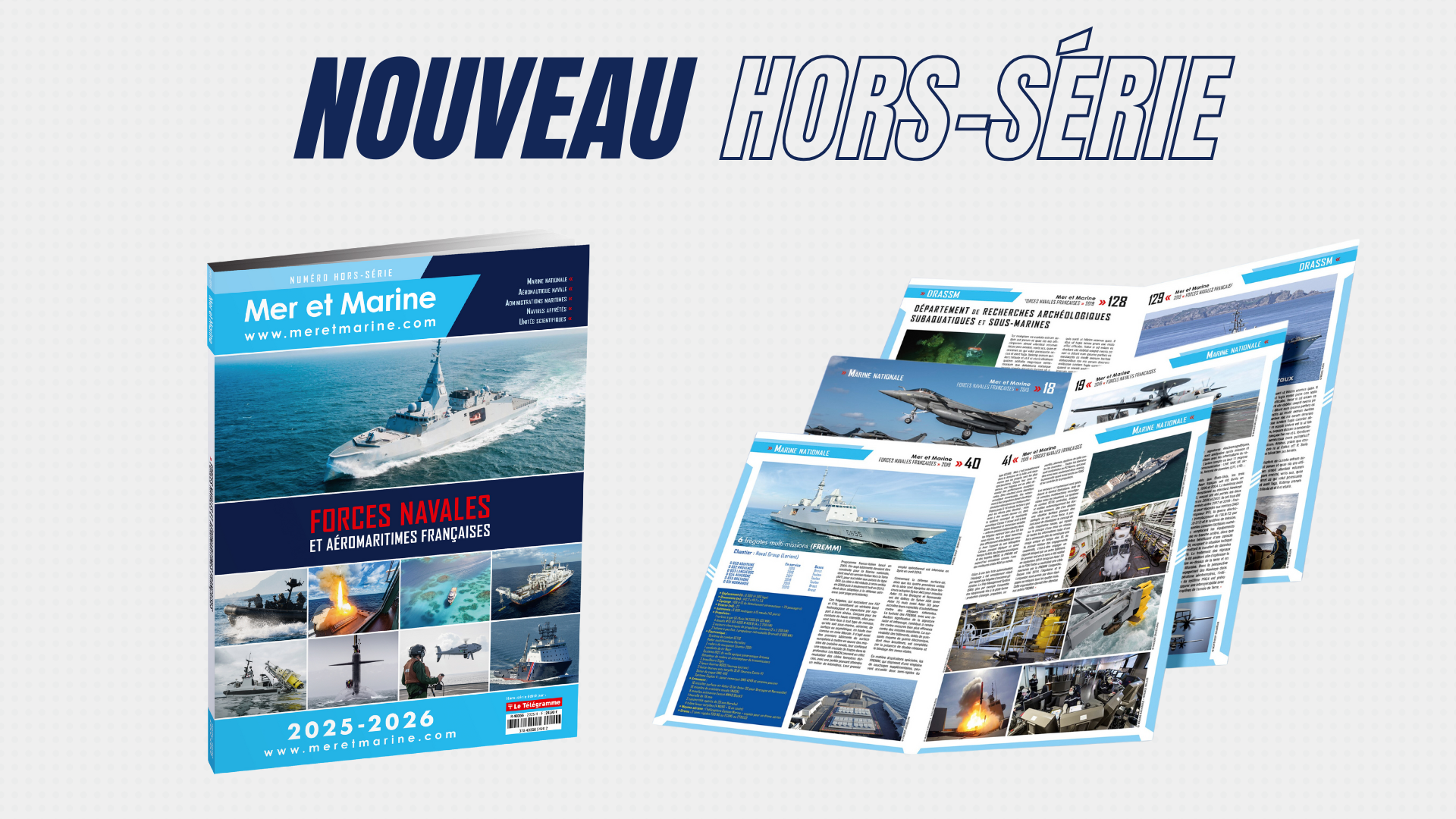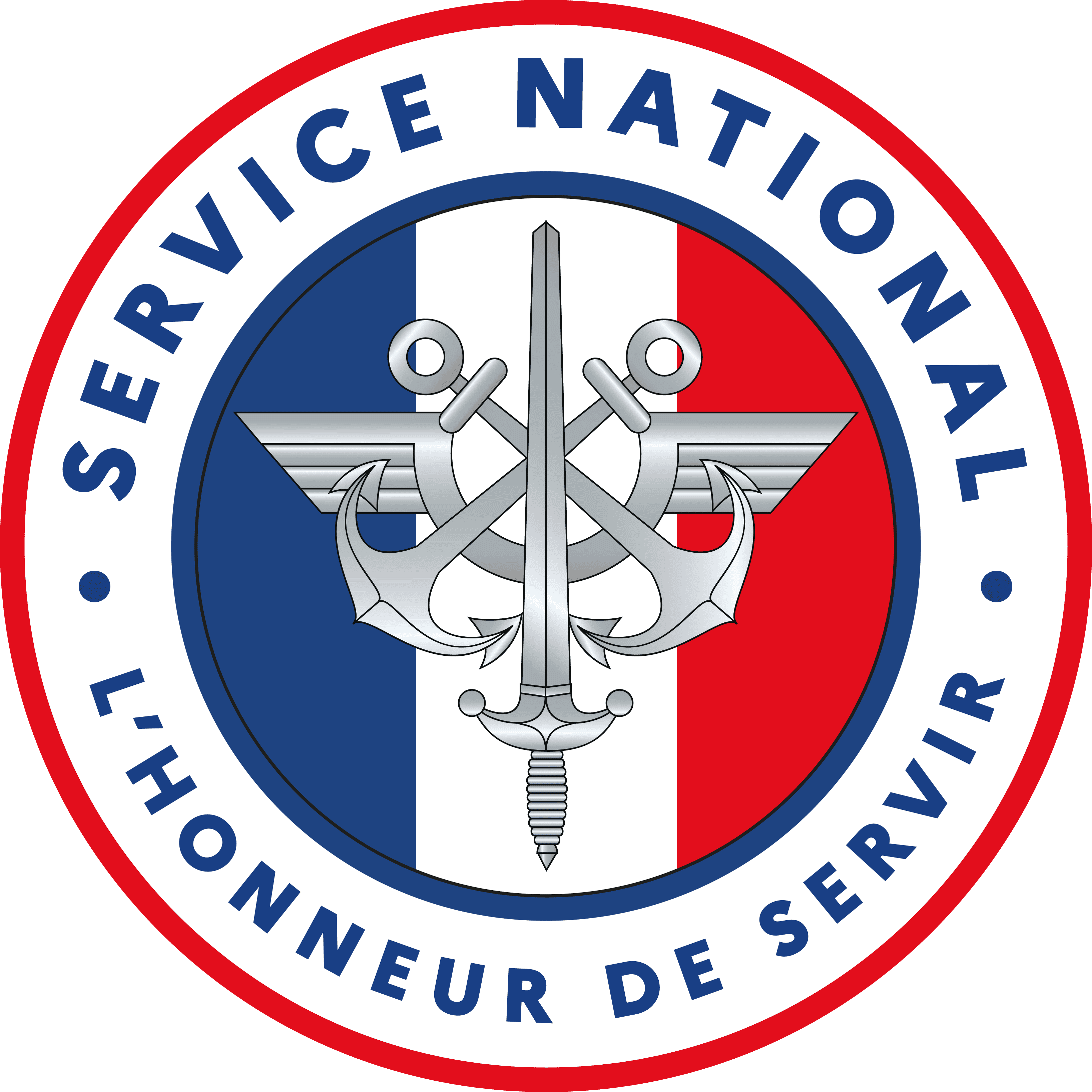De quelques aspects militaires de la géographie (II)
Certaines données résultant de la géographie, appartenant à un ordre d’idées analogue, qui étaient admises comme vérités autrefois, sont à réviser maintenant à cause de l’évolution de la technique. Par exemple, on tenait jadis pour impossible et même pour insensé d’entreprendre l’invasion d’un territoire situé au delà de la mer si l’on ne pouvait pas exercer à l’égard de cette mer une maîtrise au moins locale et temporaire. L’accroissement considérable de la réaction de la terre dû à des armes nouvelles a changé tout cela. Il en est résulté, dans la zone de contact entre la terre et la mer, un élargissement de la prépondérance de la première quand elle dispose des outils nécessaires, un recul de la domination de la seconde quand elle se heurte à ces facteurs contraires. Dans cette frange bordière, les positions sont altérées par les nouveaux instruments mis en œuvre par le progrès. La ligne d’équilibre entre les forces antagonistes de terre et de mer se déplace vers la mer, semble-t-il, et cela au détriment de la mer. La terre réagit davantage, et plus efficacement.
Dans cette région, l’attaque d’un territoire d’outre-mer ne postule plus forcément la maîtrise de la mer, quand certaines conditions particulières se trouvent réunies. D’abord quand l’assaillant, non maître de la mer, bénéficie sur le point attaqué de la supériorité terrestre, et en outre de la supériorité aérienne, cette dernière étant exploitée aux fins de combat, de domination du ciel, aux fins d’offensive par bombardement des objectifs au sol, et aussi aux fins de transport par parachutes, avions ou planeurs. Troisième condition : quand le défenseur, supposé maître de la mer, est, dans l’aire intéressante, gêné et à demi-paralysé dans l’exercice de cette maîtrise et dans le déploiement de la supériorité en surface qu’elle implique, en premier lieu par la supériorité aérienne de l’attaque, puis par les multiples risques plus proprement navals résultant des sous-marins et des mines. Gène et demi-paralysie qui peuvent être le fait, non seulement de ces facteurs contraires eux-mêmes, mais aussi d’une inaptitude constitutive de la force de surface de la défense à maintenir sa pression malgré eux, par suite d’une insuffisante dotation en navires légers et de petit tonnage. Quatrième condition : quand la distance de la base de départ à l’objectif n’est pas trop grande et qu’elle est en rapport avec la balance favorable des moyens définis ci-dessus. La distance-limite jusqu’à laquelle l’opération offre des chances raisonnables de succès dépend en effet de cette balance des moyens. Elle varie avec elle et n’a rien d’absolu. Plus grande est la supériorité terrestre et aérienne de l’assaillant, plus contrarié est le défenseur dans l’exercice de sa supériorité navale, plus grande évidemment est la distance à laquelle on peut agir. L’affaire, hétérodoxe à semblable portée au regard des règles d’antan, devient parfaitement admissible et raisonnable aujourd’hui dans le même rayon. En somme, dans chaque cas, c’est une question d’espèce, d’affrontement des divers éléments en jeu. Quel est le degré de supériorité terrestre de l’attaquant ? Son degré de supériorité aérienne ? Le degré d’affaiblissement de la supériorité navale du défenseur ? Le rapport entre la distance d’attaque et l’état respectif des forces des trois catégories ? La décision sera dictée par la réponse à toutes ces interrogations.
Dans les siècles passés, on a tenté et réussi certains enlèvements par surprise d’îles très voisines du littoral de l’assaillant, sans que celui-ci ait été, même momentanément, maître de la mer. Mais, la distance de l’objectif augmentant, on rencontrait vite la limite des possibilités de cette sorte. Quand, en 1803, après la rupture de la paix d’Amiens, Bonaparte reprenait ses projets de marche vers l’Égypte, il comptait, s’élançant de l’Italie méridionale solidement occupée, subjuguer l’Épire et la Morée, et de là, avec un peu de bonheur, malgré la supériorité navale britannique, s’emparer de la Crète et parvenir de nouveau aux rives du Nil. Mais la seule présence de la flotte de Nelson réduisait à néant tous ces projets. Le maître de la terre était incapable de franchir le détroit d’Otrante et à plus forte raison de prendre pied en Crète. Au contraire, en mai 1941, le dominateur continental, ayant occupé la Morée, a réussi, bien qu’inférieur sur mer, à conquérir cette même Crète grâce à sa supériorité terrestre et aérienne.
Il reste 85 % de l'article à lire
Plan de l'article