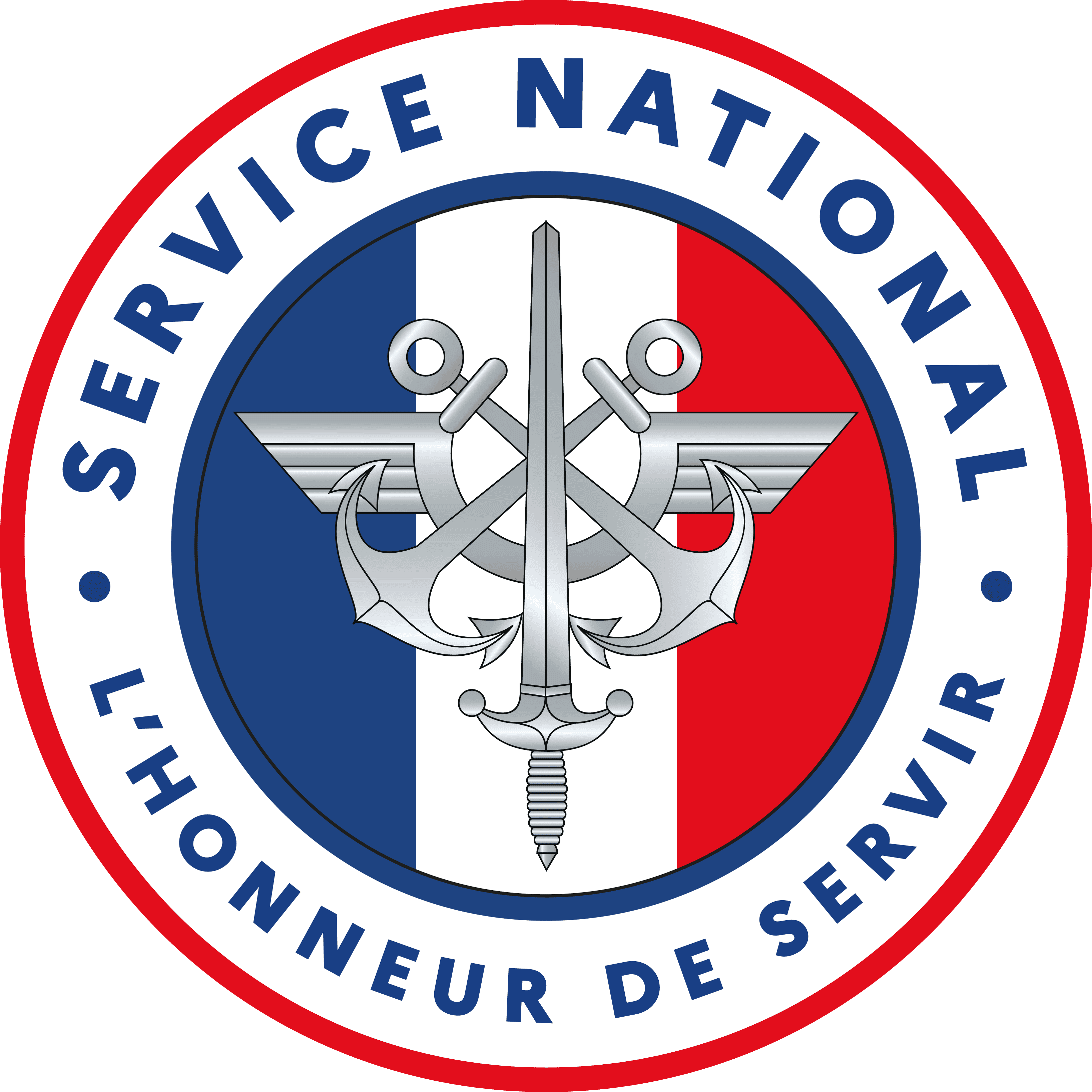Histoire de la République centrafricaine
Relevons tout de suite, mais pour les oublier aussitôt et nous livrer sans arrière-pensées au plaisir de la lecture, les quelques défauts de ce très passionnant ouvrage. De la plupart d’entre eux, l’auteur n’est d’ailleurs pas entièrement responsable.
Ainsi, était-il tenu de se plier aux servitudes de l’édition, et du marché du livre conditionné par les habitudes du public. Il ne pouvait donc songer à publier son Histoire de la République centrafricaine telle qu’il l’avait conçue et rédigée (1777 pages !) pour sa thèse de doctorat ès-lettres. Obligé de se restreindre et d’élaguer, il n’y a pas toujours entièrement réussi. Trop de détails, trop de noms propres, de lieux ou de tribus, trop de péripéties mineures, s’il était important de les conserver à l’usage des spécialistes, lassent par moments l’attention du lecteur ordinaire et lui font perdre le fil d’un récit cependant fortement charpenté.
Un autre sujet de mécontentement vient s’ajouter au précédent : le lecteur ne trouve pas dans le texte même de l’ouvrage toutes les cartes et tableaux qui lui seraient indispensables pour ne pas s’embrouiller. Quelques schémas sommaires, géographiques, ethnographiques, économiques et politiques ne suffisent pas. D’autant plus que rien ne servirait de se référer à un atlas, car il n’y en a pas en France de suffisamment détaillés et à jour. Seules les cartes du Service géographique pourraient pallier cette carence mais ce serait trop demander aux lecteurs que de se les procurer.
Enfin, dans un ordre d’idées très différent, et pour en terminer avec ces quelques réserves, signalons que l’auteur, ancien administrateur des colonies, ayant servi dix-huit ans en Oubangui, de 1949 à 1967, n’est sans doute pas absolument exempt de tout parti-pris, en particulier pour ce qui concerne la description qu’il nous fait, dans la partie du livre consacrée à l’histoire récente, de la mise en route et des aboutissements du processus de décolonisation. Certaines mises au point, croyons-nous, seront un jour nécessaires sur ce sujet.
Mais venons-en aux grands mérites de l’ouvrage de Pierre Kalck.
Il constitue la première tentative d’une monographie historique de cette région de l’Afrique qui est délimitée par les frontières politiques actuelles du nouvel État centrafricain. Il est évident que, du fait même de la nature entièrement artificielle de ces frontières, il n’était guère possible de faire abstraction de l’histoire, en général mieux connue, des pays immédiatement voisins : Tchad, Nigeria, Cameroun, Congo, Soudan. Et c’est précisément en se plaçant ainsi hors des limites formelles du sujet que Pierre Kalck est arrivé à dégager et à bien faire comprendre le rôle de carrefour centrafricain joué depuis les temps les plus reculés dans l’histoire de l’Afrique, par les pays de l’Oubangui, du Haut-Chari et de leurs tributaires. Carrefour, hélas ! qui n’était pas de ceux où se rencontrent des civilisations, où s’échangent des valeurs culturelles, où se forge une unité nationale. Mais plutôt, carrefour des appétits et de la violence, rendez-vous d’une chasse à l’homme cruelle et sans merci, menée par des potentats nègres et arabes, relayés plus tard par les marchands d’esclaves européens. La menace venait de partout, mais surtout, avant le XVIe siècle, des régions nilotiques et du puissant royaume noir du Bornou. Puis, avec la découverte des côtes atlantiques par les Portugais, qui eut pour conséquence ce que l’on a appelé le « retournement » de l’Afrique, le monde entier se mit de la partie. Ce fut l’apogée de la traite des esclaves, de la traite de l’ivoire, des pillages et des massacres.
Enfin, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, s’ouvrit l’ère de la colonisation. Une étude objective, sévère et rigoureuse, sans aucune complaisance ni pour les colonisateurs, ni pour les colonisés, mais sans non plus de dénigrement systématique des actions entreprises au cours de cette période, constitue le deuxième volet de l’ouvrage de Pierre Kalck. Aux convoitises individuelles des esclavagistes succèdent les convoitises politiques, bientôt noblement appelées impériales, des grandes puissances. La convergence des desseins, qu’il s’agisse des Allemands du Cameroun, des Anglo-Égyptiens du Soudan, des Belges du Zaïre, des Français du Congo-Brazzaville, ainsi que les obstacles naturels et humains auxquels ces derniers se heurtent, contribuent incontestablement aux premières prises de conscience de la réalité d’un espace centrafricain où quelque chose d’encore très vague, mais qui se précisera peu à peu, résiste à la soumission par une seule des puissances, comme à la balkanisation au profit de plusieurs.
La période française, celle de la colonie de l’Oubangui-Chari, bientôt insérée dans le cadre plus vaste de l’Afrique équatoriale française (AEF), est appréciée par Pierre Kalck avec sévérité, non pas tellement en raison des activités de l’administration coloniale sur place que de la méconnaissance complète par la Métropole de la véritable nature des problèmes coloniaux. La complaisance dont celle-ci faisait preuve à l’égard des grandes compagnies concessionnaires, dont les exactions furent dénoncées en son temps par André Gide et Albert Londres, n’est pas la moindre preuve de l’inconscience et des carences, trop souvent intéressées, de la « rue Oudinot » [ministère de l’Outre-mer] et des lobbies parlementaires.
Il est important de constater qu’il est aujourd’hui permis, sans pour autant passer pour un esprit chagrin ou un métèque sans patrie, de parler librement et ouvertement de tous les aspects, même négatifs, de la colonisation française en Afrique. Celle-ci a, certes ! été une œuvre civilisatrice qui n’a manqué ni de noblesse, ni de grandeur, mais elle n’a pas été que cela. Pierre Kalck nous l’explique avec beaucoup de modération et de tact, et c’est bien ainsi, puisque le moment est maintenant venu de passer la parole non plus aux hommes politiques et aux colons, mais aux historiens.
Cette histoire de l’Afrique, malgré la précarité des sources et les difficultés de leur interprétation, est en train de faire, en France comme à l’étranger, de très importants progrès. On en jugera par l’ampleur de la bibliographie établie par Pierre Kalck et qu’il publie à la fin de son livre. On regrettera cependant que la plupart des ouvrages cités soient des ouvrages de spécialistes, écrits pour les spécialistes. Le passé africain mérite une plus large audience et le public ne tardera pas à s’en apercevoir si l’initiative brillante de Pierre Kalck ne reste pas isolée. ♦