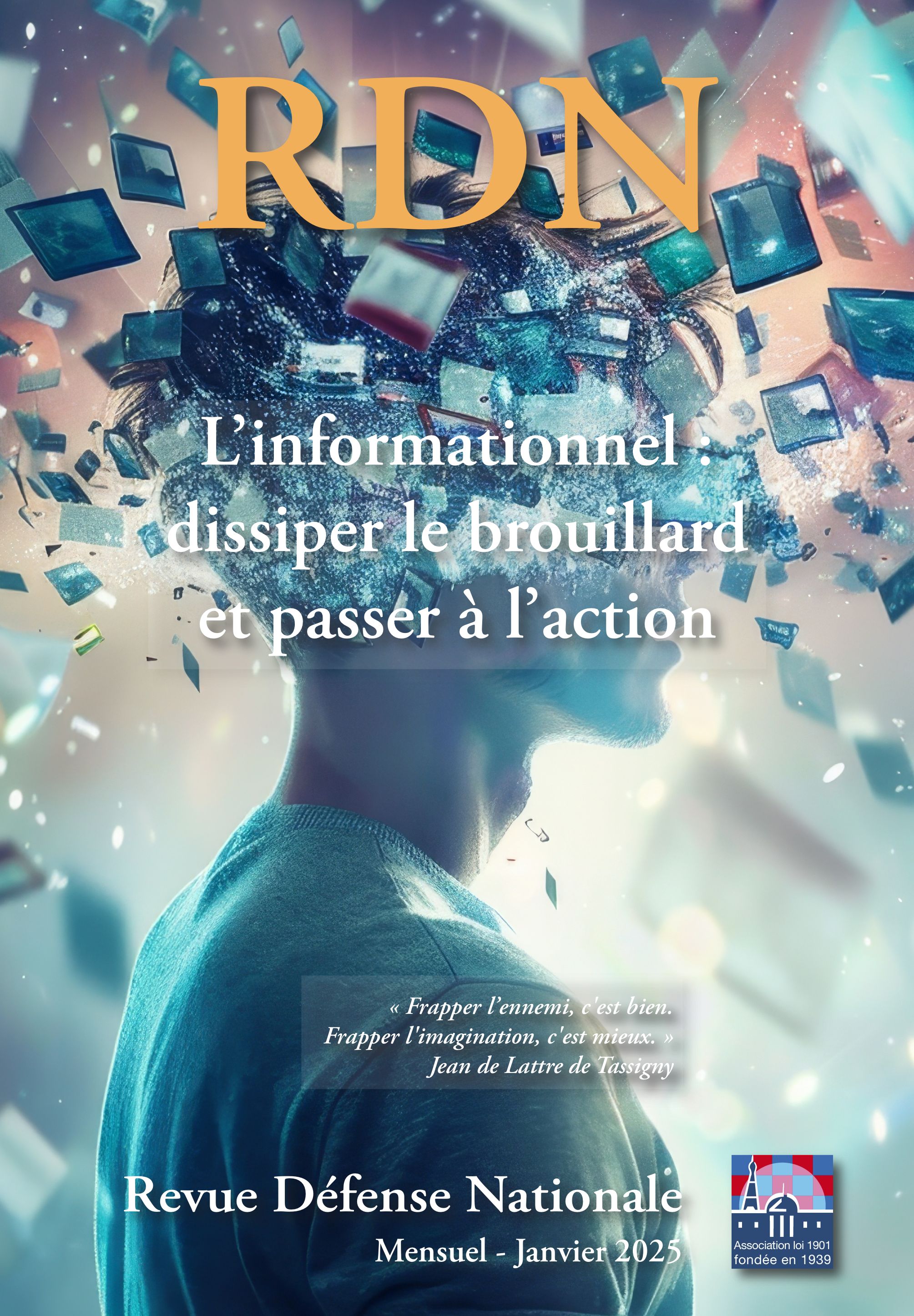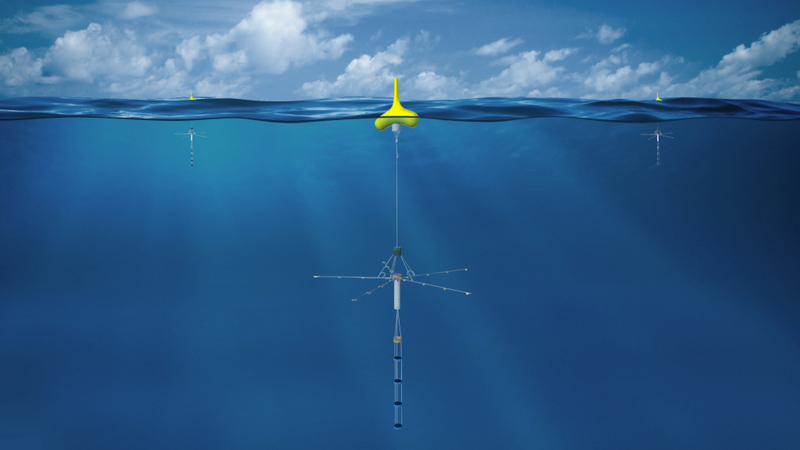Le chemin de la paix
Les récents développements de la carrière de Henry Kissinger confèrent à l’édition française de son Chemin de la Paix une actualité et un piquant que n’avait pas l’édition américaine lors de sa parution en 1964.
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage est une remarquable étude « de l’art de gouverner » – titre de son dernier chapitre – étayée par l’Histoire.
D’abord liées par un même objectif, la défaite de la France de Napoléon, une fois le succès assuré et la France des Bourbons admise à nouveau dans le concert européen au Congrès de Vienne, les grandes puissances se trouvent opposées les unes aux autres par des divergences fondamentales.
C’est alors que l’auteur analyse avec pertinence le mécanisme de la paix préservée de congrès en congrès, de colloques d’ambassadeurs et de ministres en rencontres « au sommet » de souverains, à travers les crises les plus graves provoquées par les aspirations nationalistes, la fermentation sociale, les ambitions territoriales.
Metternich, « héros » de l’ouvrage, nous apparaît, cajolant le Tsar, sermonnant le roi de Prusse, raisonnant Lord Castlereagh. À travers la politique allemande et européenne de l’Autriche, il pallie, pour un temps qu’il s’efforce de faire durer aussi longtemps que possible, les faiblesses internes de l’Empire, inhérentes à la diversité de ses peuples et à l’archaïsme de ses structures sociales et administratives. Ce faisant Metternich préserve la paix et contribue à l’édification d’une Europe qui, à travers bien des tribulations il est vrai, durera cent ans.
Quelques aphorismes de l’auteur éclairent sa philosophie politique ; hasard ou intuition, l’étude et la réflexion l’ont préparé de longue date au rôle qui est le sien dans l’élaboration et la conduite de la politique étrangère des États-Unis : « La guerre, c’est la paix impossible ».
« Un règlement international qui a été accepté et non imposé paraîtra toujours quelque peu injuste à chacun des participants. Le paradoxe de cette situation est que l’insatisfaction générale est la condition même de la stabilité ».
« Des bornes, on sait… que la puissance ne veut pas en connaître : Napoléon l’a prouvé. La solution retenue sera donc fondée sur l’équilibre des forces. Du fait qu’il confère une sécurité relative, celui-ci sera finalement accepté à l’unanimité, et au fur et à mesure que sa légitimité sera tenue pour acquise, les relations internationales revêtiront une souplesse de plus en plus grande ».
Excellent exemple d’une étude historique approfondie – la riche bibliographie et les nombreuses citations en témoignent – menant à une réflexion pénétrante sur les rapports entre Nations et sur la sécurité, cet ouvrage est à lire aussi bien par ceux qu’intéresse cette période que par ceux qui suivent l’actualité. ♦