The French war on Al Qa’ida in Africa
The French war on Al Qa’ida in Africa
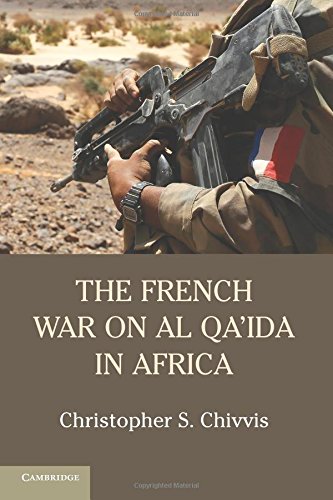 L’opération Serval a fait l’objet de plusieurs livres, dont notamment ceux du général Bernard Barrera, commandant de l’opération à Bamako (1) et de Jean-Christophe Notin (2). L’ouvrage de Christopher S. Chivvis, directeur adjoint des études de sécurité à la Rand International Security and Defense Policy Center, est destiné à un public anglo-saxon, a priori peu familier de l’Afrique et des opérations françaises. Il fait suite à deux rapports du même auteur sur la campagne de l’Otan en Libye. Dans l’un et l’autre cas, il a bénéficié d’un accès privilégié aux sources françaises, en particulier militaires et diplomates qui ont volontiers collaboré avec cet analyste hautement qualifié.
L’opération Serval a fait l’objet de plusieurs livres, dont notamment ceux du général Bernard Barrera, commandant de l’opération à Bamako (1) et de Jean-Christophe Notin (2). L’ouvrage de Christopher S. Chivvis, directeur adjoint des études de sécurité à la Rand International Security and Defense Policy Center, est destiné à un public anglo-saxon, a priori peu familier de l’Afrique et des opérations françaises. Il fait suite à deux rapports du même auteur sur la campagne de l’Otan en Libye. Dans l’un et l’autre cas, il a bénéficié d’un accès privilégié aux sources françaises, en particulier militaires et diplomates qui ont volontiers collaboré avec cet analyste hautement qualifié.
L’ouvrage fait suite à une série de rapports et de documents émanant en particulier de la Rand Corporation, se penchant sur le « modèle français » d’intervention militaire et évaluant sa pertinence actuelle pour les Américains. Il s’inscrit dans la continuité d’un débat sur le concept de contre-insurrection, très influencé par les déceptions et difficultés rencontrées aussi bien en Irak qu’en Afghanistan et qui concerne autant les think tanks proches du Pentagone que les milieux militaires et politiques.
Or, on est aujourd’hui loin de l’époque où l’échec vietnamien encourageait la lecture au sein des académies militaires américaines de Galula (le général Petraeus lorsqu’il commandait en Irak fit retraduire les ouvrages de ce dernier) et de Trinquier. D’où l’intérêt politique pour le lecteur américain de l’ouvrage de Christopher S. Chivvis sur l’opération Serval, à un moment où les politiques outre-Atlantique s’interrogent sur l’opportunité des interventions extérieures des États-Unis et où monte l’isolationnisme : l’expérience militaire française continue de fasciner dans la mesure où des résultats politiques incontestables ont été atteints avec des moyens militaires, somme toute, limités par rapport aux capacités habituellement mis en œuvre pour les opérations américaines. Pour l’auteur la leçon est claire : on peut donc intervenir efficacement avec des moyens raisonnables.
Dans le cas du Mali, des effectifs français limités – 4 500 hommes au plus fort de l’opération en mars 2013 – ont mené pendant dix-huit mois de durs combats dans un théâtre difficile, offrant de surcroît une élongation logistique maximale. Ils ont représenté moins du 1/10e des effectifs américains en Afghanistan, à leur niveau maximum, dans un pays, le Mali, dont la population atteint pourtant presque la moitié de celle de l’Afghanistan, et pour des coûts (officiellement 617 millions d’euros) sans rapport avec l’investissement américain et de l’Otan. Dès lors, on comprend la conclusion générale que tire l’auteur de l’expérience de Serval : les États-Unis peuvent apprendre aujourd’hui du « modèle français ». Pour lui, il se caractérise par une série de facteurs : rapidité du processus de décision politique et militaire pour l’engagement des forces, la cohérence de l’articulation des forces (ISR, forces spéciales, groupements terrestres, forces aériennes à la fois pour les frappes de précision et la logistique).
Il souligne également le soin pris à assurer le suivi des opérations en assurant le relais des forces françaises par des contingents des pays de la région, ainsi que, pour la formation, de l’Union européenne et des Nations unies.
L’auteur est toutefois suffisamment averti pour savoir que chaque crise a ses caractéristiques et une dynamique propres qui pèsent nécessairement sur la conduite des opérations. Pour lui, Serval s’est située dans un contexte africain spécifique dont la France a su tenir compte : une situation locale à Bamako complexe et un risque de voir s’établir au cœur du Sahel un sanctuaire djihadiste (un Malistan) ; un irrédentisme ancien des Touaregs du Nord qui complique les rapports et entretient la méfiance avec les autorités maliennes ; des États-Unis et un Conseil de sécurité sceptiques, jusqu’au dernier moment, qui ne réagissent finalement que lorsqu’intervient la surprise de la descente des rebelles vers Bamako avec le risque de voir une cité d’un million d’habitants conquise par moins d’un millier de combattants de différentes factions alliées à Al-Qaïda ; une attitude d’Alger plus qu’ambiguë ; enfin, un théâtre d’opération de très grandes dimensions et dont la sévérité implique de la part des forces françaises, notamment lors des rudes combats dans le massif des Ifoghas, des performances exceptionnelles et une logistique sans faille.
L’ouvrage, très documenté, relate avec précision toutes les étapes de la montée et du déroulement de la crise et de l’intervention française : situation à Bamako et coup d’État de Sanogo, médiation interafricaine, alliances changeantes et rivalités dans les différents groupes djihadistes et de leurs alliés (Aqmi, Ansar Dine, MUJAO, MNLA), rapidité de l’engagement des forces françaises, recherche de soutiens interafricains et européens. La coopération dans la crise malienne entre la France et les États-Unis fait surtout l’objet de développements largement inédits.
L’appel du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le 11 janvier 2012 à son homologue américain Leon Panetta surprend ce dernier : du côté français, on indique que l’opération a déjà commencé compte tenu de l’urgence de la situation sur le terrain. Toutefois, si la France a décidé d’agir seule, une aide américaine notamment au niveau de l’ISR et des ravitailleurs serait bienvenue. Le ministre américain, pour qui l’Afrique est une priorité de troisième ordre, en dépit du récent assassinat à Benghazi de l’ambassadeur des États-Unis (qui vaudra à Hillary Clinton, Secrétaire d’État, de sévères critiques au Congrès) mais qui est sensible au danger djihadiste, promet immédiatement son concours. Celui-ci va cependant se heurter, à des problèmes bureaucratiques à Washington, qui ne seront surmontés qu’avec lenteur à l’agacement français.
Au Conseil de sécurité des Nations unies, l’attitude des États-Unis face à la crise malienne est au départ très critique. L’ambassadeur Susan Rice va jusqu’à qualifier publiquement les propositions françaises mises sur la table du Conseil de sécurité de « crap » (« foireuses »). Le Département d’État campe en effet sur une position idéologique qui place en priorité « le retour du Mali à la démocratie » et explique qu’une aide à Bamako, compte tenu du coup d’État intervenu, constituerait un « mauvais précédent pour l’Afrique ». Du côté du Pentagone, on demeure extrêmement sceptique sur la capacité militaire des forces africaines, dont la France explique pourtant qu’elles doivent être associées aux opérations, notamment pour la phase de stabilisation. Les deux positions se conjuguent en faveur de l’immobilisme de Washington, alors même que les événements se précipitent sur le terrain.
La donne internationale de l’opération va rapidement se transformer avec le succès de l’intervention immédiate des forces françaises, notamment aériennes dans les premiers jours, pour empêcher les colonnes djihadistes de passer la boucle du Niger, le soutien immédiat de tous les pays africains de la région, le changement d’attitude de l’Algérie à la suite de l’attaque de l’installation gazière d’In Amenas et les premiers concours européens au niveau logistique (Grande-Bretagne, Belgique, Danemark, Allemagne). Les États-Unis vont donc coopérer pleinement mais, comme le note Christopher S. Chivvis, la situation qui les voit s’associer (plug in) à une opération conduite par la France ne leur est pas familière. L’excellence des rapports entretenus au niveau militaire – et en particulier entre les responsables du commandement d’AFRICACOM et leurs homologues français – jouera donc pour beaucoup. Par la suite, dans le cadre de l’opération Barkhane, on verra même certains moyens américains placés pour la première fois sous contrôle opérationnel français.
L’auteur, tout au long de son analyse de l’opération, souligne le rôle du décideur politique : ainsi la décision de donner la priorité à la reconquête de Tombouctou, en raison de la notoriété et du caractère symbolique de la ville, par rapport à la poursuite de l’opération sur Gao. Il montre également la part de risques calculés pris par le commandement français : présence de cellules dormantes djihadistes au sein des populations dans des villes reconquises, élongation du théâtre et défis logistiques rencontrés : une rupture de la chaîne des approvisionnements vers le nord, en plein désert, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Il souligne enfin, force détails à l’appui, comment lors des combats dans le massif des Ifogas, les combattants français, dans un milieu particulièrement hostile et à bien des égards plus difficile que celui de l’Afghanistan, ont su coopérer avec les combattants tchadiens.
De l’ensemble de l’ouvrage, qui présente l’intervention française sous un jour particulièrement favorable se dégage pour l’auteur une triple conclusion.
• Le djihadisme demeure pour longtemps un danger en Afrique. Il estime que l’opération Serval a permis de détruire un millier de combattants et d’importants stocks d’armes, souvent venus de Libye. Toutefois, qu’il s’agisse de Boko Haram au Nigeria, des Shebabs en Somalie ou de l’ISIS en Libye, le danger de métastases demeure, y compris au Sahel, compte tenu de la faiblesse des États de la région. Les États-Unis ne peuvent s’en désintéresser et la France, de par sa présence et de ses liens avec les pays de la région est pour eux un partenaire indispensable.
• Le débat sur les avantages et les coûts des interventions, relancé aux États-Unis par le chaos après l’opération de l’Otan en Libye souligne l’importance essentielle du suivi de l’opération militaire proprement dite par une phase de stabilisation intelligemment menée avec les partenaires régionaux et internationaux, dont les Nations unies. Pour les Européens, c’est déjà un constat évident. L’auteur souhaite le faire partager à ses lecteurs anglo-saxons.
• Il lui paraît enfin important lorsque s’effectue le bilan d’une opération du type de Serval de s’interroger non pas tant sur tel ou tel aspect de sa conduite et de son coût mais bien sûr ce qu’auraient été les conséquences politiques et militaires d’une abstention et de la dégradation durable de la situation qui en aurait résulté.
De ce point de vue, l’auteur décerne la meilleure note à l’intervention française. ♦
(1) Opération Serval, Éditions du Seuil, 2015, avec une préface du général Bentegeat.
(2) La guerre de la France au Mali, Éditions Tallandier, 2014.







