Civilisation – Comment nous sommes devenus américains
Civilisation – Comment nous sommes devenus américains
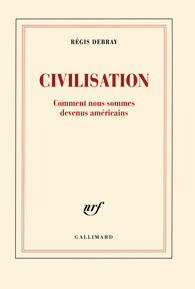 Contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre, ce récent ouvrage du prolifique Régis Debray n’est pas décliniste. Ou plutôt si. À la nuance près que pour son auteur, le déclinisme n’est pas une tare, mais une approche à la fois réaliste et optimiste. Réaliste car « l’érosion est la loi objective de la nature ». Optimiste car si nous sommes peut-être « devenus américains », comme le suggère l’auteur, « qui a dit que sortir de l’histoire oblige à broyer du noir ? ».
Contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre, ce récent ouvrage du prolifique Régis Debray n’est pas décliniste. Ou plutôt si. À la nuance près que pour son auteur, le déclinisme n’est pas une tare, mais une approche à la fois réaliste et optimiste. Réaliste car « l’érosion est la loi objective de la nature ». Optimiste car si nous sommes peut-être « devenus américains », comme le suggère l’auteur, « qui a dit que sortir de l’histoire oblige à broyer du noir ? ».
Car c’est bien un acte de décès de la civilisation européenne que dresse Régis Debray, en brodant sur la clairvoyance de Paul Valéry qui, dès 1919, soulignait dans La Nouvelle Revue Française le caractère mortel des civilisations. Tout commence par un rappel sur la « réalité pressante et concrète » qu’est une civilisation, dont le « flou » apparent – qui rend délicate en première approche la définition d’une civilisation – est en réalité la preuve ultime de succès. Plus qu’une simple culture (par nature défensive et stérile), une civilisation (par nature offensive et féconde) est en effet un tout diffus mais très concret, dont la victoire est pleine et entière dès lors qu’elle n’a plus besoin de la force pour progresser. Et l’auteur de montrer comment la civilisation américaine, après avoir intériorisé et simplifié les idées européennes, a opéré au XXe siècle un magistral transfert inverse pour faire de l’Europe une annexe de son empire immatériel.
De quand date cette bascule ? Pour Régis Debray, ce transfert s’est opéré progressivement à partir de 1919, date du Traité de Versailles, où, pour la première fois depuis deux siècles, le texte français d’un accord international ne fait plus foi, le président Wilson exigeant une version en anglais. Comment cela s’est-il réalisé ? Sans heurts, à la faveur d’une douce subjugation de la religion et de la politique – les deux piliers de la psyché européenne – par l’économisme, idéologie qui aurait tout emporté sur son passage. Pour en convaincre le lecteur, l’auteur passe en revue l’évolution récente de tous les rayons de la vie matérielle, intellectuelle et culturelle française et européenne. Il fait notamment revivre sous nos yeux un savoureux Hibernatus imaginaire qui reprend vie en 2010 après une congélation en 1960 : le résultat est saisissant, et la distanciation provoquée offre une illustration éclatante de la mutation culturelle qui s’est opérée. Une chronologie sélective, du Traité de Versailles au président Macron écoutant La Marseillaise dans la posture du citoyen américain – bras droit replié, main sur le cœur – vient appuyer le propos.
Mais au fond, est-ce un vrai changement ? Oui, répond Régis Debray, en montrant à quel point la trinité mentale américaine – espace, image, bonheur – est opposée à la matrice de l’esprit européen – temps, écriture, sens du tragique. À travers l’opposition de la civilisation fille à sa mère historique, le lecteur prend conscience de la greffe réalisée en un siècle. Une greffe lente, mais remarquablement réussie. Car si l’empire- civilisation américain cumule les attributs classiques des empires qui l’ont précédé, celui-ci présente une originalité qui le rend particulièrement irrésistible : en réussissant la synthèse de l’hypersouverainisme et de l’hyperindividualisme, la « nouvelle Rome » réalise « un enveloppement par le haut et par le bas » bien plus efficace que l’occupation romaine en son temps. « Personne ne naît américain, mais tout le monde peut le devenir ». Et sans honte aucune, bien au contraire. Car, in fine, « nous ne sommes ni occupés, ni vaincus », mais simplement consentants. « Le miracle de l’hégémonie », selon Régis Debray.
Enfin, le principal mérite de cet ouvrage est sans doute de remettre en perspective historique ce transfert civilisationnel, en montrant que si une culture peut mourir, les civilisations, elles, se transforment. Et de souligner les bienfaits de toute période de décadence d’une civilisation, période féconde en forme d’apothéose. Telle est la période que nous vivons selon l’auteur. Oui, c’est la fin, mais elle annonce une suite : « cela s’appelle la transmission ».
Si le lecteur n’aura sans doute pas les écailles qui tombent des yeux en refermant cet ouvrage d’un auteur dont le positionnement vis-à-vis du grand cousin américain est tranché, au moins aura-t-il le sentiment d’avoir pu mettre des mots sur ce « flou d’apparence » qui caractérise le glissement culturel à l’œuvre.
S’agissant du fait militaire, s’il est peu mentionné, l’analyse de Régis Debray s’applique en grande partie à l’influence américaine auprès de ses alliés, le « gouvernement par la norme » en étant un des principaux aspects. Dans ce domaine, la greffe civilisationnelle – disons plutôt culturelle en l’occurrence – est toutefois beaucoup plus explicite qu’elle ne l’est dans la sphère sociale, en particulier depuis la fin de la guerre froide. Notre « Art européen de la guerre », si tant est qu’il puisse être défini, en sort-il grandi ? Voilà un sujet ! ♦







