La Guerre. La penser & la faire
La Guerre. La penser & la faire
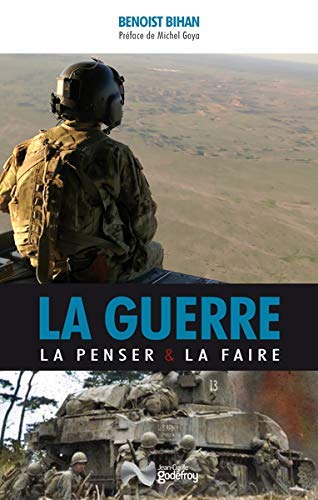 Les armées françaises sont confrontées de plus en plus fréquemment, considère Benoist Bihan dans son nouveau livre La Guerre. La penser & la faire, « au dilemme d’avoir davantage de missions stratégiques à remplir que de moyens pour les conduire simultanément dans de bonnes conditions opérationnelles et tactiques », alors que les conséquences politiques d’un revers seraient profondes. Or, « préparer des forces armées à la guerre future dans un contexte économique difficile, et ne disposer pour cela ni des effectifs ni des budgets minimaux nécessaires, est un scénario auquel les armées françaises seront très certainement confrontées d’ici peu », estime-t-il.
Les armées françaises sont confrontées de plus en plus fréquemment, considère Benoist Bihan dans son nouveau livre La Guerre. La penser & la faire, « au dilemme d’avoir davantage de missions stratégiques à remplir que de moyens pour les conduire simultanément dans de bonnes conditions opérationnelles et tactiques », alors que les conséquences politiques d’un revers seraient profondes. Or, « préparer des forces armées à la guerre future dans un contexte économique difficile, et ne disposer pour cela ni des effectifs ni des budgets minimaux nécessaires, est un scénario auquel les armées françaises seront très certainement confrontées d’ici peu », estime-t-il.
Le problème n’est pas nouveau. Les Livres blancs de 2008 et 2013 se contentaient en effet de demander aux armées des contrats de déploiement sans préciser face à qui. « Nul objectif de puissance à atteindre et nul plan d’emploi des forces pour y parvenir face à des adversaires possibles », remarque ainsi le colonel (er) Michel Goya dans la préface du livre. La « grande politique » que notre pays a connue en d’autres temps est remplacée aujourd’hui par un emploi « à la demande » des forces armées. On empile alors les opérations militaires, poursuit Goya, « parce que c’est facile bien plus que parce que c’est efficace », alors que la conception même des opérations devrait être faite d’emblée en fonction du but stratégique, de la « paix » désirée.
Dès lors « comment poser le cadre de la victoire… dans des conflits qui mettraient en jeu les intérêts vitaux de la nation » se demande Benoist Bihan ?
Ce livre regroupe 58 chroniques précédemment publiées dans la revue Défense & Sécurité internationale (entre 2011 et 2015), consistant, par petites touches impressionnistes, que le colonel Goya compare plutôt à des pions du jeu de go, à approcher une notion unique : le concept de stratégie, en la distinguant surtout de ce qu’elle n’est pas.
Quelques préoccupations majeures se détachent : une réflexion sur les conditions de l’efficacité opérationnelle, sur la notion de victoire, sur le temps en stratégie, sur les cultures stratégiques, sur le déclin de la pensée stratégique française…
« Une règle empirique de l’efficacité militaire semble bien être que la victoire tend à revenir au camp doté de la meilleure organisation combattante », nous explique Bihan. Cette règle se heurte souvent aux lourdeurs des cultures militaires nationales, comme nous le montre une armée britannique encore attachée à son système régimentaire au risque de négliger la nécessaire intégration interarmes.
Les armées d’aujourd’hui conservent des structures héritées de la Seconde Guerre mondiale, tout en étant beaucoup plus avancées techniquement, mais moins perfectionnées sur le plan organisationnel que leurs devancières. Pour Benoist Bihan, « on assiste ainsi « au bégaiement d’une pensée limitée par la technologie et incapable de faire mieux qu’optimiser jusqu’à l’absurde des armées bâties sur des modèles issus de la Seconde Guerre mondiale ». Il existerait pourtant un potentiel organisationnel latent qui n’a pas encore été exploité. D’où son appel à réhabiliter l’« organique », défini comme une approche systématique et raisonnée de l’organisation opérationnelle des forces armées. Et cela d’autant plus que, comme l’auteur nous le rappelle fort pertinemment, la performance militaire n’est pas gage d’efficacité stratégique. L’exemple de l’armée américaine entre les deux guerres montre ainsi que « la valeur d’une armée résiderait d’abord et avant tout dans son aptitude à poser dès le début des hostilités le cadre de la victoire, au travers d’une préparation essentiellement intellectuelle plutôt que matérielle et technique ».
Mais qu’est-ce donc que la victoire ? Les armées occidentales reproduisent dans leurs doctrines l’idée que la victoire militaire a une valeur positive en soi, et qu’elle conduit mécaniquement au succès stratégique, alors même que l’ensemble de l’histoire militaire démontre le contraire. Si en effet sur le plan tactique la décision est souvent payante, il n’en est pas nécessairement de même au niveau opératif. D’où la nécessité de revenir à la définition clausewitzienne : « La victoire est un acte politique par lequel un acteur stratégique soumet, par tous les moyens qu’il juge bon, son ennemi à sa volonté. »
On ne peut que penser à la situation de nos armées au Mali lorsque l’auteur nous explique que « sans désigner d’ennemi, sans définir des buts de guerre… et surtout sans impliquer, sans mobiliser d’une manière ou d’une autre le corps politique… nous sommes condamnés à panser les crises sans les résoudre ». Nous partageons également son analyse selon laquelle l’« approche globale », tant vantée ces dernières années, témoigne d’un refus de penser en termes stratégiques, puisqu’elle vise à conduire à la paix sans poser au préalable la question des buts de guerre. Mais cette carence est plus profonde car, pour Bihan, « on chercherait en vain dans la France d’aujourd’hui la libre réflexion stratégique présidant à l’élaboration de la stratégie nationale ». Nous subissons en effet le poids d’un « déterminisme géopolitique ancré dans la théorie des relations internationales et dont l’ambition est normative ». L’auteur pourrait aller plus loin et entreprendre une réflexion sur la notion d’intérêts vitaux, ainsi que sur l’utilité et les dangers des alliances.
Notre époque est peut-être après tout celle de la décadence de la pensée stratégique française. Si dans le passé, notre pays a vu émerger de remarquables penseurs stratégiques, ceux-ci ont été, admet l’auteur, « des créateurs de concepts, et pas uniquement les explorateurs de ceux inventés par d’autres ». Or, depuis quelques années, le développement quantitatif de la pensée stratégique française « s’est fait presque exclusivement sur des thématiques et des concepts développés ailleurs, pour l’essentiel aux États-Unis ». La conséquence est sévère et nous la partageons pleinement : « Depuis la fin de la guerre froide, la France ne semble pas avoir été en capacité de produire un seul concept stratégique novateur. Elle s’est contentée pour l’essentiel d’un suivisme qui, s’il a pu produire des études de qualité, a sanctionné un déclassement intellectuel de la France dans le domaine stratégique. »
Ce constat ne remet pas en cause l’existence d’un « modèle militaire français » qui a brillamment fait la preuve de son efficacité dans l’histoire. Ce modèle est basé sur le fantassin léger, depuis les zouaves et les chasseurs à pied du XIXe, qui combattent en tirailleurs, alors que l’infanterie de ligne de 1914 continue à être employée en masses compactes. Le général Bigeard le qualifiera de « souple, félin et manœuvrier »… Si ce modèle s’est imposé, c’est certainement par insuffisance d’équipements pourrait-on ajouter. Les pénuries budgétaires qui frappent l’armée française de façon récurrente ne datent pas d’aujourd’hui. On se souvient de nos carences en artillerie lourde en 1914.
Cet appauvrissement des moyens a cependant des conséquences d’ordre stratégique, car, les armées françaises, nous explique Bihan, « fondent trop souvent leur stratégie des moyens sur une culture privilégiant des matériels petits… mais fragiles et manquant de puissance ». Ainsi « dévoyée, la légèreté est devenue le prétexte d’une stratégie des moyens au rabais, déconnectée des réalités tactiques et des techniques de combat moderne, mais aussi de la finalité opérative et stratégique de l’emploi des forces ». Le jugement est peut-être trop sévère et fait l’impasse sur un certain nombre de réussites sur le plan tactique qui ne sont pas passées inaperçues auprès de nos alliés, comme l’opération Serval au Mali en 2013. Il n’en reste pas moins que l’on doit considérer que la tendance traditionnelle de l’armée française de « faire mieux avec moins » comporte nécessairement des limites et que celles-ci ont été atteintes depuis longtemps. Nous ne pouvons ainsi qu’approuver la proposition de l’auteur selon laquelle « il faut repenser à la fois l’emploi de la masse dans l’art de la guerre, mais aussi adapter notre stratégie des moyens de manière à garantir l’obtention de cette masse suffisante » et cela notamment avec une véritable « stratégie des moyens humains ».
Attention cependant aux fausses pistes que la facilité pourrait suggérer. Bihan appelle en effet de ses vœux une « mobilisation intégrale » en cas de conflit, impliquant la société civile qui soutiendrait alors de l’intérieur l’action extérieure des armées. L’auteur nous donne l’exemple du Nord-Vietnam dans les années 1960 et 1970. Fort bien, c’est effectivement un bel exemple de résilience, mais sommes-nous sûrs que la majorité de nos concitoyens apprécieraient les contraintes d’un tel modèle de société ? Plus concrètement, cette notion de « mobilisation intégrale » a-t-elle un sens dans un pays fragmenté comme le nôtre, où un certain nombre d’industries critiques pour la défense ont été vendues à des capitaux étrangers, où le lien armée-nation a été rompu depuis 1996 et où les armées peinent à recruter ? On peut au moins se le demander.
Finalement, la bonne question à se poser ne serait-elle pas de définir quel type de société nous souhaitons et par conséquent quels postes budgétaires devraient être privilégiés par rapport à d’autres dans la dépense de l’État ? Dans La Dernière bataille de France, le général Vincent Desportes s’indigne, fort justement, que le budget militaire ne soit que le cinquième budget de l’État par ordre décroissant, le quatrième étant celui des subventions aux associations…
L’implication des militaires dans ce débat devrait être, selon nous, encouragée. « Une réforme militaire réussie est d’abord une réforme politique réussie », nous rappelle en effet Benoist Bihan. Son succès suppose de penser de manière intégrale en envisageant ses conséquences possibles sur la nation et sur l’environnement stratégique. Or, les forces armées ont le défaut de se cantonner à leur « cœur de métier », l’acte technique du combat. De la sorte, poursuit-il, « en demeurant politiquement incompétents, les actuels réformateurs militaires se condamnent à l’impuissance ». « Incompétence » encouragée en sous-main, pourrions-nous ajouter, par les politiques…
Bihan expose à plusieurs reprises l’idée, quelque peu irénique, de la nécessité qu’il y aurait de former séparément des « leaders stratégiques », des « décideurs opératifs », dont on comprend qu’il ne s’agirait pas de militaires et qu’ils n’auraient par conséquent aucune expérience de la pratique de la guerre moderne… Il nous semble, au contraire, qu’il serait souhaitable d’inciter les militaires à aborder sans crainte le niveau stratégico-politique dans lequel leur expertise pèserait certainement de plus de poids que celle de « spécialistes » des relations internationales qui ne manqueraient pas de venir phagocyter cette fonction nouvelle…
Le livre nous offre également une bonne analyse des cultures militaires française, allemande et américaine. Il comporte un chapitre, tout à fait bienvenu, sur l’organisation allemande du commandement avec le tandem traditionnel composé du commandant de l’unité et de son « Ia » (« premier officier d’état-major » chargé des opérations). Dans cette ligne, l’auteur nous dit souhaiter pour nos armées une décentralisation de la décision avec la « subsidiarité du commandement ». Cette solution est souhaitable, mais est-elle encore d’actualité aujourd’hui, tant elle semble antinomique avec l’esprit du programme Scorpion ?
De même, il nous paraît évident que le commandement n’est pas une simple « discipline technique de l’art militaire » comme semble le considérer Benoist Bihan ; il en est l’essence même. L’École spéciale militaire de Saint-Cyr n’est pas qualifiée officiellement par nos armées de « Grande école du commandement » ?
Benoist Bihan nous rappelle souvent que ce sont les nations et non pas les armées qui font la guerre. Il en arrive ainsi à se demander, dans un texte de 2015, si l’opinion publique pourrait être considérée comme un acteur stratégique rationnel. Pour lui, l’opinion se fait fréquemment « l’écho de l’évolution d’une situation stratégique qu’elle perçoit souvent mieux que ne le font ceux qui conduisent la guerre ». À condition que l’opinion soit valablement informée, pourrions-nous ajouter, ce qui est de moins en moins le cas en raison du contrôle très efficace des médias et, de plus en plus, des réseaux sociaux, par les gouvernements sous prétexte de fact-checking. À noter également un chapitre tout à fait intéressant sur la polyvalence des matériels. Dans le domaine aérien notamment, la polyvalence des matériels serait ainsi « la conséquence d’un niveau de danger historiquement faible ». Un niveau de danger plus élevé avantagerait des matériels plus spécialisés. On pourrait y opposer le contre-exemple du BCR français (1) dans l’entre-deux-guerres, alors que le niveau de danger était à l’évidence fort élevé !
Enfin, Benoist Bihan revient utilement sur un certain nombre d’erreurs communes. Il dénonce ainsi l’illusion selon laquelle il existerait une solution technique à tout problè me stratégique. C’est notamment le cas des « frappes de décapitation », vaines tentatives de trouver une solution simple à un problème complexe, on l’a vu récemment. De même, l’avènement de la cartographie dans les siècles précédents, a conduit à « l’idée que la transposition à des espaces plus vastes de manœuvres géométriques pratiquée dans le domaine tactique est désormais possible ». Or, nous explique-t-il, « une stratégie est fondamentalement la déclinaison d’une trajectoire politique dans le temps, la géographie n’étant que l’espace de son expression ». « En matière de stratégie, précise-t-il, il s’agit avant tout de correctement observer l’environnement, d’évaluer le champ des possibles avant de s’orienter vers un de ceux-ci, qui corresponde le mieux aux objectifs visés. Ce n’est que par la suite que le temps intervient, sous la forme de fenêtres d’opportunités dont il s’agit de se saisir, ou d’événements auxquels il est indispensable de réagir à temps ». Ce qui conduit naturellement Benoist Bihan à une réflexion sur la synchronisation, « clé de la décision opérative ».
On pourrait reprocher à l’auteur une critique, peut-être un peu trop forcée, de l’« approche indirecte » de Liddell Hart. L’approche indirecte consiste pour l’attaquant à arriver « sur un adversaire surpris et non préparé à lui faire face », à disloquer au préalable « l’équilibre psychologique et physique de l’ennemi ».
L’approche indirecte n’est donc nullement une « formule » ou une « martingale miraculeuse », comme semble le soutenir l’auteur, mais plutôt, comme son nom l’indique, une façon d’agir, une attitude, une règle de conduite. L’idée étant d’attendre l’adversaire non là où il est fort mais, là où il est vulnérable, de suivre la « ligne de moindre résistance ».
La Guerre. La penser & la faire de Benoist Bihan est, on l’a compris, un livre stimulant qui a le mérite d’ouvrir un certain nombre de pistes de réflexion fructueuses où la pensée foisonnante de l’auteur joue à plein, même si certains esprits chagrins peuvent lui reprocher d’être parfois un peu « hors sol ». ♦
(1) NDLR : programme d’un avion « bombardement-combat-reconnaissance ». Le Potez 54 fut alors choisi et entre en service en 1935. Il était déjà obsolète en 1940.






_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)

