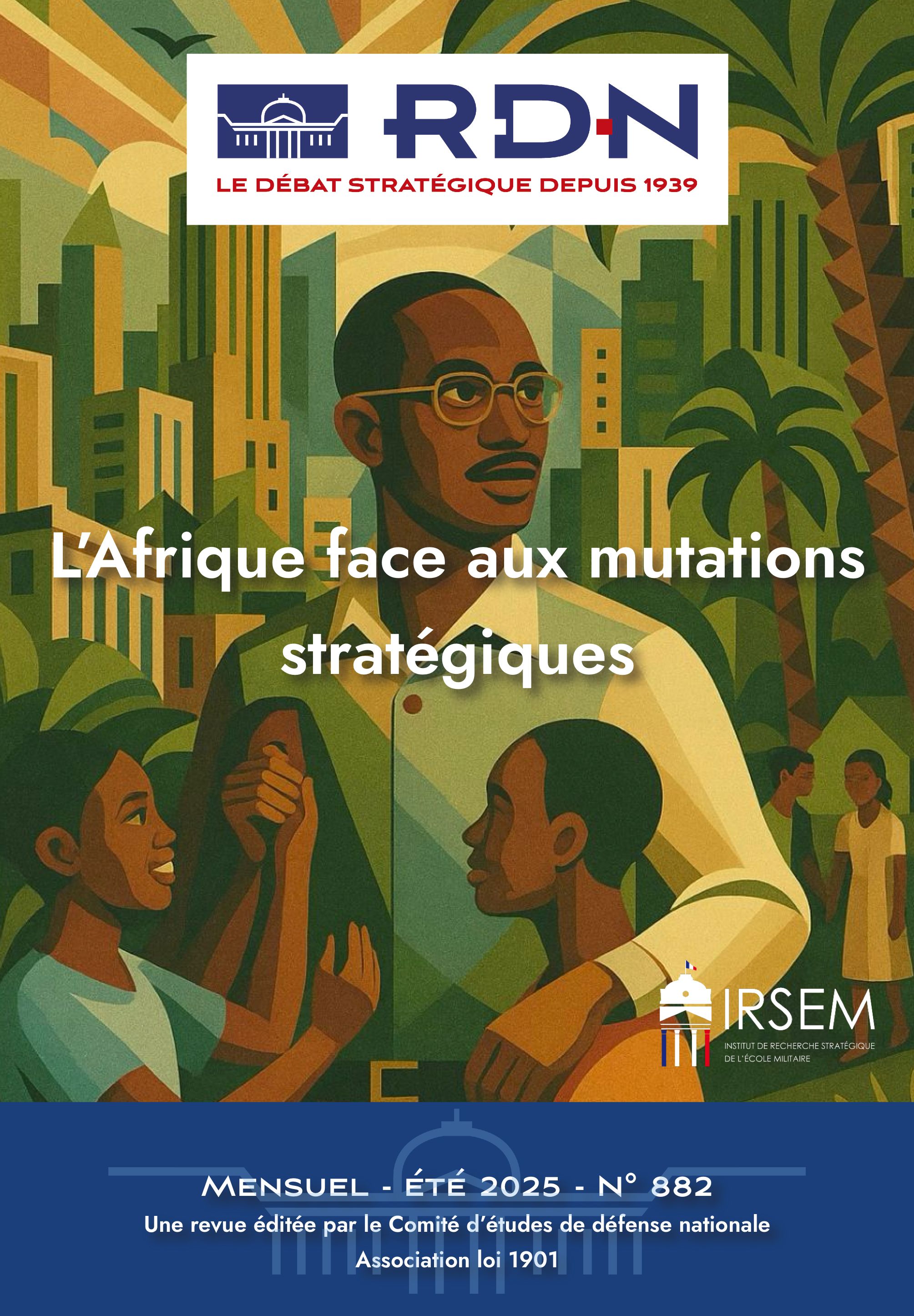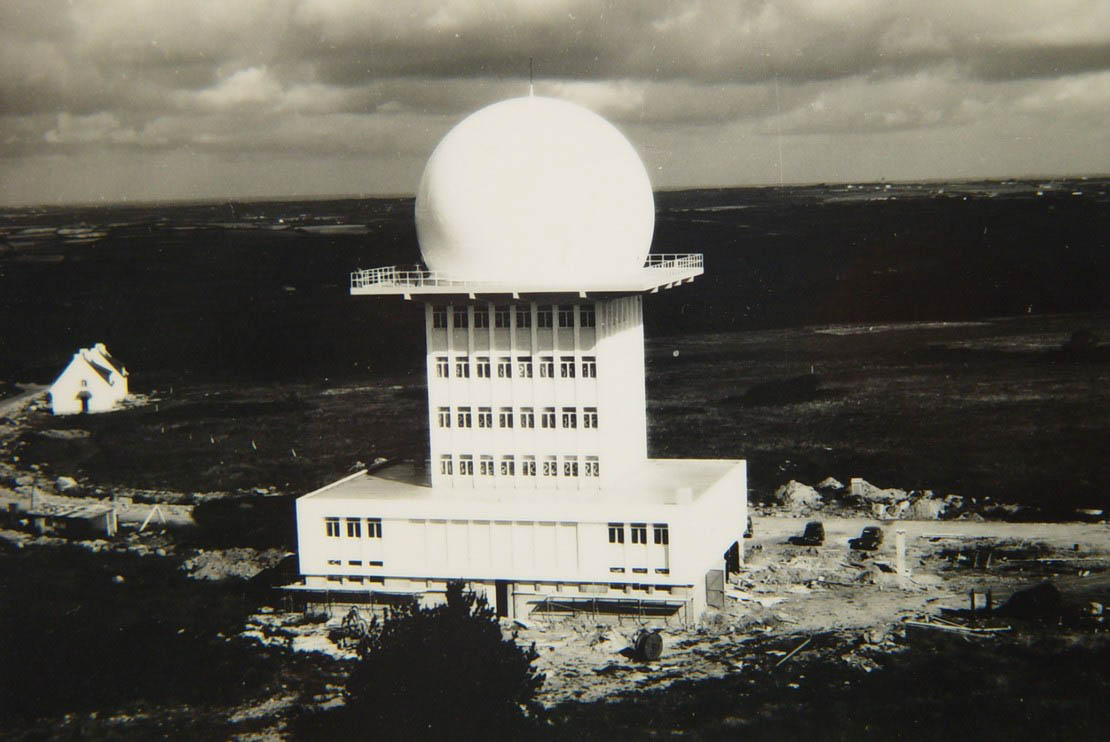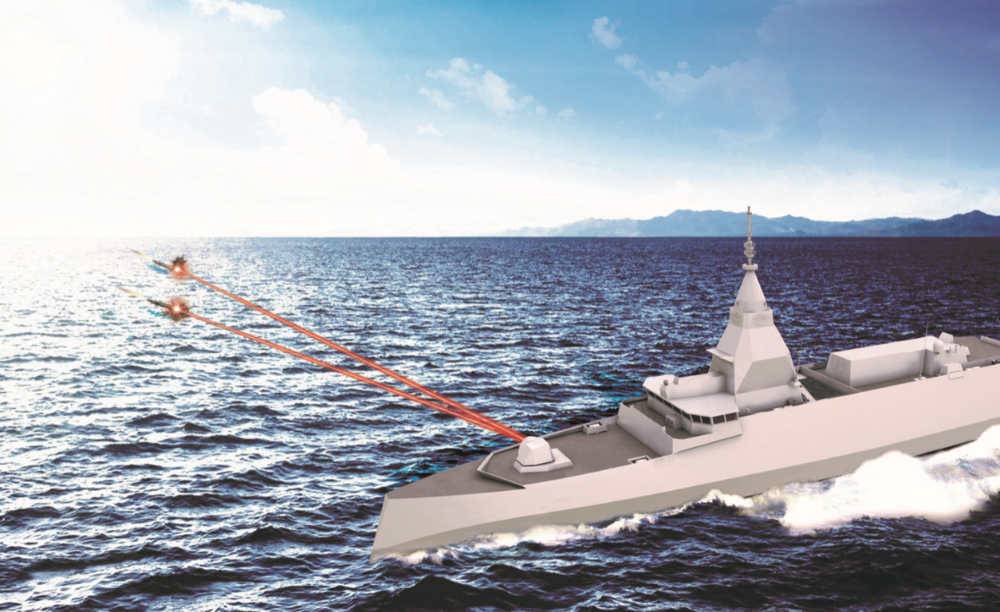L'industrialisation de l'Algérie
Dans l’image traditionnelle de l’Algérie, les palmiers et les futailles trônent au premier plan, dissimulant les champs de blé et les montagnes de fer. De hautes cheminées, de murs noircis par la fumée, de réseaux compliqués de câbles et de rails, il n’est pas question ici, et pour cause. À la veille de la guerre, l’Algérie ne comptait qu’un petit nombre d’entreprises industrielles travaillant sur une grande échelle. Si on excepte les usines à gaz, les usines électriques et quelques autres, la plupart d’entre elles, issues d’un atelier artisanal et demeurées entre les mains du fondateur, n’occupaient qu’un personnel restreint et ne possédaient qu’un outillage réduit, permettant tout au plus des réparations ou le montage de pièces importées. L’Algérie laissait à d’autres la transformation de ses ressources naturelles : tout le fer, tout le zinc était exporté, tout l’alfa vendu en Angleterre d’où il revenait sous forme de papier et le kieselguhr (terre d’infusoires) des environs d’Oran partait pour l’Allemagne où il était employé — nous l’avons appris depuis à nos dépens — dans des fabriques d’explosifs. Bref, après un siècle de colonisation française, l’Algérie ne possédait pas de grande industrie.
À vrai dire, cette situation ne lui était pas particulière ; on la retrouvait identique en Tunisie, au Maroc, en A. O. F., dans toutes les colonies françaises, Indo-Chine exceptée. Si quelques esprits chagrins le déploraient, le Français moyen s’en accommodait sans trop de regrets. Dans le cas de l’Algérie en particulier, il trouvait à cette carence deux explications qui lui suffisaient : absence de combustibles, absence de main-d’œuvre spécialisée. L’Algérie, en effet, ne possède qu’une mine de charbon, Ivenadsa, et cette mine est située à 770 kilomètres d’Oran, en plein désert. Les veines sont minces, fréquemment barrées de schiste ; avant la guerre, le prix de revient était si élevé, par rapport aux cours mondiaux, qu’on avait dû réduire l’extraction. On ne pouvait songer à remédier à cette pauvreté en houille avec les combustibles liquides, puisque l’Algérie ne produit pas de pétrole, ou si peu — 0,11 % de la consommation en 1939 — que ce n’est pas la peine d’en parler.
D’autre part la population musulmane, essentiellement rurale, n’est nullement préparée au travail de l’usine. Les Européens qui l’emploient la jugent d’ordinaire assez sévèrement : instabilité, nonchalance, manque de conscience professionnelle, sont les moindres reproches qui lui sont couramment adressés, et les observateurs les plus indulgents sont obligés de constater chez les indigènes de la campagne une inaptitude foncière à coordonner les gestes avec précision pour accomplir un travail auquel ils ne sont pas habitués. Dans ces conditions, la question paraissait jugée : l’Algérie n’avait pas la vocation industrielle. Cependant, à la réflexion, un doute pouvait naître sur cette condamnation. Si des pays comme la Suisse ou l’Italie ont pu se doter d’une industrie, ce n’est pas avec les ressources de leur sous-sol. Où le charbon fait défaut, on peut en importer, et l’importation paraît d’autant plus indiquée en Algérie que l’exportation du fer et des phosphates nécessite des tonnages importants, qui sont disponibles au retour pour le charbon. Il eût été parfaitement possible d’installer dans les ports algériens des usines consommatrices de charbon, comme cela s’est fait en France, à Caen et au Boucau [NDLR 2023 : à côté de Bayonne].
Il reste 92 % de l'article à lire