Décider et perdre la guerre
Décider et perdre la guerre
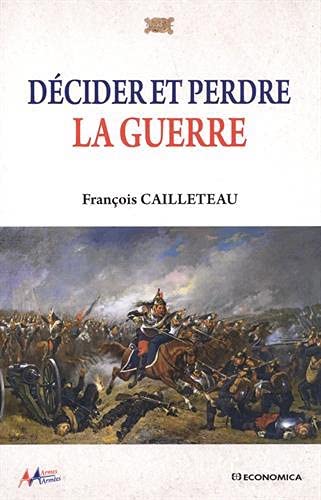 Dans un court essai aussi brillant qu’enlevé, l’auteur excellant à manier la litote, pour le plus grand plaisir du lecteur, le contrôleur général Cailleteau, bien connu des lecteurs de la Revue, publie ici un ouvrage qui se lit d’une traite, visant à établir un catalogue raisonné des imprudences diplomatiques et militaires, les deux allant souvent de pair, à savoir les entrées en guerre d’initiative ayant débouché sur de cuisantes défaites.
Dans un court essai aussi brillant qu’enlevé, l’auteur excellant à manier la litote, pour le plus grand plaisir du lecteur, le contrôleur général Cailleteau, bien connu des lecteurs de la Revue, publie ici un ouvrage qui se lit d’une traite, visant à établir un catalogue raisonné des imprudences diplomatiques et militaires, les deux allant souvent de pair, à savoir les entrées en guerre d’initiative ayant débouché sur de cuisantes défaites.
Les causes en sont multiples, la plus connue étant les erreurs manifestes des chefs militaires du pays étant entré en guerre (le « cas école » de cette situation étant la manœuvre Dyle Bréda, conçue par le général Gamelin en 1940). Mais il existe d’autres causes pour perdre la guerre que l’on a ouverte. On entre ici dans le domaine intellectuel : c’est l’incohérence de la décision, décalée par rapport à la réalité de la situation du moment. Et enfin, le troisième cas, plus classique, se caractérise par la légèreté avec laquelle les décideurs ont été amenés à prendre leur décision (le cas type est encore un exemple français, avec 1870). Il en existe encore deux autres : d’abord, le pays « abonné » à la défaite. Il y en eut, l’Empire ottoman subit deux siècles de défaites continues avant de disparaître dans la tourmente de la Grande Guerre, mais ce fut également le cas des empires autrichien et russe au XIXe. La dernière cause de cette situation est ce que les Grecs appelaient l’hubris, c’est-à-dire la démesure ou ce qu’en France on dénomme la folie des grandeurs. Les trois puissances totalitaires de l’Axe lors de la dernière guerre se trouvent dans cette situation.
Pour illustrer ces différentes situations, souvent complexes, l’auteur a choisi de les traiter par l’exemple, ce qui les rend beaucoup plus intelligibles, d’autant plus qu’il leur accole à chaque fois un titre de chapitre des plus explicites. C’est ainsi que l’erreur des chefs, explicitée par la campagne de Russie de 1812, le plan Schlieffen et son « successeur », le plan Dyle Bréda français de 1940 se trouvent naturellement réunis dans un chapitre intitulé « À côté de la plaque ». La distance relevée entre la décision prise d’entrer en guerre et la réalité de la situation s’intitule naturellement « Un léger décalage » et regroupe la déclaration de guerre à l’Allemagne en 1939, l’expédition de Suez, la guerre du Vietnam et enfin les guerres d’Afghanistan.
Pour traiter l’insouciance de la prise de décision, l’auteur a tout naturellement repris les termes de la déclaration d’Émile Ollivier, chef du gouvernement en 1870 à la Chambre « D’un cœur léger », pour y traiter aussi bien la guerre d’Italie de Charles VIII, que la guerre d’Espagne de Napoléon ou l’expédition du Mexique de Napoléon III et, bien évidemment, la décision du même d’entrer en campagne contre la Prusse (en fait contre tous les États allemands) de 1870. Le cas des « abonnés à la défaite » traite bien évidemment les empires précités, l’autrichien et le russe, regroupés sous un titre large ment évocateur « Perseverare diabolicum ». Et enfin, l’hubris des dirigeants regroupe sous le titre attendu de « la folie des grandeurs », Napoléon et le blocus continental, Hitler et Barbarossa et, enfin, la clique militariste japonaise et Pearl Harbour.
L’ouvrage s’achève par un court chapitre « Entre Charybde et Scylla » où l’auteur explique que ces échecs ne doivent pas faire croire que la citation clausewitzienne « la guerre, continuation de la politique » serait fausse. Au contraire, il démontre avec quelques autres contre-exemples qu’une décision mûrie et raisonnée d’entrer en guerre a permis au cours de l’Histoire de dénouer des situations politiques, en citant abondamment Richelieu et Louis XIII décidant d’entrer en guerre en 1638 dans la guerre de Trente Ans, aux côtés des puissances protestantes contre les royaumes et empires catholiques espagnols et autrichiens. Cet exemple met l’accent sur l’accord qui doit exister entre l’utilité de la guerre et la capacité réelle de vaincre, laquelle ne s’improvise pas.
Pour illustrer cette dialectique, l’auteur prend deux exemples : la conquête de l’Algérie par la monarchie de Juillet, dans laquelle l’appréciation de son utilité a été dominée longtemps par une grande incertitude, alors que les moyens de vaincre n’ont jamais fait défaut ; le second exemple est l’entre-deux-guerres français face à la menace allemande : dans ce cas, la notion d’utilité de se mettre à l’abri d’une nouvelle menace allemande était permanente, tandis que la capacité à atteindre cet objectif va constamment faire défaut à partir du début des années 1930.
Que retenir ? L’essai, comme déjà indiqué, est brillant, puisque, une fois le livre fermé, conquis par la clarté des démonstrations autant que par la rigueur du raisonnement, le lecteur se sent plus intelligent qu’en l’ouvrant, car il aurait, à la fin de chacun des courts chapitres, put s’exclamer « Bon sang, mais c’est bien sûr ! ».
Ce lecteur ne sera pas étonné de croiser Napoléon dans plusieurs chapitres, mais, en cette année de commémoration impériale, pas toujours sous un jour glorieux. L’exemple du blocus continental est là pour démontrer qu’une analyse plus saine et réelle de la situation aurait pu amener l’Empereur, à condition que Londres y eût souscrit, à envisager une sorte de condominium franco-britannique sur l’Europe, l’Angleterre conservant la maîtrise des mers et la liberté d’y commercer, et la France, dans un rapport de force équilibré, conservant le contrôle des terres, des Alpes à la mer du Nord. Utopie peut-être, mais l’expérience eût pu être tentée, plutôt que de se lancer dans la catastrophique guerre d’Espagne, suivie par la non moins catastrophique politique d’hégémonie sans contrepartie, politique dénoncée par Talleyrand à Alexandre, lors de l’entrevue d’Erfurt, le même Talleyrand ayant conservé de l’Ancien Régime, le goût de la mesure, capacité qui faisait certainement le plus défaut à son maître.
Le même lecteur se trouve plongé, à travers ces exemples qui embrassent plusieurs siècles, depuis le début de la Renaissance jusqu’à nos jours, dans le processus de décision le plus lourd qui soit, celui d’entraîner son pays dans la guerre. À ce titre, il ne peut que nourrir la réflexion des lecteurs de la Revue et, plus généralement, constituer un outil utile à ceux qui s’y préparent, les stagiaires de l’enseignement militaire supérieur ou les auditeurs du CHEM/IHEDN. Bref, un essai qui mérite un large lectorat cultivé. ♦





_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)


