Conduire la guerre. Entretiens sur l’art opératif
Conduire la guerre. Entretiens sur l’art opératif
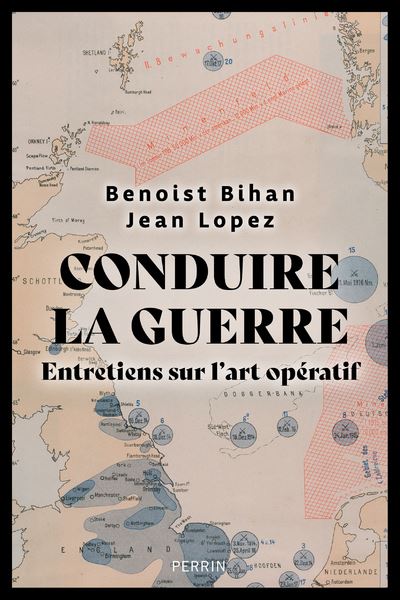 La réflexion sur la guerre ne se limite pas à Clausewitz. Un autre auteur a tenté – et réussi – à penser le conflit, la guerre, les rapports de force, la stratégie : le Russe Alexandre Svetchine (1878-1938). Un livre d’entretiens aussi original (compte tenu du sujet) que riche en analyses politiques et géostratégiques entre deux historiens militaires, Benoist Bihan et Jean Lopez, nous fait découvrir ce personnage riche et très largement méconnu en France.
La réflexion sur la guerre ne se limite pas à Clausewitz. Un autre auteur a tenté – et réussi – à penser le conflit, la guerre, les rapports de force, la stratégie : le Russe Alexandre Svetchine (1878-1938). Un livre d’entretiens aussi original (compte tenu du sujet) que riche en analyses politiques et géostratégiques entre deux historiens militaires, Benoist Bihan et Jean Lopez, nous fait découvrir ce personnage riche et très largement méconnu en France.
Né à Odessa, officier tsariste puis commandant militaire au service de la cause bolchevique dès 1918, auteur de Strategiia (1927) , peu versé dans le renseignement, Svetchine est un pur produit de l’armée impériale russe. Soldat lors du conflit avec le Japon entre 1904 et 1905, il côtoie de près la violence et la mort, ce qui nourrit sa réflexion sur la stratégie. Rival de Mikhaïl Toukhatchevski, personnalité militaire fascinante, autodidacte autoritaire, Svetchine enseigne à l’académie Frounzé, où il exerce une influence vraisemblable sur les 982 commandants qui obtiendront leurs épaulettes de général en 1940 – ceux qui tiendront les premiers rôles contre l’Allemagne nazie. Tiré de ses enseignements, son livre Strategiia préconise une « ligne de conduite stratégique » à une époque où les capacités industrielles de l’URSS sont limitées et les réserves stratégiques de l’Armée rouge (Armée soviétique à partir de 1945) encore faibles. Arrêté une première fois en février 1931, libéré un an plus tard, il meurt dans les purges staliniennes, sans doute au cours de l’été 1938, puis est réhabilité en septembre 1956. Il reste l’un des grands noms de la pensée stratégique au XXe siècle.
Selon les deux auteurs, l’art opératif, forgé par Svetchine, un auteur à la fois dissident sur le plan intellectuel et organique dans le système politico-militaire soviétique dans une époque particulière (après la Révolution bolchevique), a toutefois une valeur universelle. Il peut servir à comprendre les enjeux, les réussites et les échecs des forces en présence dans différents conflits, de la guerre de Sécession (1860-1865) aux deux guerres d’Irak (1991 et 2003) en passant par les deux conflits mondiaux ou la guerre civile russe. À la lumière des exigences de l’art opératif, le livre passe en revue les ressorts politiques, militaires et stratégiques qui conditionnent les dirigeants des pays lors de ces conflits, en particulier la Seconde Guerre mondiale. Quel est donc l’art opératif, auquel Benoist Bihan et Jean Lopez consacrent leur livre, en suivant Strategiia ?
L’art opératif selon Svetchine peut se comprendre en tensions permanentes avec la stratégie et la tactique. À la différence de l’art opératif, formé au XXe siècle, la stratégie et la tactique remontent à l’Antiquité. La tactique (taktikhê) désigne l’aptitude à bien
disposer les soldats sur le champ de bataille, à les déployer au mieux en fonction d’un terrain, d’une situation et d’un adversaire donnés. Elle est la discipline du champ de bataille, celle qui détermine le déploiement des hommes et des armes, et en règle l’emploi violent. Elle est la théorie qui permet d’user le plus efficacement possible de la violence armée pour vaincre un adversaire par le combat. La stratégie lie, là aussi depuis l’Antiquité, la guerre et la politique. Le strategos désigne celui qui mène (ageîn) une troupe ou une armée (stratos). Menant l’armée, le stratège décide de son déploiement et donc de la tactique. La stratégie est ainsi la discipline que mobilise la politique dans le but spécifique de gagner la guerre, c’est-à-dire pour que l’acte de violence qu’est la guerre ne suive pas sa propre logique mais soit instrumentalisé au profit du but politique recherché. Enfin, si la tactique résout des problèmes, la stratégie poursuit des buts.
Le penseur soviétique considère que l’art opératif, qui n’exclut pas le génie militaire (Napoléon), n’est pas une construction sur la base de la tactique, mais une émanation de la stratégie. Théorie générale, il n’est pas cantonné à un type de guerre en particulier ; il est le moyen dont la stratégie dispose pour lui permettre de remplir sa fonction d’« employer les combats favorablement à la guerre », terrestre, navale et aérienne ; il est une compréhension nouvelle de la stratégie et de ses relations avec la conduite de la guerre, d’une part, et de l’activité militaire, donc du combat, d’autre part. Le combat est en effet la matière de l’art opératif : c’est bien le choix du début et de la fin des
combats, de la manière d’y entrer et d’en sortir, qui constitue l’art opératif ; la tactique, elle, s’occupe de ce qui se passe dans chacun des combats. Bref, il ne peut exister d’art opératif sans stratégie et de stratégie sans conduite politique de la guerre. L’art opératif n’est pas la formule magique de la victoire, mais il peut et doit aider à penser la guerre avec assez de clarté pour la gagner.
Dans cette perspective, où se situe la France ? Les deux auteurs soulignent qu’il n’est pas enseigné dans les écoles militaires, même si les Français ont bien vu la forte liaison entre art opératif et stratégie. Ils estiment que la France gaullo-pompidolienne (1958-1973) a été celle qui s’est approchée le plus de l’éveil opératif, en dépit du manque de moyens militaires et technologiques du pays à cette époque-là. Les chefs militaires sous la IVe République ont été écartelés entre la soumission stratégique aux États-Unis dans le cadre de l’Otan et l’autonomisation (par faiblesse du politique) dans la conduite des guerres de décolonisation indochinoise et algérienne. Le général de Gaulle, lui, a concentré dans ses mains toute la direction politique et stratégique et, par conséquent, a limité le nombre de responsables militaires capables de développer une véritable intelligence stratégique individuelle. Comme ailleurs, l’art opératif a été élimé par la dissuasion nucléaire française : le feu atomique n’a-t-il pas pour but l’abolition du combat ?
Ouvrage dense, à la fois érudit et accessible, Conduire la guerre de Benoist Bihan et Jean Lopez fournit une contribution majeure à la pensée stratégique française contemporaine. À l’heure de la guerre en Ukraine, où la France tâtonne et l’Europe trébuche, l’acclimatation tardive de l’art opératif forgé il y a un siècle par un officier soviétique purgé par Staline pourrait-elle contribuer à ériger une véritable défense européenne commune qui ne soit pas tributaire de l’Otan et vulnérable aux empires renaissants ? ♦







