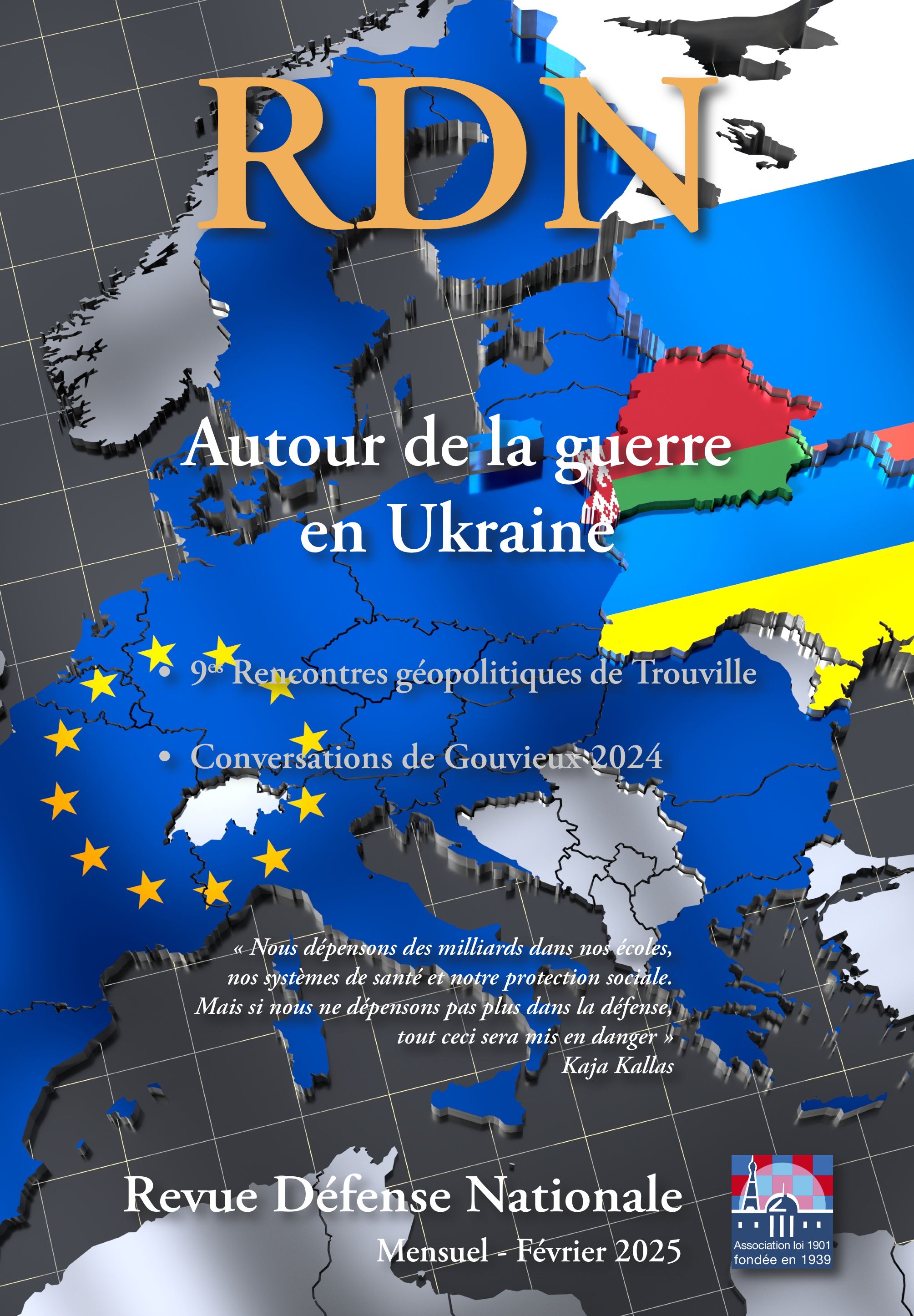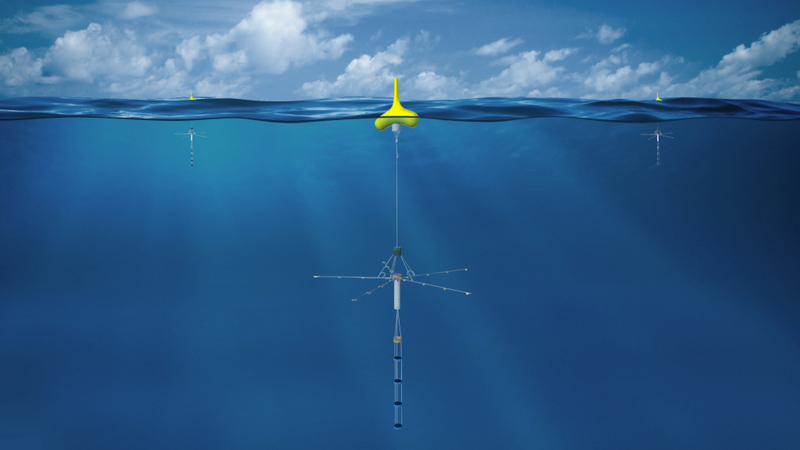Intervention
Je crois qu’en termes de surprise, les événements du 11 septembre se sont passés de manière différente pour les États-Unis et pour la France. Pour les États-Unis, on peut parler de surprise tactique, mais pas de surprise stratégique car tous les indicateurs existaient : O. ben Laden était déjà considéré comme l’ennemi n° 1, le World Trade Center avait déjà été pris pour cible, et l’idée d’un terrorisme « catastrophiste » était déjà débattue dans les milieux stratégiques depuis au moins 1996-1997. En revanche, le cas est différent pour la France, car si pour les Américains les interrogations concernaient (ou auraient dû concerner) le lieu, le moment et les moyens, nous ne pouvions pas soupçonner en France que l’ampleur de l’attentat serait telle que nous nous sentirions obligés de nous impliquer comme nous l’avons fait, nos intérêts étant en jeu. Il me semble donc que, paradoxalement, on peut davantage parler de surprise stratégique pour la France que pour les États-Unis.
L’engagement français
Concernant notre engagement dans les opérations de lutte contre le terrorisme, il n’est pas exagéré de dire que l’engagement militaire français en Afghanistan s’est fait dans des conditions particulièrement difficiles pour quatre raisons :
- la première raison est le choix politique qui a été fait d’une solidarité conditionnelle avec les Américains. Lorsque le président de la République française arrive aux États-Unis, quelques jours après le 11 septembre, (il est alors le premier chef d’État allié à s’y rendre) la télévision américaine souhaite savoir s’il reprend à son compte l’expression « guerre » employée par son homologue américain ; Jacques Chirac répond qu’il « n’est pas sûr qu’on puisse parler de guerre ». Une réponse que les médias et l’opinion américaine ont interprétée, et ce jusqu’à aujourd’hui, comme exprimant l’idée d’un engagement français presque contraint et forcé.
Il reste 78 % de l'article à lire
Plan de l'article