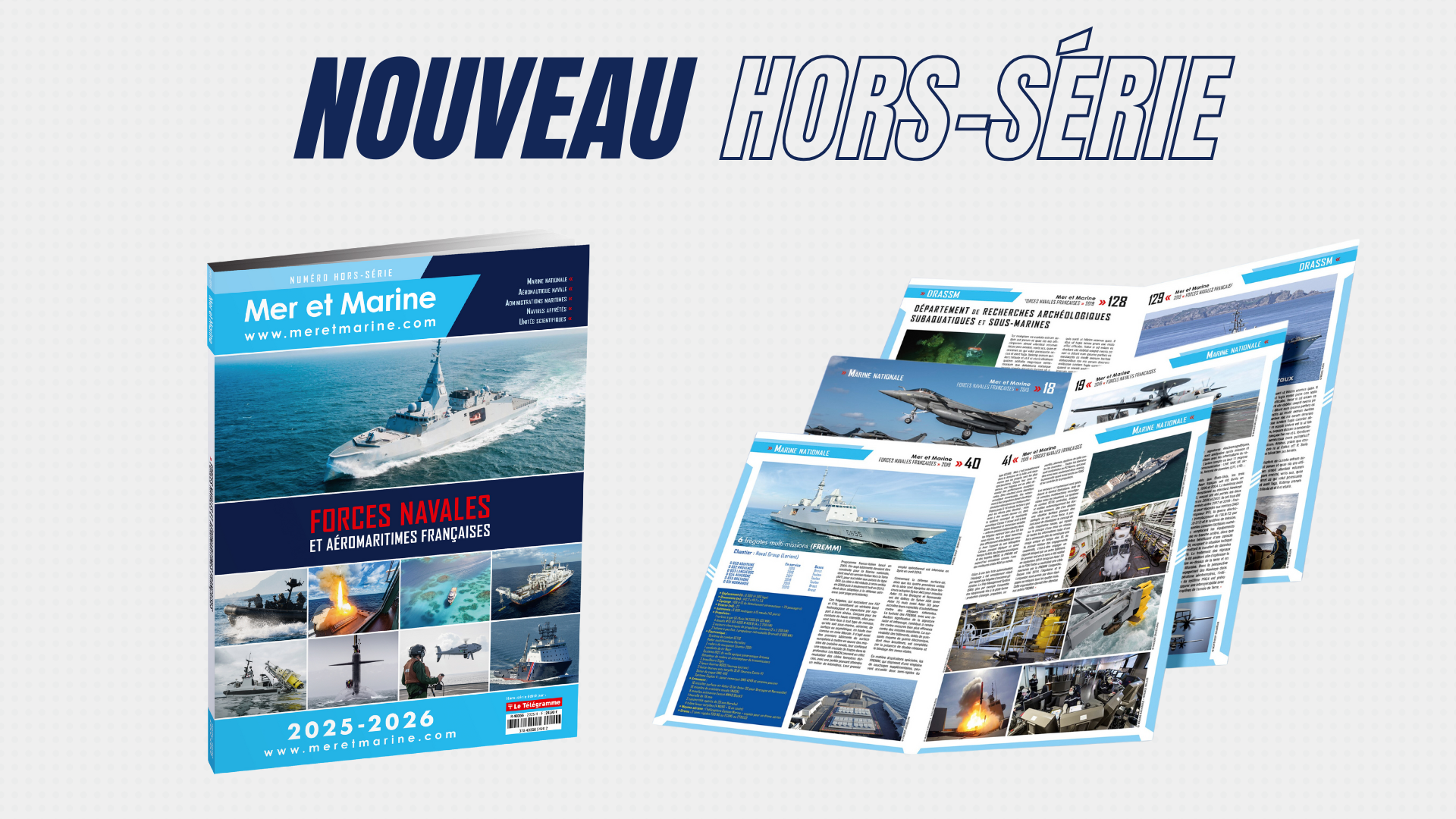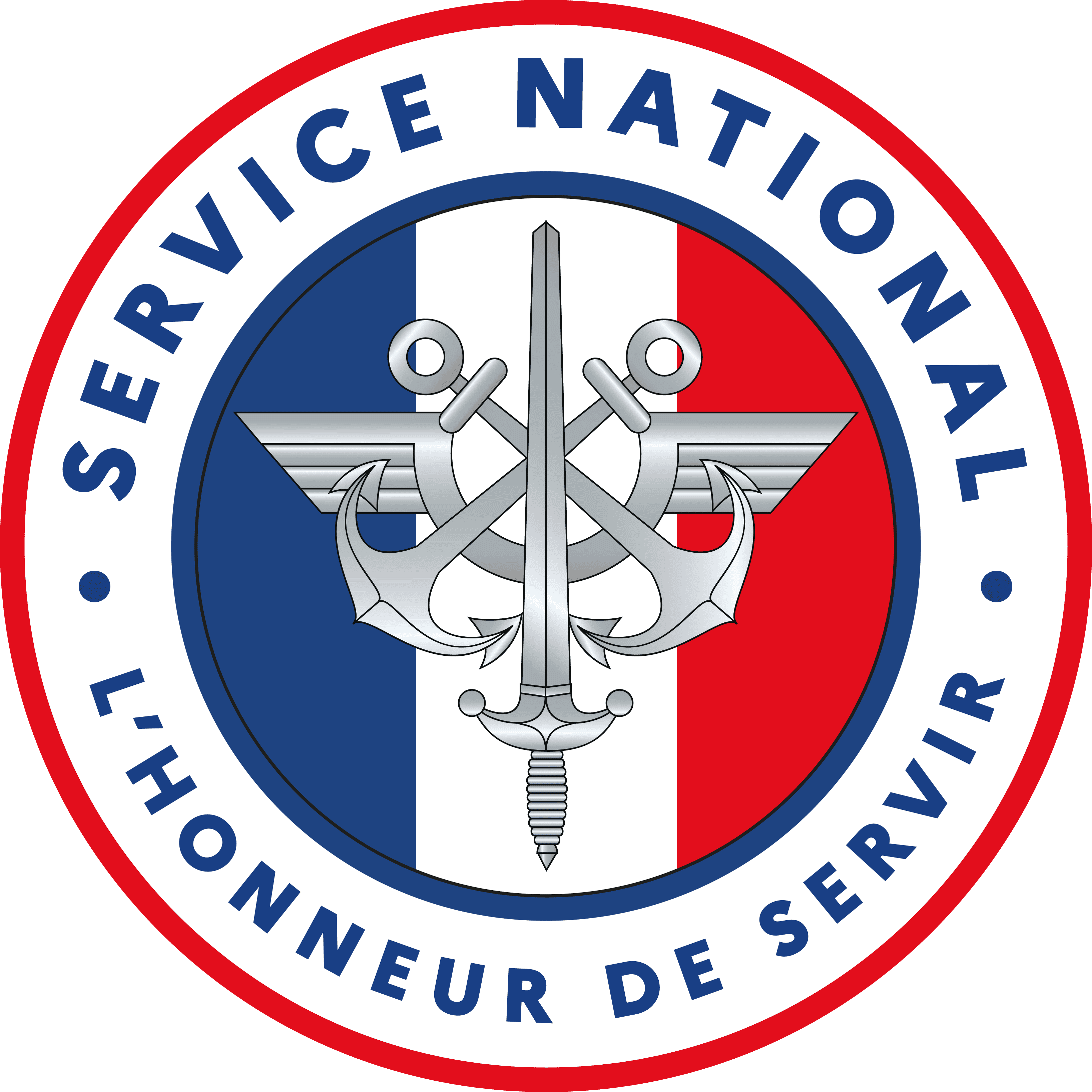Gendarmerie - La question de la mobilité géographique des militaires de la gendarmerie
Comme les autres militaires, les gendarmes sont astreints à une mobilité géographique tout au long de leur carrière, de sorte que le déménagement constitue un élément familier de la vie « gendarmique ». En indiquant dans un article premier en forme de préambule que « les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des desiderata des intéressés », le décret du 18 août 1998 est venu récemment préciser les modalités de mise en œuvre de cette mobilité, déterminées par l’article 16 de l’instruction du 27 juin 1929. Désormais, en effet, pour tout gendarme, qu’il soit officier ou sous-officier, gendarme départemental ou mobile, enquêteur dans une section de recherches ou gendarme maritime, le temps de présence dans une résidence (commune de l’unité d’affectation) ne peut excéder, hors circonstances exceptionnelles, dix années.
Cette disposition a donné lieu à d’intenses discussions et remous chez des sous-officiers, dans un climat d’interrogation et de malaise également provoqué par les projets de redéploiement police-gendarmerie et les manifestations corporatistes qu’ils ont engendrées (1). Au-delà de cette limitation dans la durée des affectations, la mobilité est érigée en obligation statutaire lorsque le sous-officier bénéficie d’une mesure d’avancement. La promotion au grade supérieur doit entraîner la mutation dans une autre unité, le choix de l’affectation sur un des postes disponibles étant alors conditionné par la place occupée dans le tableau d’avancement. Dès lors, le refus de la mobilité peut amener certains sous-officiers à ne pas se porter candidat à l’avancement, apportant ainsi un élément de dysfonctionnement dans les fondements méritocratiques du système hiérarchique, tout en risquant d’altérer la qualité de l’encadrement des formations.
Étroitement liée au système d’avancement, la mobilité a pour fonctions manifestes d’assurer la continuité du service et de préserver l’indépendance du personnel. Permettant de faire face à toute carence dans une unité susceptible de compromettre l’exécution du service, la mobilité se traduit, en premier lieu, par la possibilité pour le commandement d’opérer des affectations « dans l’intérêt du service ». Ces dernières concernent principalement, outre les dispositions du décret du 18 août 1998, les affectations des officiers et sous-officiers à l’issue de la période de formation initiale, le passage obligatoire dans la gendarmerie départementale des gendarmes mobiles remplissant certaines conditions d’âge et de qualification, ainsi que la réaffectation du personnel après un séjour outre-mer. Si, dans l’exercice de ses fonctions, le gendarme doit faire preuve de neutralité, d’impartialité et de fermeté, la mobilité apparaît alors, en second lieu, comme le souverain moyen de le délivrer des éventuelles « relations gênantes » pouvant altérer la bonne marche du service. Bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’une application rigoureuse, cette règle peut contraindre le gendarme convolant en justes noces à faire l’objet d’une mutation, dans l’hypothèse où la famille de son futur conjoint réside dans la circonscription de la brigade où il est affecté. En raison même de son intégration au sein de la population, le risque est aussi grand de voir l’indépendance du gendarme s’émousser au fil des années.
Il reste 69 % de l'article à lire