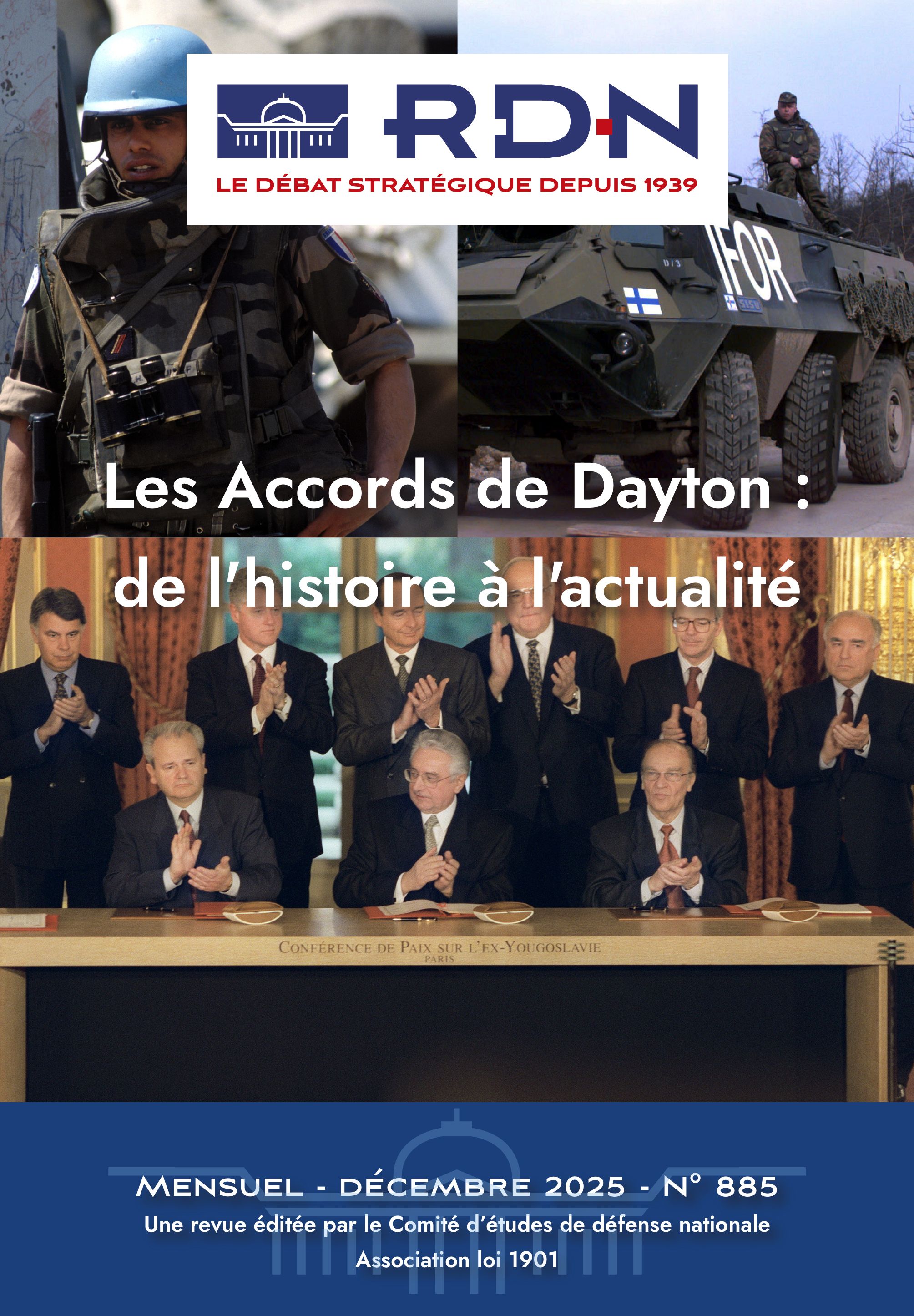Géopolitique : constantes et changements dans l'histoire
Aymeric Chauprade, docteur en sciences politiques et par ailleurs professeur au Collège interarmées de défense (CID), est bien connu de nos lecteurs puisqu’il a été, avec François Thual, le coauteur du Dictionnaire de géopolitique et qu’il a aussi publié, l’année dernière, une Introduction à l’analyse géopolitique, dans laquelle il nous faisait part de ses réflexions sur les « outils conceptuels » de cette discipline qui connaît depuis peu, une nouvelle jeunesse. Aujourd’hui, dans cet ouvrage magistral, c’est l’ensemble d’une nouvelle méthode de raisonnement qu’il nous propose, pour l’analyse en profondeur de tout l’éventail des relations internationales, tant historiques que contemporaines.
Dans son « Introduction générale », l’auteur nous résume les idées maîtresses qui ont présidé à ses analyses : « repousser la causalité unique », « repousser (aussi) l’idéologisme » ; mais « admettre le rôle de l’idéologie » ; tout en repoussant « l’ingérence idéologique » dans sa propre recherche qui doit rester « scientifique » ; « admettre que tout n’est pas géopolitique » ; enfin, « distinguer la matière géopolitique de son utilisation nationaliste » ; « poser l’hypothèse de la multiplicité des facteurs explicatifs » ; « insister sur la dualité continu-discontinu » ; « choisir l’État comme référentiel d’étude » ; « préciser, avant toute chose, les influences reçues ». Et l’auteur énumère alors quelles ont été, pour lui-même, les influences « radicales » qui l’ont marqué, à savoir d’abord celle de l’« école réaliste » des relations internationales (en France Raymond Aron), qui a entraîné son adhésion aux idées suivantes : « la cohabitation nécessaire entre le paradigme de l’intérêt et l’éthique de la conviction », au « théorème de la centralité de l’État », à la notion de « recherche de l’équilibre » ou de « recherche de la sécurité ». L’auteur note enfin que « sa démarche s’est efforcée de dépasser les faits et la description, au profit de la modélisation et de l’explication » ; et il cite, à ce sujet, l’influence qu’ont exercée sur lui les travaux de Jean-Baptiste Duroselle (notre maître) et d’Edmond Jouve (notre ami).
Cependant, il ne peut être question de tenter de résumer ici un ouvrage d’une telle densité. Aussi nous bornerons-nous, afin d’encourager nos lecteurs à s’y reporter, à mentionner son organisation. La première partie résume l’histoire des idées en matière de géopolitique, alors que les parties suivantes sont consacrées aux facteurs permanents de cette dernière, à savoir : la « réalité géographique », la « réalité identitaire », la « quête des ressources ». Si la constatation de la « permanence de la carte » est bien à l’origine de la discipline « géopolitique », comme d’ailleurs son appellation le rappelle, la « permanence des identités » résulte d’une constatation beaucoup plus récente et à laquelle notre ami François Thual, dont nous avons eu souvent l’occasion d’évoquer l’œuvre dans cette revue, a fait un apport déterminant. Notre actuel auteur, qui lui a d’ailleurs dédié son ouvrage, en analyse de façon très argumentée les composantes : le clan, l’ethnie, la nation, le territoire, la langue, le « panisme » (pangermanisme, panslavisme etc.), les minorités, les catégories socio-économiques, les civilisations. Mais il insiste, à juste titre puisque la présente situation internationale nous le rappelle tous les jours, sur « la religion » ; nous dirions plutôt sur l’« empreinte religieuse », tant celle-ci subsiste quand bien même la religion n’y est plus pratiquée, (comme d’ailleurs le mot de « culture » l’évoque). Cette partie de l’ouvrage nous a paru ainsi particulièrement éclairante.
L’est aussi sa « conclusion générale », dans laquelle nous avons retenu, en particulier, les analyses de l’auteur concernant l’État et son avenir. Pour lui « l’État ne disparaît pas, mais qui plus est, il prolifère », comme le montre l’émiettement des États préalablement existants, lorsqu’ils étaient « multinationaux » ou « multiethniques ». Et il en tire la constatation que, ainsi : « les peuples cherchent les uns après les autres à rentrer dans l’histoire par l’État ». De tout cela, pour lui, par son déterminisme, la méthode géopolitique rend compte, mais il ajoute qu’elle ne doit pas oublier de prendre aussi en compte « la force du jaillissement humain, son génie créateur capable autant de renverser les données de la puissance au profit du particulier que de renverser les particularismes au profit de l’universel ». C’est par cette citation qu’il convenait, pensons-nous, de terminer notre présentation de l’ouvrage majeur d’Aymeric Chauprade, puisqu’elle témoigne, après tant d’érudition, de la haute élévation de son approche de la géopolitique. ♦