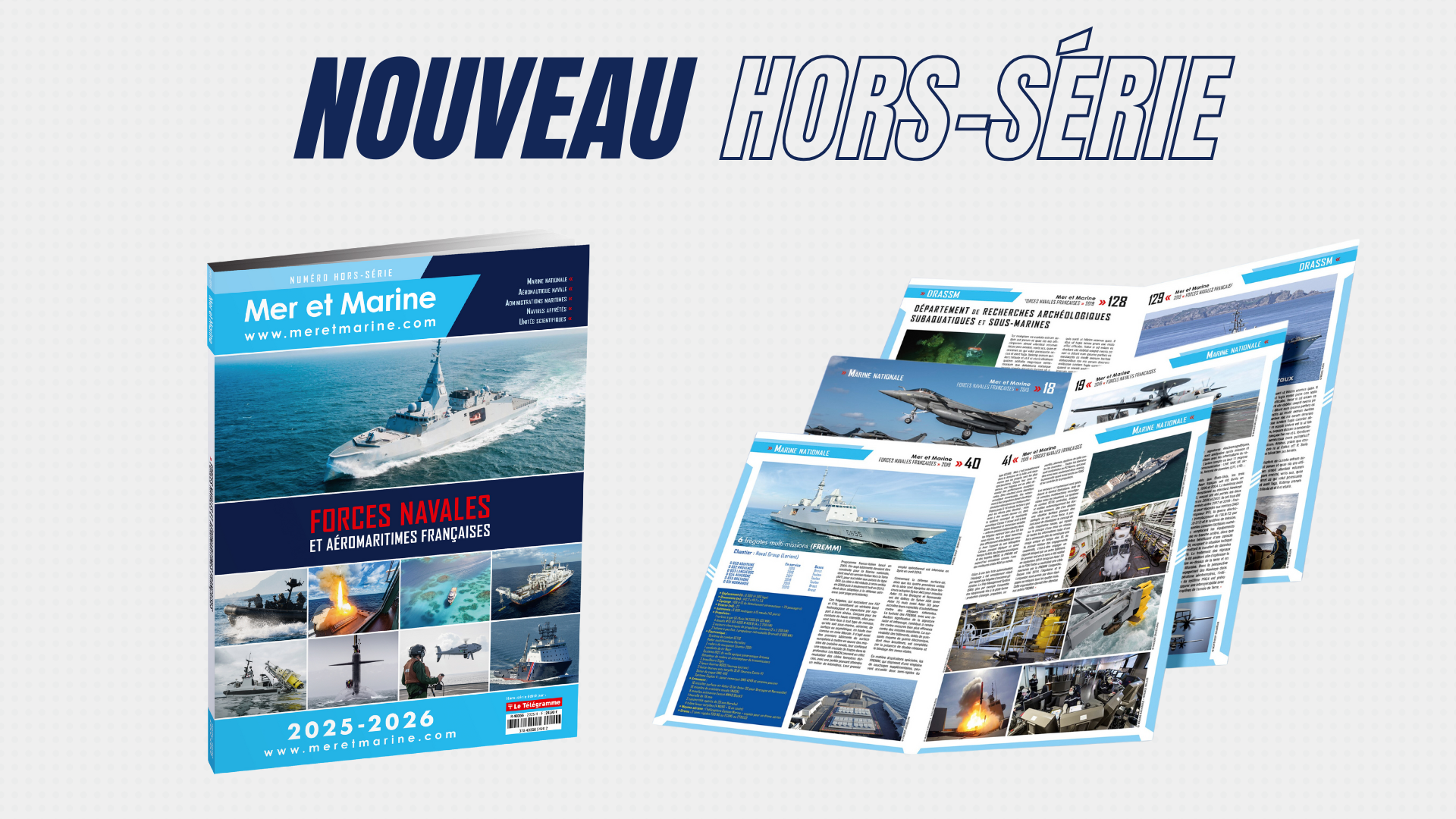Le dialogue du politique et du soldat conditionne la mise en place de l'outil militaire. Si ce dialogue s'est maintenu outre-Atlantique, on ne peut en dire autant en Europe, sans doute par absence de structure constituée, de type état-major de planification, hormis l'Otan jusqu'à il y a peu. Dans ces conditions, la différence de stratégie entre les États-Unis et l'Europe est inéluctable ; l'écart technologique souvent regretté ne pouvant que s'accentuer. Les auteurs recommandent aux Nations constituant l'Europe de renouer le dialogue entre politique et militaire, d'abord au niveau national, si elle veut retrouver une quelconque autonomie stratégique.
Un demi-siècle de dialogue du politique et du soldat
Dans la dernière partie du Fil de l’Épée, le général de Gaulle dégage de l’histoire les principes qui régissent le dialogue du politique et du soldat.
Si l’on retient généralement de son propos la primauté du premier sur le second, sauf lorsque les opérations militaires relèvent de la guerre de mouvement, et la force de caractère qui doit animer les interlocuteurs, l’importance de la permanence du dialogue, peut-être parce qu’elle est évidente, passe plus inaperçue. Elle conditionne pourtant la mise en place de l’outil militaire nécessaire tant aux opérations défensives, que celles qui visent à mettre à mal le dispositif de l’adversaire.
On ne saurait conclure, enfin, ce résumé des enseignements du Général sans noter que l’auteur spécifie bien qu’il s’agit du dialogue « du » politique et « du » soldat.
Il reste 92 % de l'article à lire
Plan de l'article