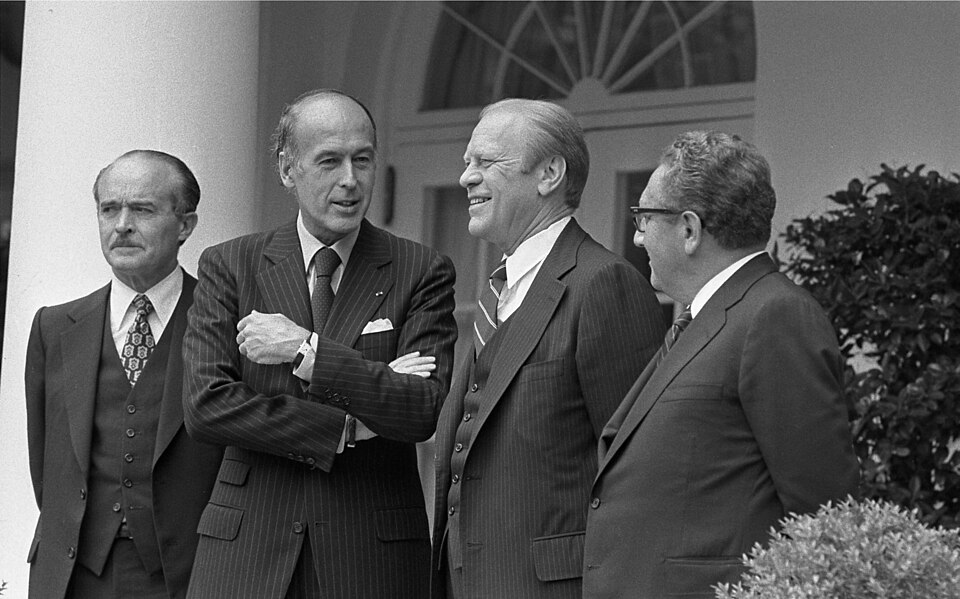Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, s'est fixé pour objectif une réduction significative et durable de la criminalité et de la délinquance. Les élections de 2002 ont montré que l'insécurité était un risque majeur pour la cohésion de la société française et la stabilité de ses institutions. De nouveaux moyens humains, matériels et juridiques s'ajoutent à une réforme des structures et des méthodes. Conciliant ouverture et fermeté, la politique de sécurité doit permettre, d'ici à 2006, de réduire de 20 % le nombre de crimes et délits constatés.
La sécurité des Français
En 1950, la police et la gendarmerie constataient 10 crimes et délits pour 1 000 habitants. Ce taux était de 70 pour 1 000 en 2001, année où le triste record de 4 millions de faits a été dépassé ; en un demi-siècle, sept fois plus de crimes et délits alors que la population n’a crû que de 30 % ! L’aggravation a été particulièrement sensible à partir de 1982. De 1997 à 2001, la délinquance a augmenté de 16 %. Entre 2000 et 2001, l’insécurité dans les transports en commun d’Île-de-France a fait un bond de 19 %. Ces chiffres sans équivoque témoignent de l’ampleur de l’insécurité dont sont victimes nos concitoyens. Les aspects quantitatifs de cette évolution doivent être complétés par une analyse qualitative. Les violences urbaines ont embrasé, depuis 1980, des quartiers devenus des zones de non-droit dans lesquelles il était conseillé aux policiers et aux gendarmes de ne pas s’aventurer. Avec le trafic et la consommation de stupéfiants, la France détient un triste record : celui des pays d’Europe où les jeunes de 16 ans sont les plus nombreux à consommer du cannabis et où le nombre de personnes ayant expérimenté l’ecstasy ou la cocaïne a doublé en quelques années. Les violences contre les personnes, les trafics d’êtres humains se sont hélas banalisés. Le terrorisme n’épargne pas notre territoire. Je pourrais poursuivre cette énumération tant les exemples sont nombreux…
Impuissance publique
À force de tolérer l’intolérable, on a fini par accepter l’inacceptable. Les bons esprits, les donneurs de leçons, ceux qui sont généralement mieux protégés parce qu’ils en ont les moyens, ont développé une idéologie reportant sur les phénomènes de société la responsabilité de l’insécurité, en avançant, pour mieux justifier leur inaction que le progrès engendrerait la délinquance. De colloques en colloques, ils ont mis beaucoup d’ardeur à expliquer ce qui pouvait motiver les délinquants et ont négligé les victimes qui auraient dû pourtant mobiliser en premier leur attention. L’État, dont le rôle premier est d’assurer la sécurité, a vu sa crédibilité profondément altérée. La puissance publique s’est muée en impuissance publique. En 2002, nos concitoyens ont dénoncé avec force une dérive que l’on voulait masquer derrière le « sentiment d’insécurité ». « Vous n’avez pas peur, leur disait-on, vous avez simplement le sentiment d’avoir peur ». Tout dans leur vie quotidienne contredisait pourtant cette affirmation : l’insécurité n’était pas une perception mais bien une réalité. Leur vote du 22 avril 2002 est clair. L’avenir de nos institutions républicaines est en jeu. Il n’y a pas d’alternative au retour à la sécurité. Grande serait la responsabilité de ceux qui refuseraient d’entendre ce message.
La nouvelle politique de sécurité
La nouvelle politique de sécurité voulue par le président de la République et mise en œuvre par le gouvernement doit se traduire impérativement par des résultats significatifs et durables. Des premiers signes encourageants sont observés : en 2002, pour la première fois depuis 1997, la tendance a été inversée. Depuis le début de l’année 2003, la baisse de la criminalité et de la délinquance est de 4 %, ce qui correspond à plus de 100 000 victimes épargnées. La délinquance de voie publique, celle qui affecte la vie quotidienne des Français, régresse de 10 %, tandis que les violences urbaines les plus graves diminuent de 22 %. N’oublions pas, non plus, les 1 000 vies épargnées sur les routes depuis le début de l’année, ceci grâce à une plus grande fermeté à l’égard de ce qu’il convient d’appeler la délinquance routière. Les sceptiques dénoncent la sincérité des chiffres lorsqu’ils sont à la baisse, et considèrent en revanche l’outil statistique fiable lorsqu’ils sont à la hausse. Nos concitoyens savent, eux, que les choses ont commencé à changer.
Il reste 81 % de l'article à lire
Plan de l'article




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)