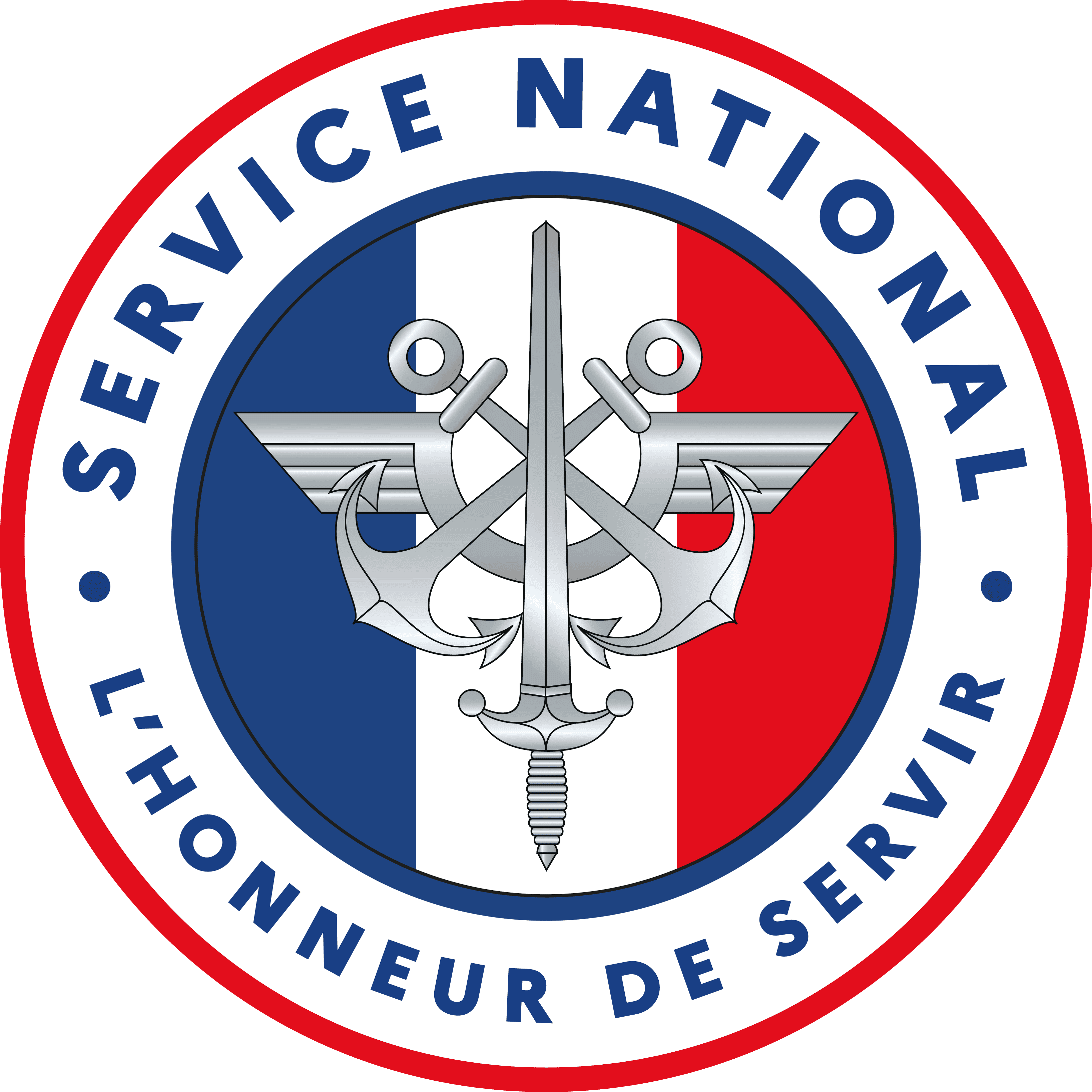Colossus - The Price of America's Empire
Encore un ouvrage sur le déclin américain ? Effectivement, dans sa couverture imprimée, l’ouvrage est vendu avec un autre sous-titre plus racoleur : The Rise and Fall of the American Empire, allusion aux travaux de Gibbon sur Rome ; mais son intérêt est qu’il est le dernier en date d’un des penseurs du néoimpérialisme, l’historien britannique Niall Ferguson.
Celui-ci s’est fait connaître en 1998 avec un essai déroutant sur la Première Guerre mondiale, The Pity of War, non encore traduit en français ; mais c’est comme théoricien du concept d’empire (Lessons for Global Power) qu’il recueille un franc succès depuis son Empire - How Britain made the Modern World, paru en 2003. Le dernier ouvrage de Niall Ferguson, moins structuré et présentant cette absence apparente de progression logique qui rebute toujours nos esprits cartésiens, n’est en réalité que la compilation de plusieurs articles déjà publiés, comme l’auteur le reconnaît dans une postface de remerciements qui constitue également un guideline de lecture.
L’idée de base de l’auteur est de relever l’existence d’une première mondialisation, commencée à la fin des guerres européennes du XVIIIe siècle, et qui va durer un siècle, jusqu’à ce que le conflit de 1914-1918 y mette fin. Statistiques à l’appui, il met cette anglobalization au seul crédit de l’empire britannique, comme si les autres puissances impérialistes n’avaient pas existé. Et là commence la distorsion très idéologique qu’il fait d’une réalité bien moins simple, car négligeant la concurrence française puis allemande, Niall Ferguson ne retient comme facteurs déterminants que le monopole économique de la City et le pouvoir de coercition de la Navy : cette mondialisation aurait beaucoup mieux marché que celle que nous avons recommencée en 1945, tout simplement parce que l’empire britannique en aurait fixé alors quasiment seul les règles. Niall Ferguson en déduit qu’à une économie mondialisée doit nécessairement correspondre un gouvernement unique : la persistance d’États souverains, juridiquement égaux mais économiquement rivaux, ne peut que conduire à la crise mondiale. Pour lui, le multilatéralisme serait condamné par la logique. L’appel à la puissance impériale est donc une nécessité historique.
On s’est focalisé en France sur les neo-cons américains (puisque c’est ainsi que les néo-conservateurs ont été baptisés par des analystes britanniques suffisamment au fait de la langue de Molière pour comprendre toute la saveur de leur raccourci), mélange détonnant né de la rencontre d’une extrême-droite fondamentaliste et d’anciens gauchistes recyclés dans la haine des Lumières européennes ; mais on a négligé ce discours du new liberal imperialism très en vogue outre-Manche, dont les représentants appellent à la reconstitution d’un authentique empire anglo-saxon dont la Grande-Bretagne fournirait le substrat idéologique à défaut de pouvoir encore en constituer le bras armé. Ainsi Robert Cooper, ancien conseiller du Premier ministre britannique Tony Blair, aujourd’hui en poste à Bruxelles, estime dans son Breaking of the Nations (nouvelle édition 2003) que l’histoire c’est l’empire, et que l’État-nation n’est qu’une particularité, presque une anomalie occidentale (on a déjà signalé, sur cette question de la non-impérialisation de l’Europe, l’ouvrage remarquable de Jean Baechler, Esquisse d’une Histoire universelle, 2002). Dès lors, même si tous les empires ont de nos jours disparu les uns après les autres, « la non-existence d’un empire est sans précédent historique. Reste à savoir si cela peut durer. Il y a des raisons à la fois théoriques et pratiques de penser que non ». On trouve là une certaine parenté avec la théorie d’appel d’empire universel dont les marxistes Tony Negri et Michael Hardt ont été les vulgarisateurs avec leur Empire paru en 2000, et qui est très en vogue au sein du Parti démocrate américain depuis Bill Clinton. Comme si le vide laissé par l’URSS se situait avant tout dans les têtes, et pas uniquement chez les staliniens.
Pour Niall Ferguson, les États-Unis présenteraient bien toutes les caractéristiques d’un empire, et leur supériorité très relative, contrairement à ce qui est écrit ici et là depuis 1989, les contraint comme tant d’autres avant eux à s’appuyer quasi exclusivement sur la puissance militaire, seul domaine où l’illusion a tenu jusqu’à la guerre d’Irak : ainsi lorsque nous écrivons néo-impérialisme, le « néo » est de trop. Pour la première fois de l’histoire, voilà un empire qui ne s’assume pas : c’est – l’expression a fait la renommée de son inventeur – un « empire in denial ».
Déni d’empire : car ce sont bien les Américains qui ne sont pas psychologiquement à la hauteur de leurs ambitions, du fait essentiellement d’un déficit culturel et éducatif qui provoque la crise de ressources humaines (chronic manpower deficit) et militaires (shortage of military personnel) qui est apparue au grand jour en Irak. Niall Ferguson met en regard la proportion importante d’administrateurs coloniaux britanniques fournis hier par Oxbridge, et l’absence totale d’intérêt des diplômés américains pour l’international : le nouvel hegemon est « non seulement un empire sans colon, mais également sans administrateur ». Or l’empire, c’est avant toute chose un état d’esprit dont on peut penser ce que l’on voudra (ce « complex of emotions » que l’on rencontrait également dans l’empire français) mais auquel ni un budget militaire démesuré ni une avance technologique incontestable ne peuvent suppléer. Si l’on s’y refuse on devient un réel danger pour le monde : « A colossus with an attention deficiency disorder is potentially very dangerous ». D’autres analystes, comme Anatol Lieven ou Immanuel Wallerstein, partagent ce même sentiment que l’Amérique constitue désormais un péril pour un monde qu’elle refuse de comprendre.
L’auteur répond également, puisque tel est le sous-titre de son ouvrage, à l’objection que l’on peut formuler aux tenants de l’École décliniste, comme les deux auteurs cités à l’instant ou Emmanuel Todd : les civilisations disparaissent sans doute du fait de causes profondes, comme le pensait Montesquieu, mais quel est le fait déclencheur ? Pourquoi demain, et pas avant-hier ? C’est The Gibbon’s Problem : quand ? La chute d’un empire est tellement soudaine que les contemporains eux-mêmes ne le réalisent pas, laissant les historiens qui leur succèdent sans témoignage et perplexes. Et bien pour Niall Ferguson, le monde n’en a pas encore pris pleinement conscience, mais l’Amérique, ce colosse aux pieds d’argile (American Colossus has more than merely feet of clay), n’existe déjà plus en tant que puissance. La messe est dite : l’empire d’Amérique n’aura été qu’une météorite, et restera dans les mémoires comme le premier « empire de mille jours » de l’Histoire. On ne le dira jamais assez : la cruauté (cultural disdain) des Britanniques à l’encontre de leurs cousins américains est sans borne, et renvoie notre antiaméricanisme germanopratin au rang de distrayant passe-temps.
Leur déception est en tous les cas révélatrice de leur nouvel état d’esprit, désillusion à la mesure de leur imprudent alignement inconditionnel d’hier ; les États-Unis ne seront jamais le Leviathan espéré par quelques-uns et redouté par tous les autres, dont la Grande-Bretagne aurait été le poisson-pilote. L’échec de Tony Blair à faire accepter cette idée devant le Conseil de sécurité de l’ONU au printemps 2003, le mépris publiquement affiché dans le même temps par le secrétaire américain à la défense Rumsfeld pour les soldats de Sa Majesté, les tensions grandissantes sur le terrain entre officiers alliés, et le constat qu’il n’y aura pas de relève européenne même sous mandat onusien, ne sont certes pas pour rien dans cette rupture, même si Londres tarde à en tirer les conséquences. La question de la renonciation à la politique du grand large est donc posée, même si ce sujet est encore pour le moment tabou outre-Manche. La guerre d’Irak pourrait fort bien y constituer le révélateur que fut pour la France la crise de Suez de 1956, et l’ouvrage de Niall Ferguson nous donne des raisons de penser que ce moment approche. ♦