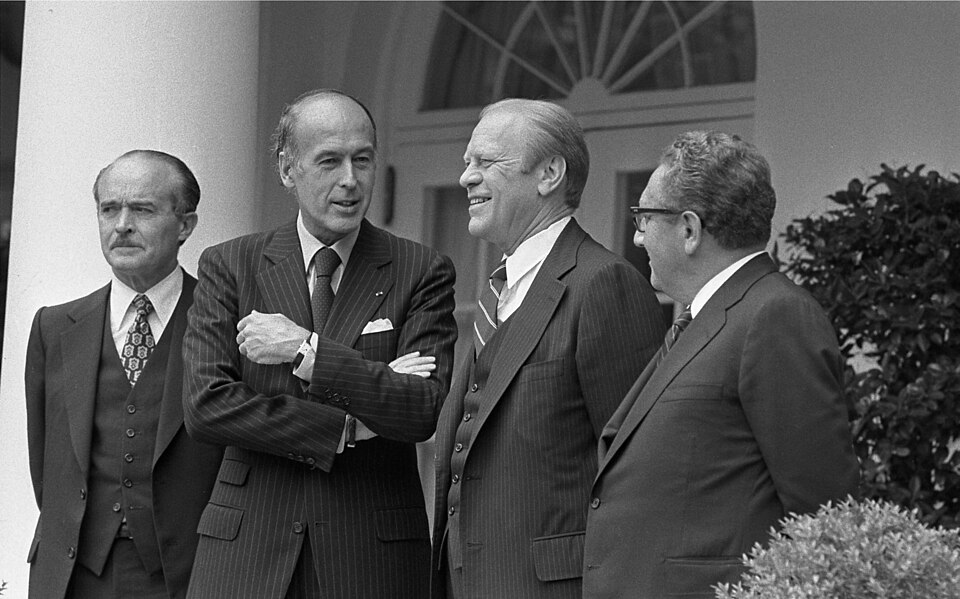Qu’en est-il de l’Iran ? Menace ou victime ? Celui-ci, sans précédent d’agression, ne cesse d’inquiéter la communauté internationale par son programme nucléaire tout en affirmant qu’il est menacé par ses voisins et victime de propagande. Pourquoi une industrie nucléaire pour un pays possédant autant de ressources en pétrole et de gaz ? La question se posait déjà au début des années 70, elle se pose encore aujourd’hui. Le Shah était un gaulliste, Khomeiny un ayatollah gaulliste, et c’est non pas l’ayatollah mais la posture gaulliste qui dérange le plus. Un ayatollah blairiste ne fera-t-il pas l’affaire de Washington ?
Le programme nucléaire iranien, une équation aux multiples inconnues
The Iranian nuclear programme-an equation with many unknows
So, is Iran a threat or a victim? Although it has no previous history of aggression, Iran continues to disturb the international community with its nuclear programme, while declaring that it is under threat from its neighbours and the victim of propaganda. Yet why does a country with such large reserves of oil and gas need a nuclear industry? This question arose as long ago as the early 1970s, and it arises again today. The Shah was a ‘Gaullist’, Khomenei a Gaullist ayatollah, and today it is not the Ayatollah but the Gaullist posture that is the more disturbing. A Blairite ayatollah will surely suit Washington nicely.
L’historique du secteur nucléaire international est fait de rivalités entre les nations pour le développement de la technologie nucléaire et la volonté du maintien par certains de leurs positions avantageuses. C’est pourquoi, selon le général P. Gallois, « l’affaire iranienne dépasse-t-elle la seule problématique nucléaire pour matérialiser la fracture socio-économique qui sépare — et oppose — les anciens industrialisés des nouveaux, l’Occident de l’Orient » (1). Si indépendamment du régime en place, les États-Unis ont toujours refusé à l’Iran le droit d’avoir un cycle de combustible complet, convergences géostratégiques et rivalités économiques sont le cadre des relations atlantiques ; c’est ainsi que l’Europe s’aligna sur les concepts et doctrines « made in America ». S’agissant de la Russie, elle fait partie du problème et de la solution à la fois. En revanche, l’Iran, qui cherche à devenir un électron libre, a frappé désespérément à toutes les portes pour la réalisation de son programme nucléaire. L’aventure commence par le Shah, longue, difficile, semée d’hésitations, de coups d’arrêt, de secrets, de tensions, avec, en bout de course, une crise diplomatique dont personne ne peut prédire l’issue.
La dimension politique de la capacité nucléaire
Il est difficile mais nécessaire de comprendre les raisons pour lesquelles les États cherchent à se procurer des armes nucléaires. « Il est toujours difficile d’imaginer les raisons pour lesquelles on a besoin des armes. Il est beaucoup plus difficile de savoir ce que l’on peut en faire une fois qu’on les a », notait un historien américain (2). C’est ainsi que le Moyen-Orient est certainement la région qui concentre, sur un espace limité, une densité de moyens militaires sans équivalent. S’agissant du risque nucléaire présenté par le Moyen-Orient, il est difficile de l’apprécier compte tenu du secret qui entoure traditionnellement tout ce qui concerne ce domaine, l’information fait défaut, dans le militaire comme dans le civil. Mais également de la volonté des États-Unis et Israël d’utiliser cette menace au mieux de leurs intérêts.
Si, d’après Goldsmith, en réponse au général de Gaulle, « le nucléaire est comme la sexualité chez les jeunes ; on peut la [prolifération] retarder mais pas l’empêcher » (3), la capacité d’une nation à poursuivre un programme nucléaire militaire, mis à part l’accès aux matières fissiles, dépend aussi de la maîtrise de la technologie et d’un savoir-faire. Tout ce que les Iraniens possèdent aujourd’hui. Cependant, la volonté est l’acte fondateur de la prolifération, son catalyseur. Le niveau d’enrichissement distingue le civil du militaire, mais la frontière reste politique. C’est pourquoi il convient de prendre prudemment les analyses américaines fondées sur la simple appréciation technique des risques sur le monde : « Je peux le faire donc je vais le faire » (4).
Il reste 87 % de l'article à lire
Plan de l'article





_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)