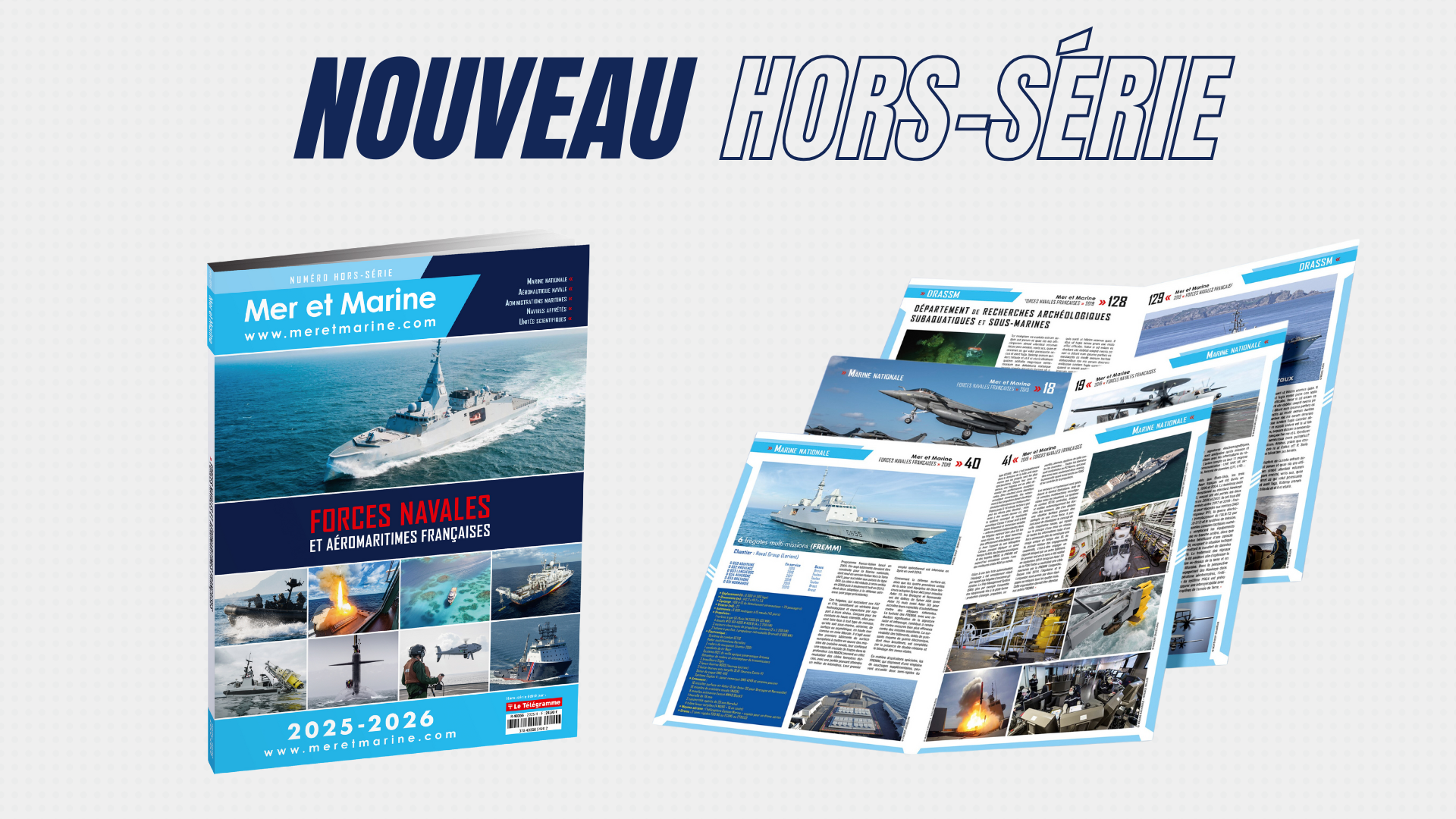L’information étant au cœur de la politique de défense, les médias ne peuvent plus être considérés comme des spectateurs mais comme des acteurs pesant de plus en plus dans la gestion des crises. Un code de bonne conduite paraît, a priori, difficile à élaborer. Dès lors, n’est-il pas nécessaire de dégager quelques principes ?
Terrorisme et médias : une relation infernale
Terrorism and the media: a diabolical relationship
Public information is now at the very heart of defence policy, so the media can no longer be regarded as mere spectators, but rather as inevitable players, carrying ever more weight in crisis management situations. It would seem on the face of it difficult to develop a code of good conduct, but shouldn’t at least a certain number of principles be defined?
Avec l’évolution contemporaine des moyens médiatiques, le terrorisme est devenu non seulement une arme nouvelle mais une méthode de communication consistant à créer un choc psychologique et à conquérir ainsi un avantage politique. En répandant la terreur il s’agit de déposséder l’État du monopole légitime de la violence, de lui enlever sa crédibilité, de défier le fonctionnement de la démocratie et même de contribuer à le dénaturer en le ridiculisant afin de le déstabiliser en tirant profit de l’impact considérable des médias sur l’opinion publique.
Guerre politique faisant appel à des stratégies indirectes, le terrorisme ne peut, bien sûr, se gagner que politiquement. Les objectifs et les moyens des stratégies antiterroristes (de même que les luttes contre la criminalité) ont vite fait apparaître leurs limites car les effets psychologiques du terrorisme sont démesurés par rapport aux seuls ravages de la violence. L’homme moderne, isolé dans une nouvelle société civile pluraliste le privant de ses liens communautaires qui lui garantissaient son identité et sa liberté, est soudain devenu un otage, comme l’est devenue l’actualité aux prises avec les exigences des terroristes. A contrario, il est un fait que, faute d’écho suffisant et d’une opinion publique, le terrorisme n’a de fait aucune prise sur un État policier. En revanche, les dirigeants des États démocratiques se doivent de décider du comportement des médias, surtout radiotélévisés, en période de crise terroriste : faut-il, notamment, interrompre les programmes ou bien prendre le risque de banaliser l’information, alors que toute forme de tolérance devrait être bannie ?
Dans cette nouvelle ambiance de terreur et de vulnérabilité extrême des citoyens, les étrangers deviennent, pour nombre d’entre eux, des terroristes en puissance alors que leur présence durable en Europe, notamment celle de communautés ethnoculturelles allogènes, devrait être considérée comme une chance pour les Européens ; ceux-ci pourraient saisir cette occasion pour redéfinir les identités de chacun dans un consensus nécessairement pluriel excluant toutes notions de « bons » ou de « méchants » qui transparaissent trop souvent tant en politique intérieure que dans la vie internationale.
Il reste 82 % de l'article à lire
Plan de l'article