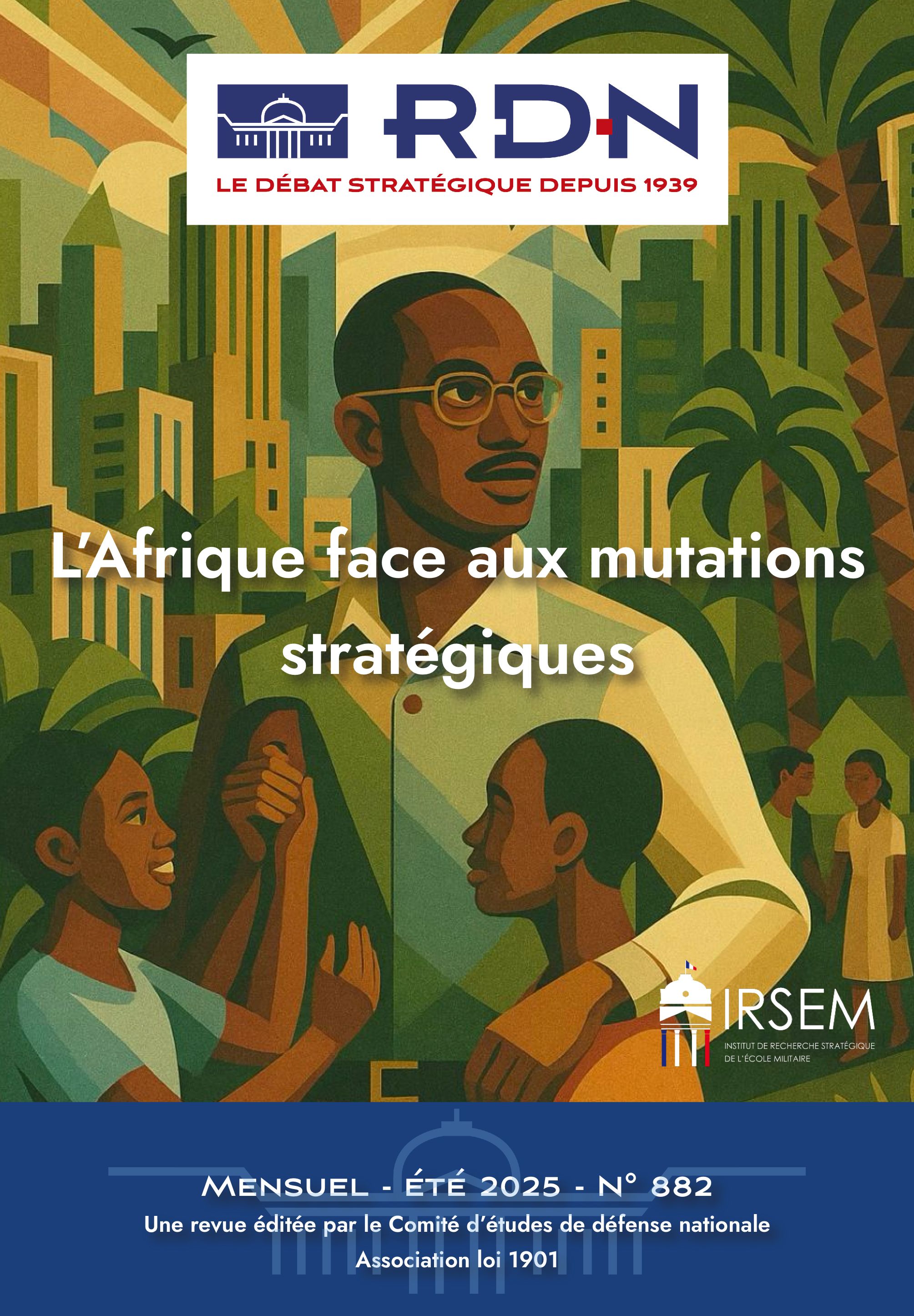Après le changement de président aux États-Unis et le discours d'investiture de Bill Clinton, voici les impressions et réflexions d'une spécialiste sur l'évolution possible de la seule superpuissance restante. Cet article est d'ailleurs en quelque sorte le prélude à notre journée d'études, qui aura lieu fin mars sur le thème : « L'Amérique de Clinton », et où l'auteure prendra d'ailleurs la parole.
William Jefferson Clinton ou « le mandat pour le changement »
L’entrée de William Jefferson Clinton à la Maison-Blanche — le plus jeune président depuis Théodore Roosevelt et John Fitzgerald Kennedy — a suscité aux États-Unis une vague d’enthousiasme et d’espoirs. Les Européens, eux, restent dans l’expectative : Clinton est le premier président des États-Unis à n’avoir pas combattu pendant la Seconde Guerre mondiale (il n’était pas encore né), et donc à n’avoir pas connu, même indirectement, la solidarité des champs de bataille avec les Alliés. Il s’est par la suite opposé à la guerre du Vietnam, et même s’il a fait une partie de ses études en Angleterre, il connaît mal l’étranger et n’a pratiquement pas d’expérience en politique extérieure. La priorité, pour lui, c’est la situation économique et sociale aux États-Unis et c’est dans ce domaine qu’il se croit investi d’un « mandat pour le changement » ; mais ce mandat, pourra-t-il le remplir alors que sa marge de manœuvre est étroite sur le plan intérieur, que les difficultés économiques sont d’une grande complexité, qu’enfin et surtout l’Amérique n’est plus une île et ne peut plus s’offrir le luxe d’ignorer les répercussions de ses décisions sur le reste du monde ?
Raisons et limites d’une victoire
Au début de 1991, tout le monde croyait à une victoire facile du président sortant George Bush : les républicains étaient fermement établis à la Maison-Blanche jusqu’en 1996, peut-être même jusqu’à la fin du siècle. C’est pourquoi plusieurs candidats potentiels du Parti démocrate (Mario Cuomo, Al Gore, Dick Gephart par exemple) décidèrent prudemment de rester à l’écart de la course, se mettant en réserve pour des circonstances meilleures et laissant ainsi le champ libre à Bill Clinton. En fait, rien de bien étonnant dans ces prévisions : depuis plus de quatre décennies une division des rôles semblait s’être instaurée entre les partis : aux démocrates le Congrès, qu’ils ont dominé presque continûment depuis 1945 ; aux républicains la Maison-Blanche que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont gagnée sept fois sur onze (1).
Pourquoi les Américains envoient-ils de préférence des démocrates au Congrès et les choisissent-ils également majoritairement pour les fonctions de gouverneur d’État, alors qu’ils préfèrent le plus souvent placer un républicain à la Maison-Blanche ? La réponse est complexe et ne se réduit pas à un seul argument, mais il est sûr que depuis la fin de la guerre du Vietnam, le Parti républicain est crédité d’une plus grande compétence en matière de politique étrangère. Avec ses échecs répétés dans ce domaine, Jimmy Carter était en mauvaise position pour se succéder à lui-même, et le peuple américain lui a préféré Ronald Reagan, plus soucieux, estimait-on, de défendre les intérêts nationaux.
Il reste 91 % de l'article à lire
Plan de l'article