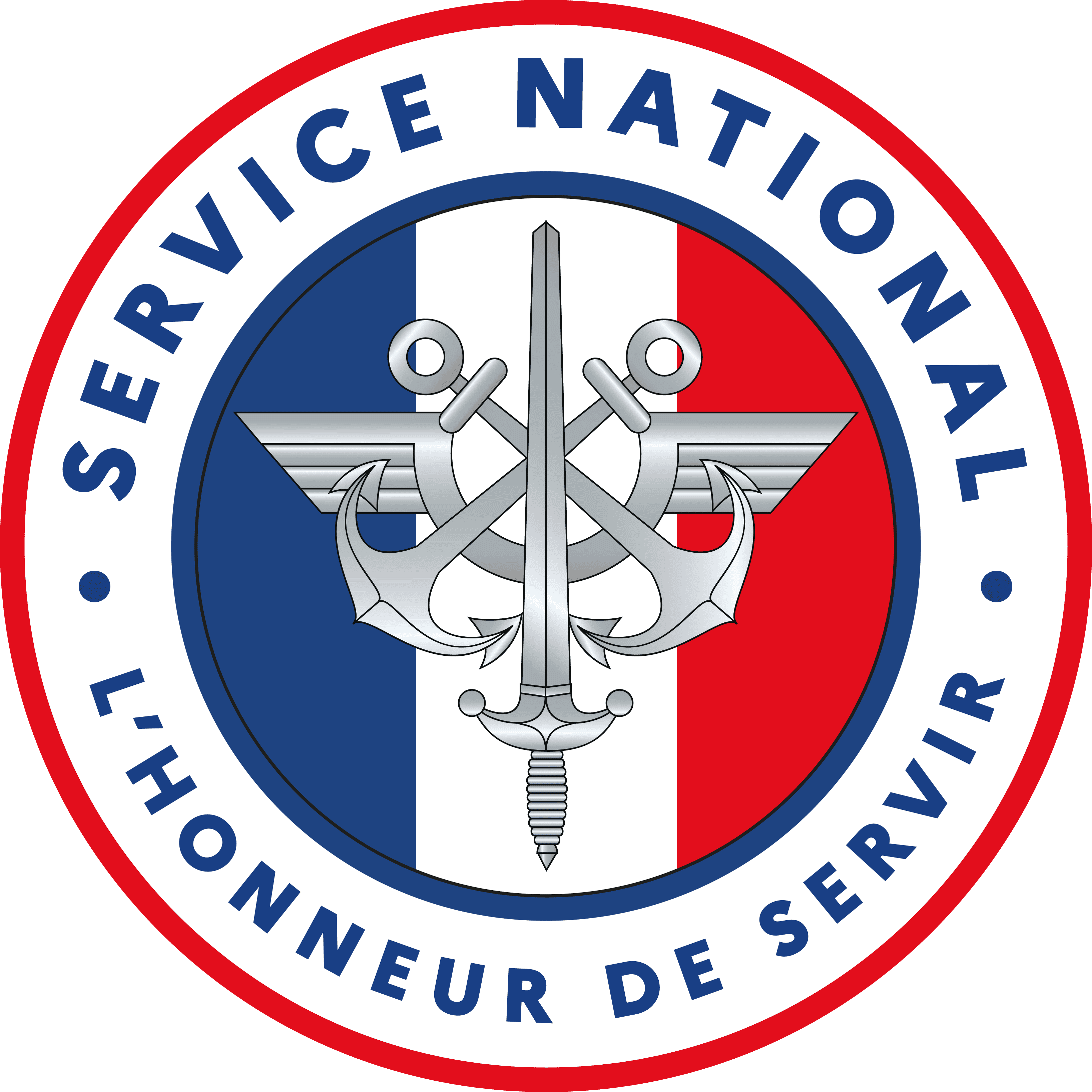L'auteur explique pour quelles raisons il est nécessaire que la France conserve et améliore en qualité un armement nucléaire strictement suffisant. Il nous présente aussi les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la mise en œuvre de cette politique.
La dissuasion nucléaire française : continuité et changement
« La dissuasion nucléaire reste l’un des fondements de la défense du pays ». Ce propos, extrait de la préface du Livre blanc de 1994, se retrouve, deux ans plus tard, dans le rapport annexe au projet de loi relatif à la programmation militaire : « La dissuasion reste l’élément fondamental de la stratégie de défense de la France. Elle demeure la garantie contre toute menace sur nos intérêts vitaux, quelles qu’en soient l’origine et la forme ». Ainsi la continuité est-elle encore la marque de notre stratégie nucléaire. Pourtant, les choses ont changé après les bouleversements de la fin des années 80, qu’il s’agisse du contexte géostratégique avec ses conséquences politiques ou bien des conditions dans lesquelles la dissuasion doit être conduite. Une réflexion s’impose sur ces deux aspects du problème, un problème difficile, complexe, important.
Contexte et conséquences politiques
Nous nous sommes félicités à juste titre du consensus qui s’est établi pendant la guerre froide sur notre politique de défense en général et sur la dissuasion nucléaire en particulier. Le face-à-face de deux blocs armés, largement dotés d’armes de destruction massive, matérialisait une menace évidente que nos capacités de riposte — la nôtre et celle de l’Otan — visaient à écarter. Les Français dans leur ensemble ont bien réalisé que dans une telle situation l’accès de leur pays à la puissance nucléaire était tout à la fois un gage de sécurité et d’indépendance, un facteur d’autonomie stratégique et, en prime, une assurance, celle de ne pas être entraînés dans un conflit qu’ils n’auraient pas voulu. Aujourd’hui, la menace évoquée a fort heureusement disparu. Les risques de conflit majeur se sont estompés. L’heure est à la réduction draconienne des arsenaux nucléaires, ceux des Russes et des Américains en tout premier lieu. Ce n’est pas pour autant la fin de l’histoire. Le monde, Europe comprise, est entré dans une ère de crises, des crises mineures dans la mesure où, tout au moins jusqu’ici, les armes nucléaires ne sont pas en cause. Ces crises n’en sont pas moins préoccupantes par les risques de dérapage qu’elles entraînent, par les dommages qu’elles causent et par les difficultés qu’il y a à les prévoir et à les maîtriser. Les problèmes militaires qu’elles soulèvent aujourd’hui se posent essentiellement en termes de rapport de forces classiques et de capacités d’intervention. Un nouvel équilibre tend à s’établir entre la dissuasion et l’action, rapport en faveur de cette dernière, là où les armes classiques sont appelées à jouer un « rôle stratégique propre ». Dès lors, le fait d’être puissance nucléaire ne garantit plus, à lui seul, cette autonomie stratégique et cette sécurité dont notre pays a profité dès le milieu des années 60.
Notre opinion publique n’est pas insensible à une telle évolution. Si l’on n’y prend garde, elle risque de ne plus comprendre la nécessité de maintenir une capacité de dissuasion nucléaire pour faire face à des situations relevant de vues prospectives plus ou moins lointaines. Le risque est d’autant plus sérieux que la pression des « antinucléaires » se fait plus forte. Tchernobyl et plus récemment la découverte du lamentable état d’abandon de certains sous-marins nucléaires ex-soviétiques dans la mer de Barents ont singulièrement terni l’image de rigueur qui aurait dû rester attachée à tout ce qui concerne l’atome, militaire ou civil. La pression des mouvements antinucléaires est sans doute plus faible en France que dans bien d’autres pays, notamment en Europe. Elle n’en mérite pas moins d’être prise en considération. Il s’agit en effet de faire en sorte que l’adhésion des Français à la dissuasion nucléaire ne se transforme pas en un refus ou en un consensus mou, l’un et l’autre incompatibles avec une stratégie qui exige au contraire l’assise populaire la plus large. Cela relève de la prise de conscience à la fois des incertitudes qui pèsent sur l’évolution des grandes puissances de la planète, des risques de prolifération des armes de destruction massive et des conséquences d’une instabilité susceptible d’engendrer des crises plus graves que celles vécues jusqu’ici, avec la ferme volonté d’y faire face. On rejoint par là même la question plus large du maintien de « l’esprit de défense », vaste sujet et matière à un débat dont notre pays, après la profonde réforme de son système militaire, ne saurait faire l’économie.
Au plan international, maintenir le cap dans le domaine nucléaire est de moins en moins aisé. De traités de non-prolifération en accords portant création d’immenses zones dénucléarisées, les mesures restrictives s’accumulent, réduisant d’autant les marges de manœuvre des puissances nucléaires, dont celles de la France. Ainsi, en mai 1995, la prorogation illimitée du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a constitué certes une avancée remarquable pour les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Les cinq pays en question ont vu en effet leur statut de puissance nucléaire officiellement reconnu. En revanche, ils ont dû accepter un certain nombre de dispositions restrictives non négligeables pour l’avenir : conclusion d’un traité portant interdiction complète des essais nucléaires ; arrêt définitif à prévoir à court terme de toute production de matières fissiles à usage d’explosif (Cut off Treaty) ; et même promesse de ne pas utiliser d’armes nucléaires contre des États non nucléaires signataires du TNP… De telles dispositions sont sans doute rédigées en termes suffisamment souples pour être interprétées de la façon la plus large. Elles permettront néanmoins aux États non nucléaires de fédérer leur action sur des thèmes communs au fil des conférences d’examen du TNP prévues tous les cinq ans.
La France a d’ailleurs eu l’occasion de mesurer les conséquences d’un tel enchaînement. Sa courageuse décision, en juin 1995, de faire sa campagne d’essais a soulevé dans le monde le tollé, réel ou simulé, que l’on sait. Les essais ont eu lieu. Dès le dernier tir effectué, notre pays signait le traité de Rarotonga (février 1996), lequel transforme le Pacifique Sud en zone dénucléarisée, zone qui s’ajoute à bien d’autres (1). Il amorçait dans la foulée le démantèlement complet de son centre d’essais de Mururoa. Il s’engageait par là sur une voie de non-retour, la simulation restant désormais le seul moyen de réaliser de nouvelles têtes nucléaires, moyen dont la fiabilité doit être encore prouvée. Quant au traité d’interdiction des essais (2), il a bien été conclu en septembre 1996. Au lendemain de sa signature, on apprenait qu’il risquerait de ne pas pouvoir entrer en vigueur devant le refus de certains pays, dont l’Inde, de le ratifier (3).
L’ensemble de ces restrictions et engagements n’enlève rien à notre qualité de puissance nucléaire, mais tend à rendre plus complexe le maintien de nos armes au niveau qualitatif susceptible de s’imposer demain. Il traduit la réalité de la pression internationale visant à limiter, sinon à éliminer le nucléaire de la panoplie des moyens militaires. À ces contraintes s’ajoutent celles que bien des pays, dont le nôtre, ont acceptées dans d’autres domaines. Ainsi, les armes chimiques sont-elles appelées à disparaître, et ce en vertu d’accords que plusieurs États, et non des moins agités, n’ont pourtant pas signés (4). Face à un pays qui nous menacerait avec de telles armes, notre dissuasion ne reposerait plus alors que sur notre capacité de riposte nucléaire dont paradoxalement l’importance se trouve renforcée… dans la mesure où l’adversaire ne serait pas signataire du TNP ! Par ces propos, il ne s’agit pas de déplorer le climat de détente qui s’est instauré dans les relations internationales, pas plus que les efforts conduits, notamment par la France, en vue d’abaisser le niveau des armements dans le monde. Il s’agit de mettre en évidence les contraintes susceptibles de s’accumuler au fil des négociations sur le désarmement et d’affaiblir, à terme, nos propres capacités nucléaires, capacités que notre pays a pourtant toujours eu le souci de maintenir à un strict niveau de suffisance. Notre sécurité en dépend ; elle exige dans nos démarches une vigilance et une prudence dont il nous fallait souligner l’importance avant d’aborder une autre famille de problèmes, ceux relatifs à la façon même de dissuader aujourd’hui, c’est-à-dire ceux concernant la stratégie nucléaire. Ces problèmes-là sont d’autant plus importants qu’ils se présentent, en cette période de l’après-guerre froide, sous des aspects le plus souvent nouveaux dont la perception n’est pas toujours évidente.
Stratégie nucléaire et intérêts vitaux
Notre menace de riposte au cœur d’un État qui voudrait s’en prendre à la vie même de notre pays, c’est-à-dire d’abord à notre territoire national, constitue encore le fondement de notre concept de dissuasion. Là, il y a continuité. Certes notre pays, pour la première fois dans son histoire, n’a plus de menace militaire directe à ses frontières ou à proximité immédiate de celles-ci. Les vecteurs à moyenne et longue portées capables de projeter directement de territoire à territoire des armes de destruction massive n’en ont pas disparu pour autant. Nous ne sommes pas certains d’en maîtriser la prolifération. Dans ces conditions, au cas où la France, associée ou non avec d’autres prendrait une initiative jugée inacceptable par telle ou telle puissance ou État nucléaire, il ne saurait être exclu qu’elle soit l’objet d’un chantage dans le style de celui exercé en 1956 à l’encontre de Paris et de Londres au moment où les forces franco-britanniques guerroyaient du côté de Suez. Un tel chantage, aujourd’hui comme hier, n’a aucune signification dès lors que l’on dispose de capacités de riposte de même nature. De ce point de vue, les choses sont encore claires.
En revanche, les caractéristiques mêmes de la riposte et des moyens nécessaires doivent être modifiées, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Dans l’hypothèse d’une résurgence d’une menace majeure en Europe, nous imaginons mal en effet, compte tenu du nouveau contexte, de nous retrouver face à une puissance nucléaire monolithique et omnipotente comme le fut l’URSS dont les troupes, de plus, campaient au beau milieu de notre continent, à deux pas de nos frontières. Nous ne saurions en conséquence dissuader une telle puissance — et a fortiori un État perturbateur, plus ou moins lointain et ne disposant que de quelques armes nucléaires — comme nous dissuadions l’Union soviétique. Dans ces conditions, écarter tout risque de chantage nucléaire impose une capacité de riposte d’emblée stratégique, mais une riposte sans doute moins massive, plus sélective et précise que celle envisagée jusqu’ici. Il s’agit de pouvoir frapper au cœur du pays adverse, en paralysant les centres de décision politique, économique ou militaire les plus essentiels sans provoquer nécessairement l’holocauste dont la perspective s’imposait pourtant au temps de la guerre froide. On en déduit l’évolution souhaitable de nos systèmes d’armes nucléaires : évolution de leur niveau de suffisance, lequel ne saurait être haussé ; évolution vers des portées et des précisions croissantes ; évolution enfin dans la nature des charges dont la gamme des puissances doit être adaptée à un éventail d’objectifs possibles désormais plus large.
Par-delà ces considérations techniques, se pose également la question de la dimension nouvelle que notre dissuasion est susceptible de prendre dans la perspective européenne. D’évidence, plus l’Union européenne s’affirme, plus les liens entre partenaires sont étroits et plus ce qui menacerait la vie de l’un d’eux ne pourrait que menacer la nôtre. Le constat a déjà été fait entre la France et la Grande-Bretagne (5). Considérer à partir de là que nos intérêts vitaux recouvrent aujourd’hui ceux de l’Union serait totalement irréaliste. Dès maintenant, pourtant, un agresseur qui voudrait s’en prendre à la vie d’un de nos partenaires ne pourrait pas ne pas tenir compte de nos propres réactions au plan nucléaire, réactions incertaines pour lui, donc dissuasives. C’est reconnaître que pour nos voisins, notre dissuasion, sans être une garantie, constitue dès aujourd’hui un facteur de sécurité dont l’importance ne peut que croître avec le temps. Le constat est d’importance. Il est une incitation forte au resserrement des liens de tous ordres entre partenaires. Il est à la base de toute concertation sur la dissuasion avec nos voisins.
Stratégie nucléaire et interventions
Le cas relativement simple du « chantage » nucléaire direct, de territoire à territoire, n’est pas le seul à prendre en compte. Étant donné l’accent mis aujourd’hui sur l’intervention, il ne saurait être exclu que tout ou partie de nos forces déployées à l’extérieur puisse être menacé par des armes de destruction massive sans pour autant que la sécurité de notre propre territoire soit en cause, l’adversaire ne disposant pas de systèmes d’armes de portée suffisante. L’hypothèse ne relève pas d’un cas d’école : de fait, pendant la guerre du Golfe, elle était une réalité, compte tenu du potentiel d’armes chimiques dont disposaient les forces irakiennes.
Dès lors que nos intérêts vitaux ne seraient pas menacés, certains, se référant à notre doctrine, n’hésitent pas à éliminer toute perspective d’engagement de nos moyens nucléaires. Et d’évoquer à la rigueur, pour créer un effet dissuasif, une menace de riposte violente conduite avec des armes classiques de nouvelle génération. Certes de telles armes, dans le domaine offensif, sont capables aujourd’hui, par leur précision et leur puissance, de porter des coups très durs à un adversaire. Pour être vraiment dissuasive, une telle menace exigerait néanmoins une capacité de frappe, en classique, considérable, ce qui pour nous n’est pas évident. Surtout, dans la mesure où elle serait mise à exécution, la riposte risquerait d’avoir pour seul effet d’amener l’adversaire à engager de façon encore plus large ses armes de destruction massive avec les conséquences que l’on devine sur nos propres unités. Renoncer à toute dissuasion nucléaire dans les cas évoqués reste néanmoins une possibilité : question de choix stratégique. Le choix est acceptable, à la seule condition d’en tirer la conséquence, à savoir renoncer à intervenir dans toute crise extérieure dès lors qu’il y aurait menaces d’armes de destruction massive.
La perspective ainsi ouverte paraît trop limitative pour ne pas aborder véritablement le problème posé. Pour nous, il n’est pas concevable que des armes de destruction massive (6) puissent être utilisées contre des unités engagées sur un théâtre extérieur sans que l’adversaire n’ait à redouter une riposte elle-même dramatique donc nucléaire, même si nos intérêts vitaux, stricto sensu, ne sont pas en cause. La nature de cette riposte, pour être dissuasive, doit être bien évidemment adaptée aux données spécifiques des situations. Pour cela, il faut sortir des schémas hérités de la guerre froide. À l’époque, compte tenu à la fois de la puissance et de la proximité de l’adversaire potentiel, toute agression de sa part en Europe ne pouvait que menacer d’emblée nos intérêts vitaux : d’où ce couplage très serré, caractéristique de notre doctrine, entre l’engagement de nos forces placées en couverture de nos frontières, la frappe nucléaire antiforces baptisée successivement tactique, préstratégique, puis d’ultime avertissement, et la frappe stratégique massive anticités. Quels que soient les cas de figures possibles, en Europe ou hors d’Europe, ce schéma-là n’est plus. Notre riposte ne saurait être a priori « tactique » ou « préstratégique », au risque sinon d’engager une escalade difficilement maîtrisable. Elle ne saurait avoir valeur d’avertissement — et encore moins d’ultime avertissement —, ce qui supposerait que nous puissions réaliser une frappe en premier ; hypothèse plausible lorsque nos frontières pouvaient être directement menacées par des masses blindées, impensable dès lors que nos intérêts vitaux ne sont pas en cause. Si avertissement il devait y avoir, celui-ci ne pourrait être lancé que sous forme d’une série de frappes violentes contre le dispositif adverse, mais des frappes réalisées uniquement avec des armes classiques. Il s’agirait de matérialiser notre détermination, celle de ne pas nous laisser intimider et de recourir au nucléaire si l’adversaire s’engageait lui-même sur cette voie. Rien de plus.
Dans ces conditions, la frappe dont l’adversaire doit être menacé ne peut avoir qu’un caractère stratégique, par son objet même : enlever à cet adversaire toute capacité de poursuivre son action. Le propos ne sous-entend pas a priori une frappe massive anticités comme celles envisagées à l’époque de la guerre froide. Il ne sous-entend pas non plus a priori des frappes chirurgicales dans le style de celles réalisables par les armes classiques de nouvelle génération, avec promesse, en prime, de ne faire de mal à personne… Il s’agit d’être en mesure d’élaborer des plans de frappe diversifiés, la nature des objectifs étant à déterminer, pour chaque cas, en fonction de la situation politique et militaire de l’adversaire, de ses facteurs de vulnérabilité, tout en tenant compte des contraintes humanitaires éventuelles du moment. Dans le cas évoqué comme dans tous ceux où il est question de dissuasion nucléaire, la crédibilité d’un tel concept suppose bien évidemment que notre intervention se situe dans une stratégie strictement défensive, face à un agresseur mettant en cause des intérêts, sinon vitaux, tout au moins majeurs. Quant aux caractéristiques des systèmes d’armes nucléaires, elles sont absolument identiques à celles définies dans l’hypothèse d’une réponse à un « chantage direct » : capacités de frappe sans doute moins massive mais précise, sélective, le tout sur une échelle de distances et avec une gamme de puissances plus larges afin de pouvoir traiter un éventail plus ouvert d’objectifs choisis en fonction de la situation du moment.
Nos systèmes d’armes nucléaires actuels, et leur évolution en cours, répondent à ces contraintes sous réserve d’efforts à poursuivre dans les domaines de la précision et de la variété de la puissance des charges. À côté des SNLE, la composante air-sol aéroportée concourt notamment à garantir la souplesse requise dans l’élaboration des plans de frappe, frappe à caractère fondamentalement stratégique. Devraient du même coup s’atténuer, voire disparaître, ces conflits d’ordre sémantique (7) qui ont fait des ravages au temps de la guerre froide et n’ont pas contribué pour autant à éclaircir les débats.
Stratégie nucléaire et alliances
Le concept évoqué reste envisageable même dans le cas où nos forces seraient engagées à l’extérieur — c’est-à-dire en dehors de toute protection directe de nos intérêts vitaux — face à un adversaire disposant de moyens nucléaires suffisants pour atteindre non seulement ces forces, mais aussi le territoire national. L’affirmation peut paraître surprenante. Pourtant, dans le contexte actuel, les mouvements de répulsion pour tout ce qui concerne l’atome militaire se sont amplifiés et se traduisent même par des pressions très fortes visant à éliminer l’atome de la panoplie des armes. Dans de telles conditions, le fait pour un « agresseur » de franchir le seuil nucléaire, ne serait-ce qu’en s’en prenant à des unités d’intervention déployées contre lui, aurait par sa gravité et son retentissement énorme une dimension stratégique. Une riposte strictement antiforces ne pourrait qu’atteindre, dans le même contexte, le territoire même de l’adversaire avec des risques évidents de dommages collatéraux, par erreur ou imprécision accidentelle toujours possibles de tir, d’où risques aussi d’escalade susceptibles de conduire tout droit aux frappes dévastatrices de territoire à territoire. C’est pourquoi, au cas où un agresseur serait tenté de franchir le seuil nucléaire, quelle que soit la nature des objectifs visés, le mettre d’emblée face à une menace de riposte stratégique, analogue dans son style à celle déjà évoquée, relève d’une hypothèse méritant une sérieuse attention.
Le présent cas de figure n’en reste pas moins redoutable. Mourir pour Dantzig ou Abou Dhabi, telle serait la question qui se poserait en effet. Sa simple évocation devrait suffire à calmer des ardeurs guerrières intempestives et dramatiquement imprudentes. Elle souligne au passage l’importance vitale de la lutte contre la prolifération, non seulement des armes nucléaires, mais aussi des vecteurs à longue portée. Est-il concevable pour autant qu’elle inhibe totalement notre volonté d’engagement en cas d’agression, même lointaine, mettant en cause des intérêts stratégiques majeurs, voire en cas de conflit interétatique dont l’engagement s’imposerait pour éviter tout débordement susceptible de porter atteinte à ces mêmes intérêts ? Ne s’agit-il pas, pour l’essentiel, d’inhiber la volonté de l’adversaire d’utiliser des armes de destruction massive ?
Pour résoudre le dilemme, on évoque le plus souvent, à juste titre, le cadre de nos interventions. Certes, en aucun cas nous ne saurions renoncer à agir seuls ou à jouer un rôle moteur auprès de nos partenaires. Dans la présente hypothèse cependant, la plus grave, plus encore que dans toutes celles abordées jusqu’ici, nos forces auraient très probablement à intervenir dans un contexte multinational ou interallié, voire dans celui de l’Alliance elle-même ; et d’évoquer alors la dissuasion du grand allié. Celui-ci aurait en effet toute chance d’être concerné par ce genre de crises majeures, que ce soit au sein de l’Otan ou d’une coalition dont il aurait pris la tête.
On peut être tenté alors de s’en remettre à la puissance américaine pour garantir la sûreté de nos forces, face à une menace nucléaire, voire chimique ou biologique, nos propres capacités dissuasives restant attachées à la protection de nos seuls intérêts vitaux. Cela ne signifie pas que nous devions confier à notre allié le sort de nos troupes, les yeux fermés. Il ne s’agit pas, là non plus, d’un simple cas d’école. En mai 1992, à La Rochelle, la décision a été prise de créer un corps d’armée franco-allemand, devenu ensuite corps européen. En cas d’application de l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord, cette formation est susceptible d’être mise à la disposition de l’Otan et d’être engagée à l’avant en dehors de toute mission de protection directe du territoire national. Comment ne pas s’assurer que la stratégie de l’Alliance — de fait celle des Américains — répond bien à nos exigences de sécurité pour nos forces, avant toute décision d’engager celles-ci dans des actions plus ou moins lointaines et à haut risque ?
C’est pourquoi une concertation sur ces questions nucléaires s’impose, notamment avec nos partenaires européens si nous voulons donner à l’identité européenne de défense sa véritable dimension au sein de l’Alliance, condition aussi pour que l’Union dispose à terme de son autonomie stratégique sans laquelle elle ne saurait avoir de réalité. La France aura d’autant plus de chances de faire admettre ses points de vue qu’elle aura mieux affirmé son propre concept et adapté en conséquence ses propres capacités nucléaires. Sans accord sur ces questions, il lui appartient de ne pas s’engager dans des actions susceptibles de se transformer en aventures risquées pour ses forces : cela s’appelle préserver, en toute hypothèse, son autonomie de décision.
Conclusion
La dissuasion nucléaire, une nécessité ? Sûrement, à condition, pour qu’elle soit effective, de surmonter un certain nombre de difficultés dont trois au moins ont été mises ici en évidence. La première est d’en convaincre l’opinion publique et de préserver le consensus qui s’est établi jusqu’ici, tout en faisant preuve de prudence face aux contraintes qui tendent à s’accumuler au fil des négociations internationales sur les questions nucléaires. La deuxième est d’adapter notre doctrine au nouveau contexte, en tenant compte notamment des risques entraînés par les stratégies d’interventions extérieures, là où les notions de frappes préstratégiques et d’ultime avertissement n’ont plus la même pertinence, là aussi où la dissuasion devrait garantir la survie de nos forces au même titre qu’elle a assuré jusqu’ici la seule protection de nos intérêts « vitaux ». La troisième est d’engager une concertation sur la stratégie nucléaire avec nos alliés et partenaires, en intégrant les hypothèses des crises les plus graves, là où nos forces d’intervention et notre territoire pourraient être simultanément concernés. À nous de préciser notre propre concept si nous voulons convaincre. À nos partenaires de prendre en compte notre statut de puissance nucléaire et d’en mesurer l’importance, dans leur intérêt comme dans le nôtre : ce n’est pas là la moindre des difficultés. ♦
(1) À savoir Antarctique (1959), Amérique latine (1967), pays du Sud-Est asiatique (1995), Afrique (1996). Les traités concernant notamment l’Amérique latine – Tlatelolco –, l’Afrique – Le Caire – et le Pacifique Sud signés par la France couvrent nos propres territoires situés dans les zones en question.
(2) CTBT : Comprehensive Test Ban Treaty. Traité dont la négociation a été amorcée à Genève en 1990 au sein d’un comité de la conférence de désarmement, conséquence, il est vrai, de négociations directes conduites depuis longtemps entre l’URSS à l’époque et les États-Unis.
(3) Le CTBT ne pourra entrer en vigueur, selon les dispositions prévues, que six mois après sa ratification par le dernier des 44 pays – dont l’Inde et le Pakistan – possédant des réacteurs nucléaires et susceptibles de réaliser des armes elles-mêmes nucléaires.
(4) Parmi les 30 pays non signataires de la Convention de Paris de 1993 sur l’interdiction des armes chimiques, il faut citer, en plus de la Corée du Nord, les pays du bloc arabe : Irak, Jordanie, Liban, Libye, Syrie, Somalie, Soudan. La Russie a bien signé, mais fait encore partie de la cinquantaine de pays, comme la Turquie et l’Iran, qui n’ont pas encore ratifié la Convention.
(5) Déclaration franco-britannique d’octobre 1995 : « Nous n’imaginons pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’un de nos pays pourraient être menacés sans que les intérêts vitaux de l’autre ne le soient aussi ». Il est vrai que le dialogue sur un tel sujet, entre deux puissances nucléaires alliées, est facile…
(6) Le propos, ici comme dans la suite, s’applique intégralement à une menace « nucléaire ». Il concerne les menaces B et C dans la mesure seulement où l’adversaire est susceptible d’utiliser de telles armes de façon suffisamment massive pour déborder la capacité de protection de nos propres unités, même si l’incertitude de nos réactions doit être de toute façon entretenue. En outre, il faut évoquer les restrictions que nous avons admises (TNP) de ne pas utiliser l’arme nucléaire contre un adversaire, signataire du traité, qui n’en serait pas lui-même doté…
(7) Distinguo entre arme nucléaire tactique, préstratégique, d’ultime avertissement, de théâtre, stratégique, d’ultime recours…