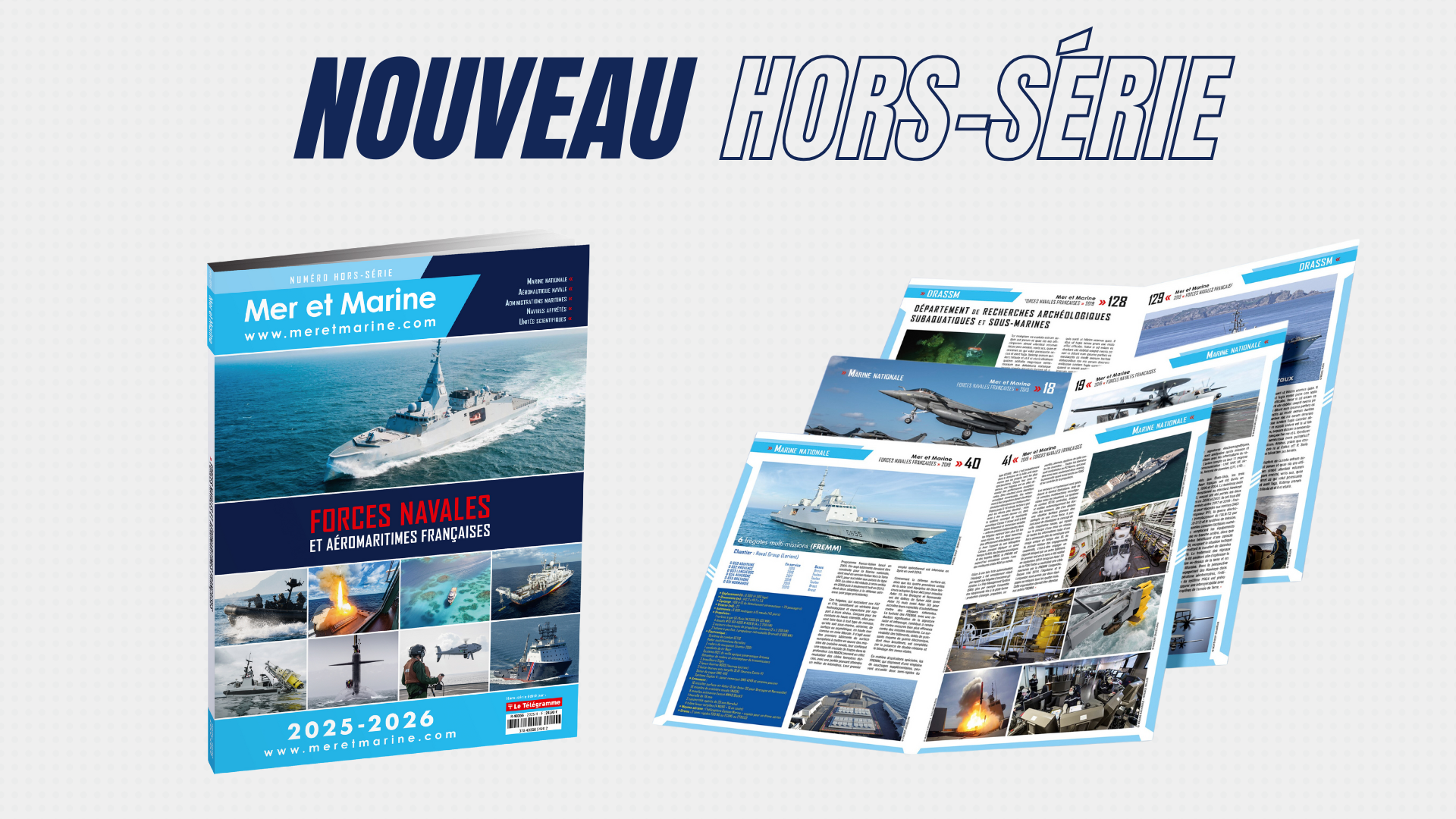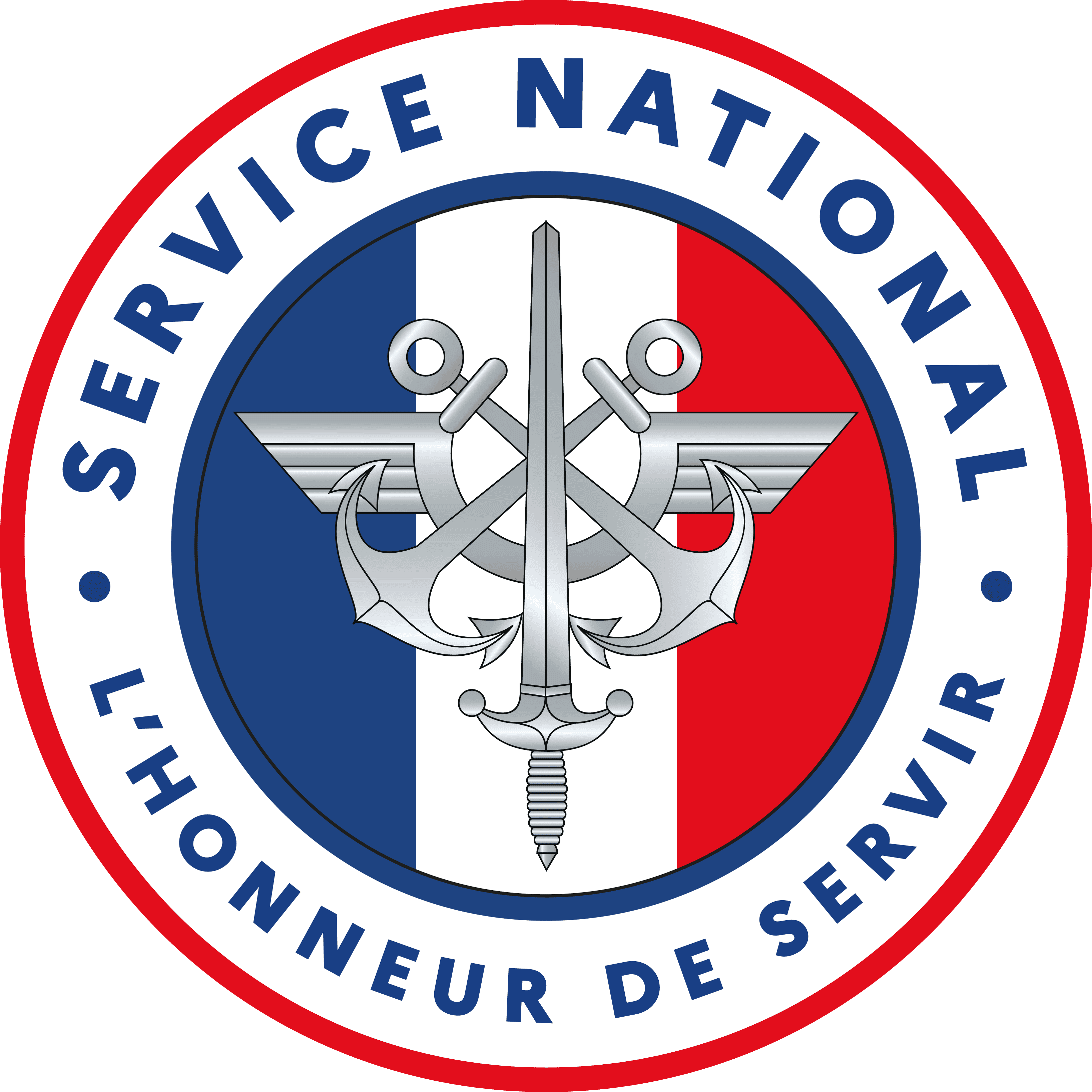L'auteur, spécialiste du Proche-Orient, nous livre ses réflexions sur l'opération contre l'Irak baptisée « Renard du désert » : il fait le point sur l'action elle-même, ses conséquences proches et ses perspectives possibles.
« Renard du désert » : réflexion
Nul doute que l’opération baptisée « Renard du désert » déclenchée par les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la nuit de 16 décembre 1998 contre l’Irak représente un événement d’une grande importance par ses répercussions à la fois mondiales et régionales. En effet, après un nouveau départ et une courte période de réhabilitation, l’Onu semble s’être engouffrée une fois de plus dans une crise où sa crédibilité en tant qu’organisation responsable de la paix et de la stabilité dans le monde allait être sérieusement entamée.
Sans aller jusqu’à en faire le procès, nous nous bornerons à relever les zones d’ombre qui ont entouré l’action ou l’absence d’action envers la question irakienne en général et l’opération « Renard du désert » en particulier. Toutefois, il est d’une extrême importance de souligner le fait que l’Onu, elle-même, n’est qu’une victime de nouvelles tendances apparues sur la scène internationale dans un « nouvel ordre mondial » mal défini et, de surcroît, souvent critiqué. En ce qui concerne le monde arabe, les circonstances qui ont précédé les frappes militaires contre l’Irak, l’ampleur de l’opération ainsi que les dégâts considérables infligés à une population déjà saignée à blanc, ont été pour lui des éléments donnant le coup d’envoi à une polémique lourde de conséquences.
Un débat sur des questions fondamentales
L’opération « Renard du désert », déclenchée contre l’Irak en décembre dernier par deux membres permanents du Conseil de sécurité, allait relancer le débat sur des questions fondamentales. Au centre de celui-ci, se trouvent, entre autres, les points suivants : le principe du recours à la force au nom de l’Onu, mais sans son aval explicite ; l’application partielle des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ; les activités suspectes menées par une commission dépendant de l’Organisation mondiale ; la finalité de l’imposition de sanctions prolongées pour ne pas dire permanentes ; le droit d’ingérence dans les affaires intérieures d’un État et enfin l’introduction de la notion de « tutelle permanente » de l’Onu sur un État indépendant.
Il reste 92 % de l'article à lire
Plan de l'article