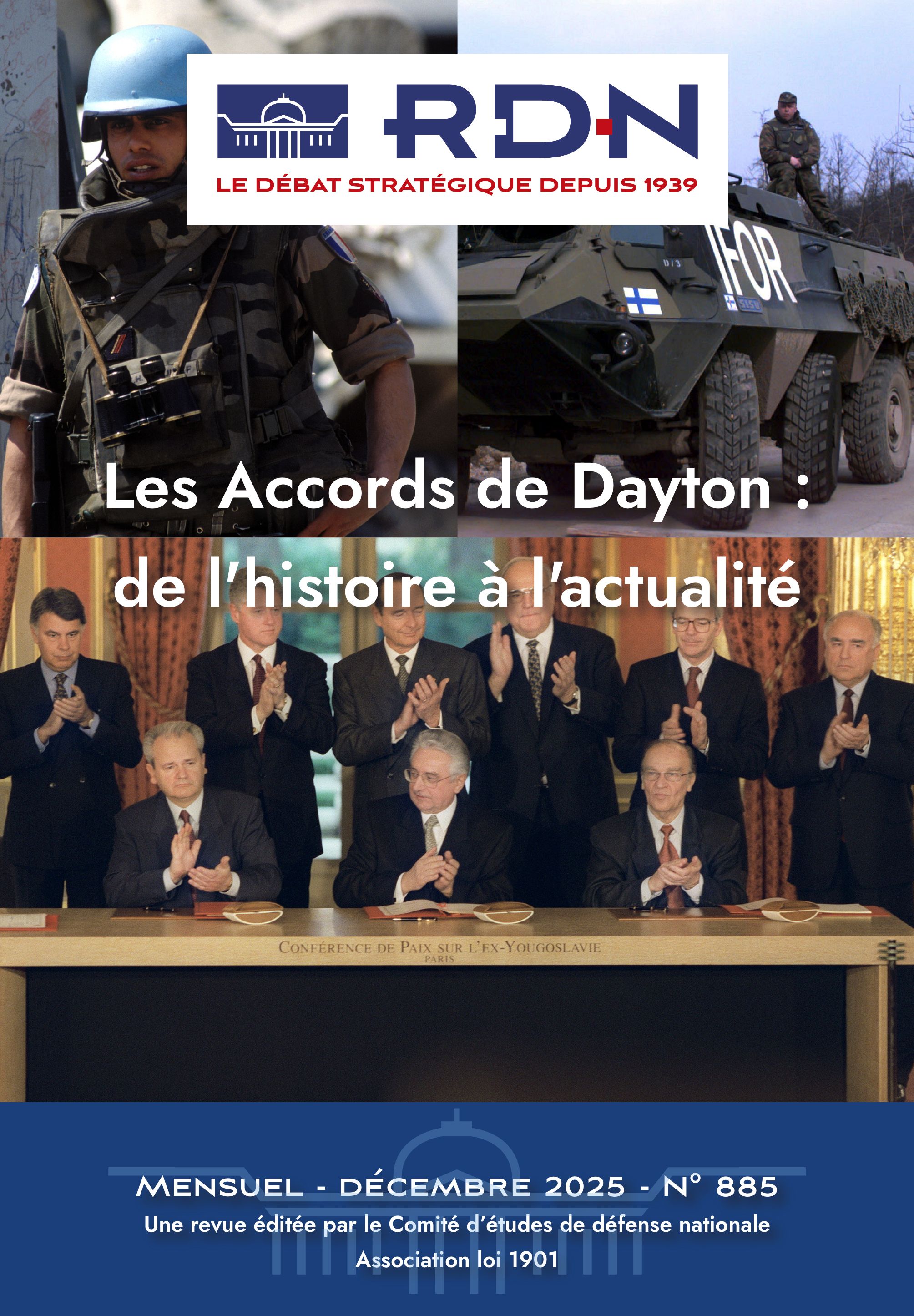Politique et diplomatie - Le retour des empires
Raymond Aron se plaisait à le répéter : les États-Unis, presque malgré eux, sont devenus une « République impériale ». On pourrait dire aujourd’hui un « Empire républicain », tant les tendances hégémoniques de Washington se sont renforcées depuis vingt ans. Constatons aussi que la deuxième puissance économique du monde est un autre empire, celui du Soleil-Levant, bientôt talonné par un troisième, l’ex-empire du Milieu. Immense et imprévisible, l’empire russe, après avoir fait trembler le monde lors de son ascension, l’inquiète maintenant sur sa pente descendante, dont il ne faudrait cependant pas surestimer la déclivité. Deux autres entités impériales sont en passe de figurer dans le peloton de tête des puissances mondiales. Les dimensions du sous-continent Indien, sa forte personnalité, un décollage économique réussi, sa puissance militaire, ses avancées technologiques justifient, en effet, qu’il mérite à nouveau le titre d’Empire des Indes. Quant à l’Union européenne (l’UE, dit-on maintenant, comme pour souligner son côté technocratique), qu’est-elle d’autre qu’un empire en gestation ?
Ne nous laissons pas impressionner outre mesure par la taille du plus grand. Tout écrasant qu’il soit, il n’a pu fermer la porte du club impérial à ceux qui, comme la noblesse de jadis, peuvent, grâce à leurs privilèges, se mettre hors la loi commune. Pour être admis dans ce club, il faut, à l’évidence, une dimension démographique, géographique et économique qui apporte une différence de nature et non plus de degré (à eux six, les nouveaux empires comprennent plus de la moitié de l’humanité, couvrent près de la moitié des terres émergées, produisent trois ou quatre fois plus en valeur que le reste du monde, contrôlent la plupart des matières premières et, surtout peut-être, monopolisent le pouvoir financier). S’y ajoute la dimension scientifique et technologique (leur domination est là quasi totale), et donc, de nos jours, militaire. Pour être respecté, un empire, en effet, doit disposer de satellites, de missiles à longue portée et de l’arme nucléaire (le Japon, on le sait, étant l’exception). Pour préparer l’avenir, il ne doit pas non plus se laisser distancer dans la recherche. Pour être estimé, il doit être en mesure de faire figurer d’éminentes personnalités dans les cénacles de haute culture.
Davantage encore, il doit être porteur d’une individualité affirmée, ou plutôt d’une tournure de civilisation, capable de rassembler des populations désireuses aussi bien de résister à d’autres ensembles que de continuer à respecter leurs valeurs propres ; autant dire qu’une matrice religieuse, qu’elle soit unique ou composite, a façonné chacun de ces empires, suivant son génie propre, d’une manière forte et originale. L’ensemble est consolidé par une langue enracinée dans une culture commune et de grand coefficient d’utilisation (anglais dans sa version américaine, russe, chinois, japonais, hindi, l’Europe cependant — exception confirmant la règle — luttant pour conserver son hétérogénéité linguistique qui reflète sa diversité). Faute de cette individualité vivace, les empires, depuis toujours, sont menacés de se disloquer ou de se laisser absorber dans des ensembles plus dynamiques.
Il reste 78 % de l'article à lire
Plan de l'article