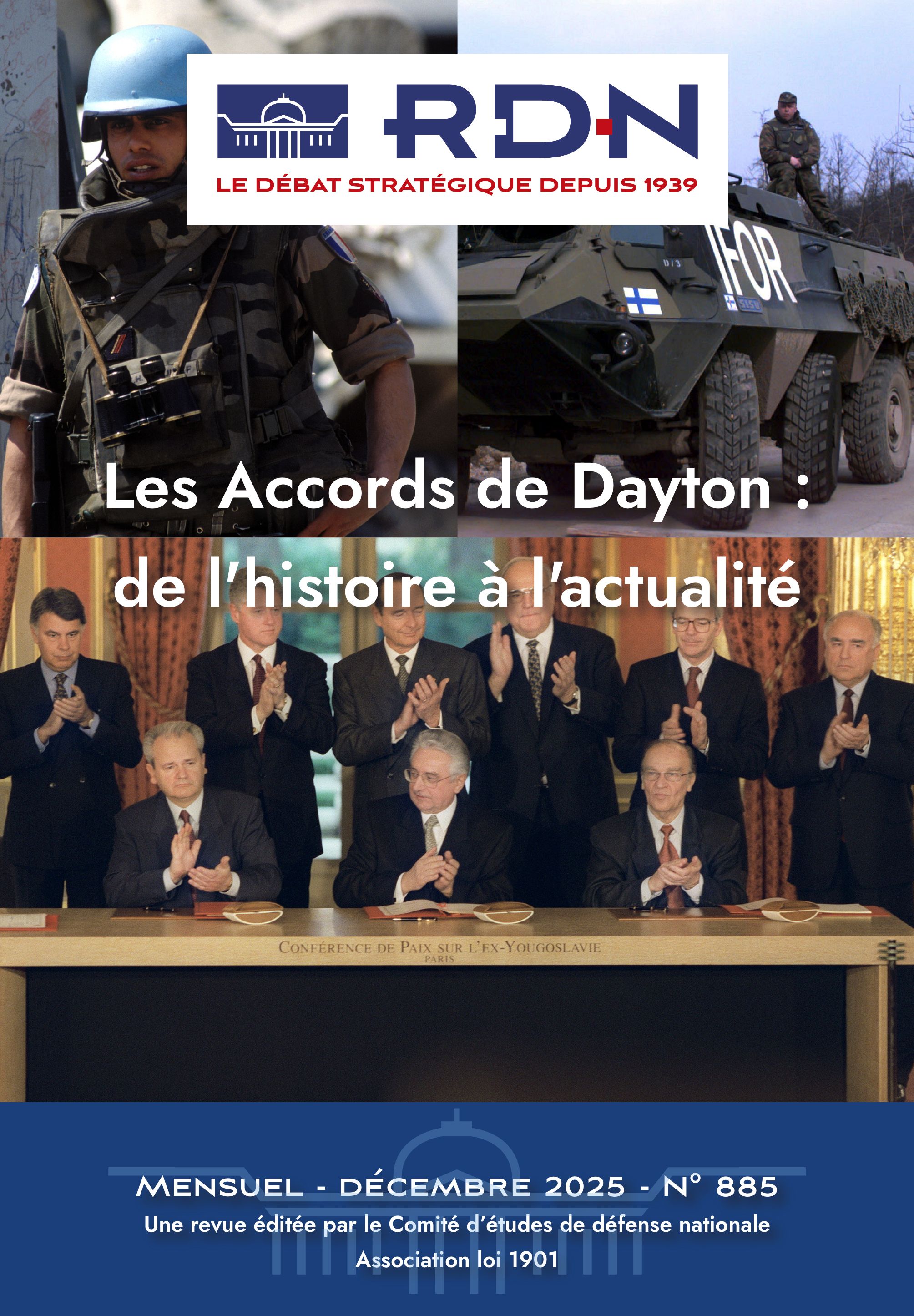À la demande du ministre de la Défense, il vient d'être procédé à un examen critique du dispositif de la réserve opérationnelle instauré par la loi du 22 octobre 1999. Si les conclusions de cette étude ne remettent pas en cause les grands principes de la réforme, elles conduisent néanmoins à revoir le format, l'organisation, les conditions d'emploi et les modalités de montée en puissance de la réserve.
Ces mesures s'accompagneront d'une actualisation de la loi, de la mise en place d'un partenariat entre la Défense, les réservistes et les entrepreneurs, et seront soutenues par un effort budgétaire constant sur la durée de la loi de programmation.
Si la réserve a pu sembler absente du débat pendant un certain temps, force est de constater qu’elle constitue aujourd’hui une des priorités du ministère de la Défense : groupes de travail, commissions d’études et activités à venir témoignent de l’actualité du sujet et surtout de l’importance qui lui est désormais accordée.
Le coup d’envoi de cette nouvelle politique a été donné en octobre dernier lorsque le ministre a confié au chef d’état-major des armées la mission de redéfinir, en liaison étroite avec les armées, la Gendarmerie et les services, la place tenue par la réserve militaire dans l’emploi des forces armées. Il lui était également demandé « de valider ou de modifier le concept d’emploi et le format de chaque composante réserve ». Les conclusions de ce travail ont été présentées au ministre fin juin. Les décisions prises à cette occasion donneront lieu, dès la rentrée, à l’ouverture d’un vaste chantier dont le but est de fournir à la réserve un cadre juridique, réglementaire et budgétaire cohérent avec les objectifs retenus. Ce sont les grandes lignes de ce projet que nous nous proposons d’examiner maintenant.
Une étude exhaustive des besoins
Le groupe de travail mis sur pied par l’état-major des armées (EMA) s’est attaché d’abord à définir les situations de référence dans lesquelles la réserve est appelée à intervenir : le temps de paix (situation S1), le temps de crise (S2), incluant la juxtaposition de plusieurs crises d’intensité moyenne (1), et la crise extrême (S3) combinant un engagement majeur à l’extérieur avec des troubles graves à l’intérieur du territoire national. Pour chacune de ces situations, l’EMA a évalué ses besoins en termes de capacités opérationnelles, laissant aux autorités organiques le soin de définir la politique et le format de leur composante réserve. L’étude a été conduite dans le respect des principes définis en 1997, à savoir :
Une étude exhaustive des besoins
Une grande souplesse d’emploi
Une organisation adaptée à la politique d’emploi
L’indispensable adaptation de la loi sur les réserves
Durées d’activités
Limites d’âge
L’entreprise
Autres aménagements
Une politique de recrutement attractive
Budget
Des mesures incitatives
Des moyens en cohérence avec les ambitions affichées
Une pyramide déformée
Des taux d’activité variables
Les difficultés des services
Le nouveau schéma de montée en puissance