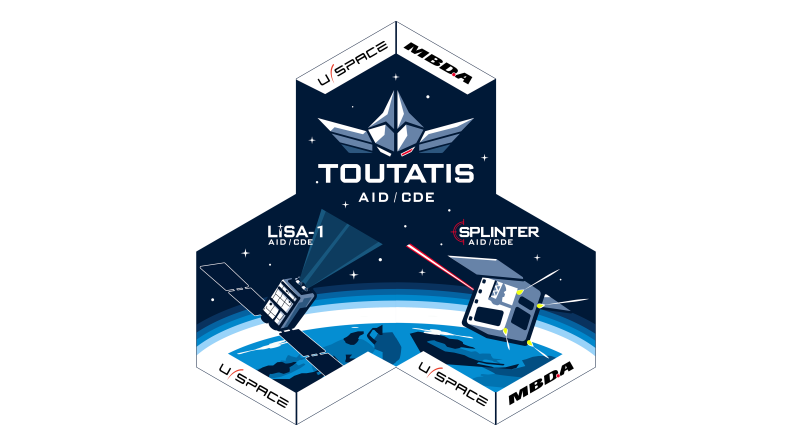Afrique - Politiques africaines de la France et du Royaume-Uni
C’est d’une manière très symbolique qu’une nouvelle page de la politique africaine de la France a été tournée en mars 1999 en Afrique occidentale, entre Accra et Abidjan. Un siècle après Fachoda et les mésaventures du capitaine Marchand face au général Kitchener, le ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine et son homologue britannique Robin Cook ont effectué leur première visite conjointe sur le continent et présidé dans la métropole ivoirienne une conférence d’une vingtaine d’ambassadeurs de France et du Royaume-Uni en poste dans l’ensemble de l’Afrique. Les deux éternels grands rivaux sur ce continent commençaient à concrétiser ainsi l’accord établi lors du sommet franco-britannique de Saint-Malo en décembre 1998, qui affichait l’intention des deux gouvernements de travailler désormais plus ouvertement et plus concrètement dans les affaires africaines, de franchir une étape supplémentaire dans le dialogue politique bilatéral déjà engagé, ou dans les efforts notables de convergence au profit de la politique étrangère et de sécurité commune européenne.
Cette déclaration conjointe de Saint-Malo précise que les deux pays intensifieront la coopération technique et diplomatique entre leurs ambassades jusqu’à la délégation de représentation dans certains pays, où l’un ou l’autre n’est pas présent, qu’ils contribueront ensemble à stimuler l’intégration régionale « notamment entre les réseaux des pays anglophones et francophones ». Il faut noter à cet égard que la France dispose actuellement de 39 ambassades en Afrique contre 26 pour le Royaume-Uni… et 36 pour l’Allemagne.
« C’est une coopération concrète et visible », explique-t-on du côté français « qui ne peut se substituer ni aux politiques bilatérales des deux pays, ni à la Pesc ». C’est en tout cas une coopération qui bénéficie de fait d’un solide coup d’accélérateur grâce à la conjoncture politique. Le gouvernement de Lionel Jospin, en accord avec le président de la République Jacques Chirac, est en train de faire évoluer notablement la politique africaine de la France, en particulier dans le sens d’une ouverture plus large aux pays anglophones et d’une coordination plus étroite avec les autres partenaires européens. De son côté, le gouvernement de Tony Blair, qui a réorganisé le dispositif britannique de coopération et nommé deux ministres très engagés dans ce domaine, Clare Short, secrétaire d’État au développement international, et Tony Lloyd, secrétaire d’État à l’Afrique, a tenu, après 18 ans de pouvoir des conservateurs, à prendre des engagements nouveaux sur le volume de l’aide au développement, sur la démocratie et les droits de l’homme et sur le contrôle des ventes d’armes.
Après une longue période de libéralisme économique, au cours de laquelle le commerce l’emportait sur tout et l’aide était passée de 0,51 à 0,27 % du PNB, la nouvelle politique britannique retrouve de nombreux points de convergence avec celle de la France : sur la nécessité impérative de lutter contre le recul de l’aide publique à l’Afrique, sur le dossier essentiel de la réduction de la dette africaine, sur la problématique de la conditionnalité politique, ou sur les perspectives de l’aide multilatérale, en particulier par le FMI et la Banque mondiale ou conformément à la Convention de Lomé.
L’aide publique britannique, selon le comité d’aide au développement de l’OCDE, a continué à baisser en 1997 (3,4 milliards de dollars, soit 0,26 % du PNB). Cependant, le gouvernement s’est engagé à redresser cette tendance par l’action du nouveau ministère du Développement (Department for International Development créé en 1997) pour atteindre 0,30 % du PNB en 2001, afin de réaliser les objectifs énoncés dans le Livre blanc sur le développement publié fin 1997. Selon celui-ci, seront privilégiés les pays qui accordent la priorité à la lutte contre la pauvreté et appliquent une politique économique saine. En 1997, parmi les dix plus gros bénéficiaires de l’aide britannique, figuraient la Zambie (2e position derrière l’Inde), l’Ouganda (4e position), la Tanzanie (6e position), le Malawi et le Mozambique (8e et 9e positions).
La présence britannique en Afrique ces dernières décennies est restée très concentrée sur quelques pays anglophones, et a laissé une place prioritaire à la défense des intérêts commerciaux et à l’action des grandes entreprises (pétrole, agroalimentaire, transport aérien, etc.). Depuis peu, et dès avant le retour des travaillistes au pouvoir, on a constaté cependant un regain d’intérêt politico-militaire pour les affaires africaines. Il a été marqué d’abord par le retour de l’Afrique du Sud au sein du Commonwealth et les efforts déployés par Londres pour retrouver une influence dans ce pays, puis par le soutien privilégié accordé à l’Ouganda et à la politique de Yoweri Museveni, enfin, depuis peu, par le rapprochement avec le Nigeria, favorisé par la transition politique dans ce pays (dont la fin de la suspension de sa participation au Commonwealth est attendue en mai 1999).
Ce regain d’intérêt s’est aussi manifesté notablement dans le maintien de la paix en Afrique : d’abord par l’aide accordée par Londres aux programmes de formation pour le développement des capacités africaines dans ce domaine, en particulier au Zimbabwe et au Ghana ; ensuite par le soutien apporté aux efforts de la Cédéao en Afrique de l’Ouest (malgré les mauvaises relations politiques avec le Nigeria) et à ceux de la SADC en Afrique australe. Le Royaume-Uni s’est en particulier beaucoup engagé en Sierra Leone au cours des derniers mois en finançant l’intervention de l’Ecomog pour 20 millions de livres sterling, plus un engagement jusqu’à 10 millions de livres dans les autres contributions volontaires. Enfin, plus globalement, Londres s’est engagé, avec Paris et Washington, à soutenir à long terme le développement des capacités africaines de maintien de la paix à tous les niveaux : aux Nations unies, à l’OUA et dans les organisations sous-régionales.
L’engagement en Sierra Leone montre en tout cas une évolution de la politique de coopération militaire britannique en Afrique qui est restée faible, limitée à quelques missions de courte durée et à l’accueil de quelques stagiaires (Ghana, Ouganda, Zimbabwe, mais aussi Mozambique, Sénégal ou Mauritanie). La coopération militaire est évaluée à 40 millions de livres, dont 10 % seulement sont destinés à l’Afrique. Enfin, il faut noter que le Royaume-Uni a décidé aussi de soutenir des exercices régionaux d’entraînement au maintien de la paix (en avril 1997 au Zimbabwe, avec la participation de huit pays et 2 500 hommes). Dans ce domaine, en tout cas, le rapprochement avec la France est indéniable. Londres avait par exemple soutenu l’action de Paris en Centrafrique et la mise en place de la Minurca. Les deux gouvernements ont visiblement coordonné leurs appuis respectifs à la Cédéao dans les opérations de l’Ecomog en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Il reste encore, cependant, de notables divergences à surmonter pour parvenir à mettre en œuvre une politique conjointe franco-britannique en Afrique. C’est le cas dans la région des grands lacs et notamment en ce qui concerne la politique de l’Ouganda (même si, à Londres, l’engagement du Zimbabwe au côté de la République démocratique du Congo de Laurent Désiré Kabila rend les choses plus complexes). C’est aussi le cas dans le domaine des exportations militaires, où les deux pays se sont par exemple livrés à une concurrence acharnée dans le marché sud-africain. On peut enfin citer le délicat problème du rôle des Nations unies en Afrique pour la prévention et le règlement des conflits, qui permettra sans aucun doute de mesurer jusqu’où le Royaume-Uni est prêt à prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis pour s’allier à la France. ♦