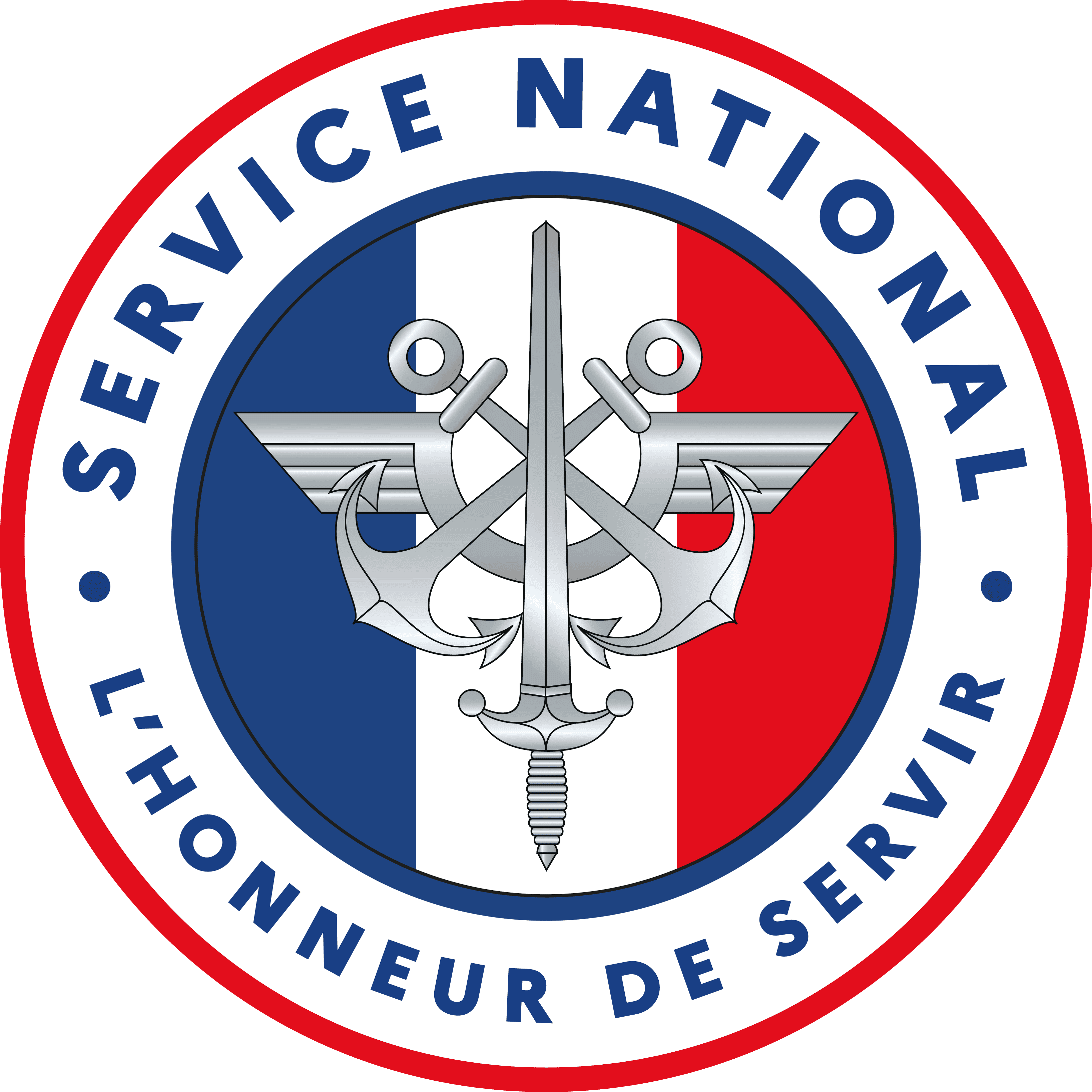Afrique - Séisme politique en Côte d'Ivoire
Il a suffi de quelques heures, à la veille de Noël en Côte d’Ivoire, pour voir s’effondrer l’héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, assumé par son dauphin Henri Konan Bédié au pouvoir depuis la mort de celui-ci en 1993. Dans ce pays qui n’avait jamais connu de coup d’État et qui a toujours été présenté comme un modèle de développement économique et de stabilité politique, tout le monde s’attendait à une année 2000 très tendue et agitée, fortement instable jusqu’à l’élection prévue pour le mois d’octobre. Personne n’aurait parié sur une telle issue de la crise qui pourtant allait en s’aggravant.
Le jeudi 23 décembre dans la matinée, ce sont quelques dizaines de soldats ivoiriens qui se répandent dans les rues de la capitale économique en tirant en l’air, et vont envahir les locaux de la radio et de la télévision nationales. Ces militaires en colère qui se mutinent viennent du camp d’Akouédo, à l’est de la capitale. Ils appartiennent à un contingent ivoirien engagé dans la Mission des Nations unies en Centrafrique. Leurs revendications sont purement matérielles : ils réclament le versement de primes non perçues. Ils sont vite rejoints par plusieurs dizaines de militaires du rang et quelques sous-officiers. Comment et pourquoi cette mutinerie limitée va-t-elle dégénérer ? D’abord, tout bêtement, parce que les uns après les autres les interlocuteurs de ces mutins vont faire preuve d’une totale incompréhension ; le commandant de l’armée de terre en premier lieu, le général Maurice Tauthuis, qui fait accueillir les mutins par des coups de feu ; puis le ministre de la Défense Bandama Ngatta et plusieurs autres membres du gouvernement qui ne parviennent pas à convaincre les mutins. Ils savent pourtant que le malaise dans l’armée ivoirienne existe. Cette petite armée d’à peine 15 000 hommes a toujours eu des moyens et un poids limités : une des plus faibles de la région, et voulue comme telle par Houphouët-Boigny qui, pour des raisons économiques et politiques, avait constamment fait le pari du « parapluie français » pour assurer la sécurité de son pays. Avec un budget de défense de quelque 65 milliards de francs CFA et des bailleurs de fonds intransigeants sur les dépenses militaires, les forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) ont eu de plus en plus de mal à faire face aux crises régionales (Liberia, Sierra Leone, Guinée-Bissau), à l’insécurité intérieure (une bonne partie des effectifs appartiennent à la gendarmerie), et les troupes ont vu leur situation matérielle et personnelle se dégrader.
Vendredi 24 décembre, en fin de matinée, c’est encore l’échec dans les négociations entre les mutins et le président Konan Bédié lui-même, qui ne parvient pas à désamorcer la crise. Cependant, déjà, cherchant à sortir de l’impasse, les mutins ont donné une autre tournure à leur révolte en allant chercher le général Robert Gueï, ancien chef d’état-major des armées nommé par Houphouët en 1990, champion du rétablissement avec fermeté de l’ordre dans le pays, et limogé en octobre 1995 par Konan Bédié qui l’accusait alors de comploter contre lui ; mais qui, surtout, avait mal pris son refus d’engager ses troupes pour le maintien de l’ordre pendant une campagne électorale très tendue et boycottée par tous les grands partis d’opposition. L’arrivée de Robert Gueï à la tête de la mutinerie allait favoriser le ralliement de plus en plus important des militaires et transformer cette révolte de la troupe en mouvement politique, entraînant contre le régime une grande hostilité dans le pays. Victime de son impopularité et de son obstination, le président Bédié n’a eu très vite d’autre recours que la fuite, sous la protection des militaires français.
En politique, le président Henri Konan Bédié avait choisi depuis 1994 une position restrictive et agressive à l’égard de ses oppositions, aussi bien qu’envers la société civile (étudiants, journalistes) : une nouvelle loi électorale et une révision constitutionnelle lui avaient permis d’allonger son mandat de 5 à 7 ans, d’établir une responsabilité directe et exclusive des ministres vis-à-vis du président, de se doter d’un article 11 lui donnant des pouvoirs exorbitants « en cas de force majeure », de supprimer le droit de vote aux non-nationaux résidents dans le pays, et de fixer des conditions d’éligibilité à la magistrature suprême exigeant des parents ivoiriens de naissance, une nationalité ivoirienne du candidat, et une résidence continue dans le pays pendant les dix années précédant l’élection. Ces dispositions visaient l’ancien Premier ministre d’Houphouët, Alassane Dramane Ouattara, devenu directeur général adjoint du FMI, écarté de la présidentielle de 1995 et candidat déterminé à celle d’octobre 2000.
Depuis plusieurs mois, le régime avait entrepris une campagne destinée à établir juridiquement qu’Alassane Ouattara était de nationalité burkinabé, allant jusqu’à le poursuivre devant les tribunaux et à établir un mandat d’arrêt contre lui. Les dirigeants principaux de son parti avaient été arrêtés lors d’une manifestation, condamnés pour violation de la loi anticasseurs et emprisonnés. Le mot d’ordre présidentiel était celui de la défense de « l’Ivoirité » : dans un pays de 15 millions d’habitants dont près de 40 % d’étrangers, cette politique créait un climat malsain et dangereux favorisant les manifestations de xénophobie les plus violentes, aggravé par une inquiétude des musulmans du Nord du pays (40 % de la population) plutôt favorables à Alassane Ouattara.
Cette dégradation politique et ces maladresses ont pris place dans un environnement économique qui n’arrangeait pas les choses. D’abord, une corruption de plus en plus forte et notoire des dirigeants du pays, dénoncée dans le pays et en termes à peine voilés par les bailleurs de fonds. Ensuite, une politique de libéralisation et de privatisation mal maîtrisée, très sensible en particulier dans les filières de commercialisation du café et du cacao, principales richesses du pays. Enfin, des relations exécrables avec les bailleurs de fonds multilatéraux (FMI, Banque mondiale, Union européenne), principaux soutiens économiques de la Côte d’Ivoire, à tel point découragés par la mauvaise gestion, le refus de la transparence et les fraudes, qu’en 1999 moins de 10 % de l’aide extérieure promise a été effectivement décaissée. Handicapée par la baisse récente des cours du cacao et du coton, la Côte d’Ivoire, après les quelques années de répit qui avaient suivi la dévaluation du franc CFA de 1994, s’est retrouvée à la fin de la décennie dans une situation financière catastrophique face à des investisseurs méfiants et des bailleurs réticents, et alors que près de 40 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté.
Poids lourd économique de l’Afrique de l’Ouest francophone, pilier historique de la présence française dans la zone, modèle de stabilité politique, la Côte d’Ivoire a, depuis l’indépendance, bénéficié de la protection, voire de l’indulgence de ses partenaires étrangers. Henri Konan Bédié a sans doute cru que cette situation constituait pour lui un bouclier inaltérable, à l’abri duquel il pouvait se permettre de refuser obstinément d’écouter les mises en garde, nombreuses ces derniers temps, de plusieurs de ses pairs africains et de ses partenaires occidentaux. Sur son attitude à l’égard d’Alassane Ouattara, sur la tournure dangereuse du débat sur « l’Ivoirité », sur la corruption et les fraudes, l’héritier d’Houphouët a laissé les dérives dépasser le seuil critique. Isolé dans son propre pays, peu ou pas défendu par des dirigeants africains qui se sont souvent contentés d’une condamnation de principe du coup d’État, il est en tout cas apparu pour la France, son seul allié qui pouvait intervenir en sa faveur, qu’il ne méritait pas d’être maintenu au pouvoir par la force.
Voilà une illustration exemplaire, en l’occurrence, de cette nouvelle politique de non-ingérence et de non-interventionnisme affichée par Paris, et qui n’est plus désormais susceptible de susciter le doute.
30 décembre 1999