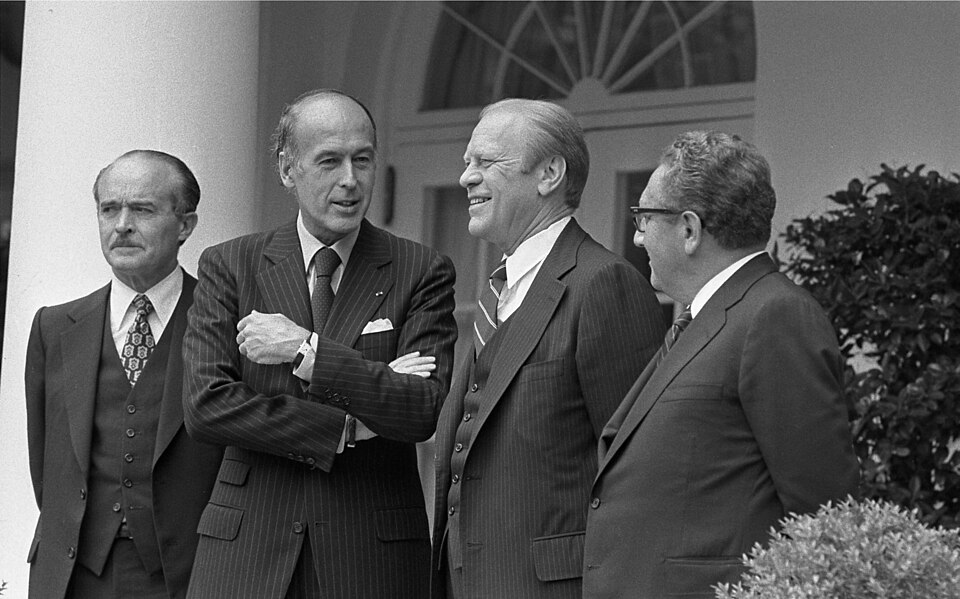Asie - Jian Zemin aux États-Unis : un succès avant tout personnel
Le président chinois a effectué, du 26 octobre au 2 novembre 1997, sa première visite d’État aux États-Unis. Depuis 1989, il souhaitait ce voyage très symbolique que lui refusait Washington. Il en a payé le prix fort. Ce voyage a-t-il été le succès affirmé par Pékin ? Il a surtout été une victoire pour Bill Clinton et la diplomatie américaine dont les pressions sur la Chine ne devraient pas se relâcher.
Après la répression du mouvement étudiant en juin 1989, de nombreux pays avaient pris des sanctions contre le gouvernement de Pékin. Pour les États-Unis, la Chine était coupable d’atteinte aux droits de l’homme, de prolifération des armements et de pratiques commerciales défavorables aux intérêts américains. Dans le bras de fer engagé par Bill Clinton, elle avait gagné plusieurs manches. Après son élection, le président américain avait décidé de lier le statut de la nation la plus favorisée, voté chaque année par le Congrès, à celui d’une amélioration sensible de la situation des droits de l’homme. L’année suivante, sans qu’aucun progrès n’ait été enregistré, il fut contraint, sous la pression des milieux d’affaires américains et hongkongais, de renouveler ce statut et de ne plus le lier aux droits de l’homme. Dans le nouveau contexte international (fin de la guerre froide et effondrement de l’URSS), la diplomatie américaine s’est rapidement aperçue qu’elle ne pouvait parvenir à ses fins sans l’assistance ou la neutralité d’une Chine disposant du droit de veto aux Nations unies. Ce fut le cas, en particulier, pour pouvoir intervenir en Irak, en Somalie et en Bosnie. En Asie, sa participation a été indispensable pour le succès de l’accord de paix au Cambodge et pour résoudre la crise du nucléaire en Corée du Nord. Consciente de sa position de force, la Chine s’est montrée arrogante et a pris la tête d’une campagne internationale pour remettre en cause la Charte des droits de l’homme des Nations unies.
Pourtant, Jiang Zemin était insatisfait. Alors que, les uns après les autres, les pays occidentaux ont passé l’éponge sur les événements de Tian’anmen par des visites officielles réciproques des chefs d’État ou de gouvernement, Bill Clinton continuait de lui refuser ce geste symbolique. Les deux hommes se sont pourtant rencontrés plusieurs fois, et même sur le sol américain, mais lors du forum économique Asie-Pacifique (Apec), quand le sommet de cette organisation a eu lieu à Seattle en 1993. Le président chinois s’était vu refuser de doubler cette réunion par une visite officielle. Il s’était vengé en se rendant directement à Cuba afin d’apporter son soutien fraternel à Fidel Castro. La visite privée du président taiwanais Lee Teng-hui en juin 1995, puis la tension militaire dans le détroit de Formose en mai 1996, ont particulièrement détérioré les relations sino-américaines. Tandis que Jiang Zemin cherchait à chausser les bottes d’un Deng Xiaoping agonisant, tant dans son pays qu’à l’étranger, les grandes sociétés américaines faisaient les frais des mauvaises relations bilatérales au profit des pays d’Europe. Boeing en fut la principale victime au bénéfice d’Airbus Industries. Si, de 1990 à 1996, la Chine est passée du dixième au quatrième rang des partenaires économiques des États-Unis en doublant ses achats et en triplant ses ventes, le déficit de la balance commerciale américaine s’est accru rapidement. Il devrait atteindre 44 milliards de dollars en 1997. Clinton, réélu, conscient de l’inefficacité de la manière forte, décida de changer radicalement de méthode et de se lancer dans une politique dite « d’engagement stratégique constructif », finalement comparable à celle qu’il reproche aux pays de l’Ansea à l’égard de la Birmanie. Au sommet de l’Apec, à Subic Bay (Philippines), en novembre 1996, il fut enfin convenu que les deux présidents effectueraient chacun un voyage officiel. Le premier le serait par Jiang Zemin, le plus impatient. Clinton, moins pressé en raison de l’hostilité d’une partie de l’opinion publique et d’une majorité des membres du Congrès, empêtré dans une affaire de financement d’origine chinoise pour sa campagne électorale, ferait la visite retour.
Il reste 70 % de l'article à lire




_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)