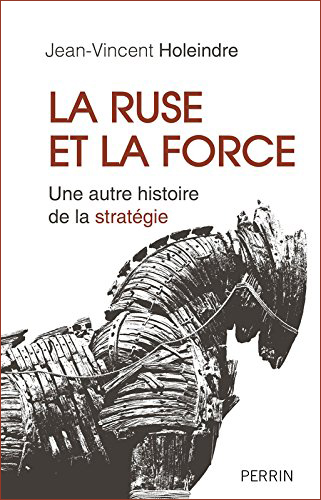
L’approche archétypale de la guerre nous est donnée par Homère à travers les deux personnages principaux de l’Iliade : Achille qui symbolise à la fois la force physique et les vertus morales (le sens de l’honneur) et Ulysse, polytropos (« l’homme aux mille ruses ») qui nous fournit le modèle du premier stratège, celui qui ne recherche pas la mort mais la victoire. Ce casting originel met en place les deux données essentielles de la démarche stratégique, la ruse et la force constituant les deux qualités du chef de guerre, reliées entre elles par la belle formule de Jean-François Lyotard : « la ruse est le point faible des forts ».
Dans ce livre, issu d’une thèse de doctorat en philosophie politique, dont le sujet fut inspiré par le livre de M. Détienne et J.-P. Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs (Flammarion, 1974), Jean-Vincent Holeindre, actuellement directeur scientifique de l’Irsem, nous montre comment, tout au long de l’histoire militaire, la ruse et la force furent complémentaires, en procédant à partir d’une approche généalogique basée sur des moments clés qui a vocation pour l’auteur à « redonner son épaisseur à la ruse ». La ruse de guerre est préalablement définie comme un procédé consistant à combiner la dissimulation et la tromperie en vue de créer la surprise, ce premier effet donnant naissance à un choc psychologique qui permettra la victoire.
Ce faisant, Holeindre rouvre le débat sur le livre de V. D. Hanson, Le modèle occidental de la guerre, lequel, comme on le sait, défend la thèse selon laquelle la supériorité militaire occidentale s’expliquerait par le lien civique (le modèle athénien) et par la bataille décisive (le choc hoplitique) considérée comme plus efficace. Pour Hanson, la ruse est le moyen des faibles qui refusent l’idéal du guerrier européen. Elle serait avant tout l’apanage des Orientaux. Pour Holeindre, ce modèle fait la part belle « à des préjugés culturels et ethniques » avec lesquels il conviendrait désormais de rompre.
Au début de son étude, Holeindre commence par montrer que la ruse est une catégorie majeure de l’univers mental des Grecs, un élément fondamental de leur intelligence de la guerre.
Les Romains, au contraire, à travers un discours de la guerre juste (la perfidie illicite rompt la fides, la bonne foi), s’approprient pleinement l’héritage d’Achille (la force représente pour eux la légitimité). L’ennemi emblématique (Hannibal), considéré comme perfide, contourne en effet le champ de bataille pour éviter l’affrontement direct. Cela montre que le dilemme ruse/force n’est pas seulement un enjeu stratégique mais aussi un enjeu normatif. Les deux registres, le registre stratégique et celui de la légitimité, se combinent ainsi pleinement chez les Romains. Le registre de la ruse ne sera toutefois pas négligé comme en témoignent les Stratagèmes de Frontin et les œuvres de Végèce, Xénophon en son temps ayant déjà fait le lien entre « stratégie » et « stratagème ».
L’étude se poursuit jusqu’à notre époque avec le terrorisme et la stratégie nucléaire, en passant par Machiavel (le célèbre chapitre 18 du Prince avec la métaphore du renard et du lion) et Clausewitz, dont le De la guerre comporte deux chapitres portant sur la ruse. Elle conclut que dans les guerres de masse, la ruse ne peut exister au niveau stratégique au sens où la massification de la guerre rend la ruse difficile à employer et qu’il y aurait en fait plus d’inconvénients que d’avantages à l’utiliser.
Au-delà de la thèse particulière soutenue par l’auteur, laquelle évacue un peu trop rapidement, à notre avis, l’apport conceptuel de Liddell Hart et de l’école de la stratégie indirecte, La ruse et la force peut parfaitement se lire comme une histoire alternative de la pensée stratégique, ce qui justifie pleinement son sous-titre.






