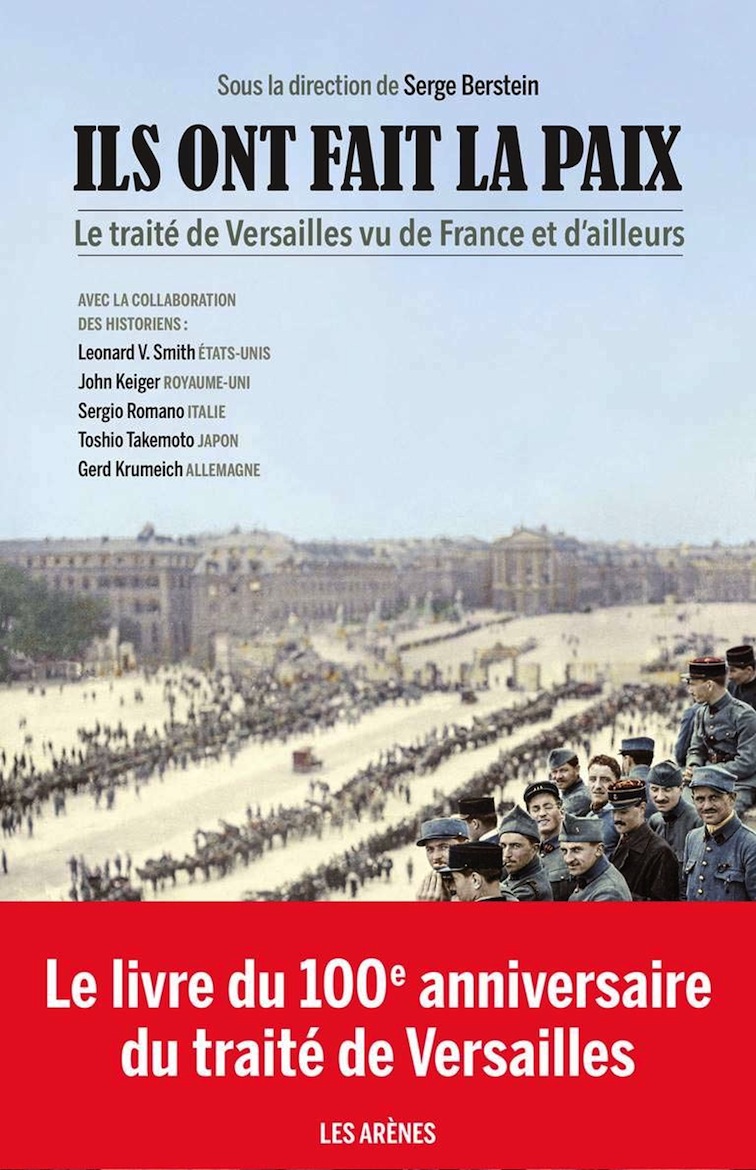
Cette œuvre collective d’historiens des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie, du Japon et de l’Allemagne frappe par sa clarté et sa largeur de vues. Ne manque donc que la Chine, qui a été associée aux travaux du Congrès de Versailles, et la Russie qui s’en est tenue à l’écart après la signature du Traité de Brest Litovsk du 3 mars 1918. Les auteurs exposent les motivations des principaux artisans du Traité de Versailles.
Les vues américaines, figuraient aux Quatorze points de Woodrow Wilson. Les revendications françaises, ont été exprimées avec force par Georges Clemenceau. Ce dernier assuma la présidence de l’essentiel de la Conférence de la Paix, laissant au Président américain celle de la Commission dédiée à l’organisation mondiale, la SDN, son enfant chéri. Les revendications italiennes, apparurent démesurées au regard du rôle que joua l’Italie dans le conflit, et ne pouvaient être que déçues, alimentant par la suite le courant fasciste. La Grande-Bretagne s’en tenait, quant à elle, à sa politique traditionnelle d’équilibre et de prise de distance par rapport aux affaires du continent, préoccupée qu’elle était par le maintien de son empire colonial sur lequel le soleil ne se couchait jamais, mais dont la lueur commençait à s’affaiblir. Le Japon, désirait être reconnu à sa juste place et mettait en avant l’égalité raciale, ce qui ne lui fut pas vraiment accordé d’où son glissement postérieur vers une attitude impérialiste. Quant à l’Allemagne, qui s’était effondrée durant l’été 1918, elle espérait être traitée avec ménagement, s’appuyant sur une interprétation littérale des Quatorze points et pensait que le « magnanime » Président américain l’épargnerait de la volonté de vengeance de la France.
Dès avant la fin des hostilités et au cours des mois précédant la signature du Traité de Versailles les positions des architectes d’un monde nouveau étaient fixées et donnèrent lieu à des joutes parfois animées, tenues en dehors de la presse, qui avait demandé à assister en témoin aux discussions mais en fut finalement écartée. Le Pacte de la Société des Nations, adopté le 28 juin 1919, visait, en instaurant un système de sécurité collective, à établir le gouvernement d’un monde nouveau. Mais dès sa naissance l’organisation qui se voulait mondiale apparut profondément déséquilibrée. Les États vaincus en furent d’emblée écartés, les États-Unis refusèrent de la rejoindre. L’URSS ne la rejoignit qu’en 1934, alors que le Japon la quitta avec fracas en 1931 à la suite de son intervention en Mandchourie. L’Allemagne nazie lui emboîta le pas en 1933, quelques mois après l’arrivée d’Hitler à la chancellerie.
Faire payer l’Allemagne et la mettre hors d’état de nuire, tels furent les objectifs poursuivis par la France, alors que la Grande-Bretagne cherchait à ne pas trop l’affaiblir pour contrebalancer la prépondérance française dont elle se méfiait toujours. L’éclatement de l’Empire austro-hongrois, l’effondrement de l’Empire ottoman laissèrent des vides qui ne furent comblés que par des régimes autoritaires, puis par le régime hitlérien. Alors que Woodrow Wilson entendait mettre fin – par étapes – à l’ère coloniale, celle-ci se perpétua sous la forme des mandats, sorte d’annexion déguisée. Par un jeu de circonstances inédites, les acteurs du Traité de Versailles quittèrent vite la scène politique, la tâche de l’appliquer revint à d’autres plus hostiles. Vittorio Emanuele Orlando qui, mécontent, avait quitté le 24 avril la Conférence de la Paix, fut renversé avant même la signature d’un traité jugé insuffisant pour l’Italie. Nitti, son successeur, accepta pourtant de signer le Traité de Saint-Germain en septembre 1919 qui accordait le Trentin, le Haut-Adige, et une partie de l’Istrie à l’Italie. Clemenceau se retira des affaires suite à son échec à la présidence de la République, le 16 janvier 1920. Wilson fut écarté de la course à la présidence de novembre 1920.
Le Traité de Versailles et surtout sa mise en œuvre, fut-il, en définitive un échec retentissant ? Il a surtout été victime de circonstances défavorables, d’une démission collective vis-à-vis d’un Hitler déterminé à le déchirer. « Pour la première fois, on a tenté de réaliser un ordre international fondé non sur la raison du plus fort, mais sur le droit et la justice » écrivent les auteurs. Louable intention. Ce fut assurément un espoir mais bien en avance sur son temps. Le Traité de Versailles devait être une création continue. L’évolution des relations internationales transposa les termes : ce fut une destruction continue. Voilà des décennies que les historiens s’interrogent. Paix bâclée ou trahie que celle de Versailles ? Jacques Bainville (1879-1936), dont Les conséquences politiques de la paix, rédigées à chaud, annonça avec vingt ans d’avance comment les erreurs de jugement des vainqueurs aboutiront à la Seconde Guerre mondiale. « Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur et trop dure pour ce qu’elle a de mou » estime : « La paix a conservé et resserré l’unité de l’État allemand. Voilà ce qu’elle a de doux. Cette concession essentielle n’aggrave pas seulement pour le désarmement, les difficultés de la surveillance. Nous répétons que la puissance politique engendre toutes les autres et un État de 60 millions d’hommes, le plus nombreux de l’Europe occidentale et centrale, possède dès maintenant cette puissance politique. Tôt ou tard l’Allemagne sera tentée d’en user. Elle y sera même poussée par les justes duretés que les Alliés ont mises dans les autres parties de l’acte de Versailles. Tout est disposé pour faire sentir à 60 millions d’Allemands qu’ils subissent en commun indivisiblement un sort pénible. Tout est disposé pour leur donner l’idée et la faculté de s’en affranchir et les entraves elles-mêmes serviront de stimulants. »
Les auteurs d’Ils ont fait la paix, s’inscrivent dans cette optique, en prenant hauteur et distance par rapport aux réactions et vives émotions des années 1920 et 1930. Maintenant que les derniers témoins de la Grande Guerre « la der des ders » ont disparu, que l’ordre mondial doit faire face à des défis d’une tout autre nature, les enseignements que l’on tire de cette époque ne semblent relever que de l’histoire. Ce n’est que partiellement vrai, car les grands acteurs du monde d’aujourd’hui, les bâtisseurs (ou destructeurs) de l’ordre mondial étaient présents à Versailles en 1919, à l’exception de la Chine qui n’a joué qu’un rôle subalterne, de la Russie et de l’Allemagne. Mais un siècle après 1918, ces mêmes États (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Japon, Italie), sont toujours ceux qui prétendent aux premiers rôles.






