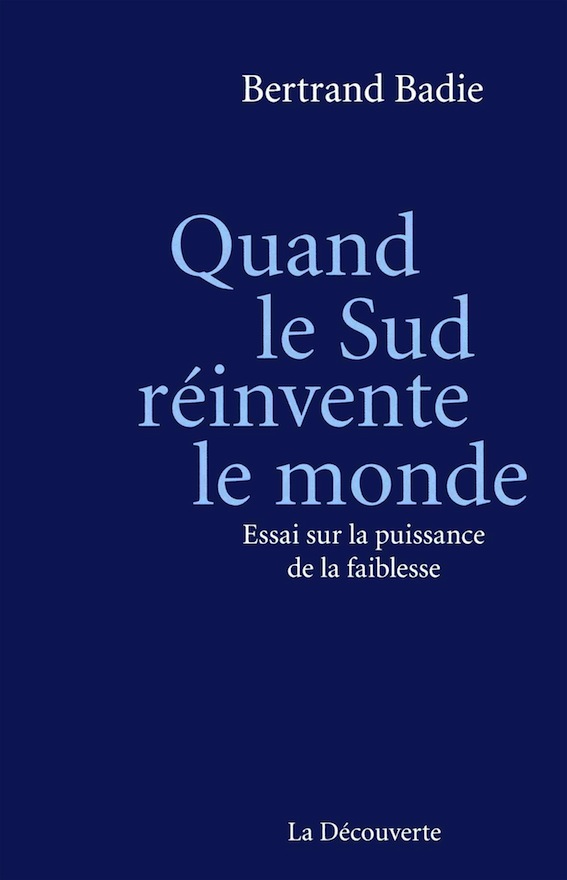
Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur d’une trentaine d’ouvrages, poursuit, avec talent et conviction, son analyse des fondements et ressorts de l’ordre mondial. Celui-ci bien que devenu un système universel est resté profondément inégalitaire, dominé qu’il est par les puissances traditionnelles.
Certes, la mondialisation, dans le sillage de la décolonisation a fait entrer les deux tiers de l’humanité dans le jeu international dont les peuples du Sud étaient jusque-là exclus. Ils ont essayé de s’y intégrer avec leurs cultures millénaires, leurs problèmes propres et leur mémoire faite d’humiliations récurrentes. Pourtant une juste place ne leur pas été ménagée, d’où les révoltes, les violences, les « insurrections » populaires d’un type nouveau qui se multiplient dans le monde. Loin d’être conjoncturelles et accidentelles, elles sont pour lui la face visible d’un monde dominé par les puissants. Car confrontées à ce système oligarchique confisqué par les vieilles puissances, les forces contestatrices ont utilisé les armes qu’elles possédaient, celles des faibles en jouant de leur mobilité, de leur dispersion, de leur insertion dans un tissu social déchiré, balkanisé. De plus la supériorité des armes, qui est restée longtemps l’apanage des pays du Nord, n’a pas mené à la victoire comme ce fut le cas à l’issue des guerres classiques.
La victoire politique n’a pas suivi la victoire militaire : la chute de Saddam Hussein, comme celle de Mouammar Kadhafi a été rapide, mais ce qui en a résulté s’est retourné contre le vainqueur comme ce fut déjà le cas au Vietnam, en Algérie, au Mali ou en Afghanistan. En effet dans le combat de la puissance contre la faiblesse, c’est la seconde qui sort vainqueur estime Bertrand Badie aux dépens de la première. L’une des raisons de cette dérive est due au fait que la décolonisation a été un échec car elle n’a pas mené à un monde unifié, et égalitaire. Dans leur hâte, les pouvoirs des pays nouvellement indépendants n’ont fait qu’importer le type d’État dont ils ont hérité de leur ancien colonisateur. Mais pouvait-il en être autrement ? Les élites politiques, d’Afrique ou à un moindre degré d’Asie se sont abreuvées des théories politiques et constitutionnelles européennes ou américaines. Elles ne pouvaient ou ne désiraient guère puiser dans le modèle des systèmes étatiques de l’époque précoloniale, aussi dignes qu’ils avaient pu être. Car pour elles, l’État dit importé était synonyme d’accès à la modernité, politique, économique et sociale.
Enfin, le recours à des coopérants et experts issus des anciens pays colonisateurs ne pouvait qu’aller dans le sens du transfert des méthodes des pays du Nord. Aussi les Constitutions des nouveaux États étaient-elles inspirées des modèles issus du droit constitutionnel européen. Il en est résulté déplore-t-il que les populations se sont senties aliénées, étrangères par rapport aux pouvoirs censés les gouverner. De proche en proche les faibles, c’est-à-dire toutes les forces hors « système » (mouvements terroristes, bandes criminelles, trafiquants de tous genres, guérillas recomposées…), se sont insérées dans l’intimité de leurs sociétés. Elles se sont inscrites non plus dans la logique de la rivalité de puissance, mais ont adopté la posture du faible au fort. La grande différence d’avec la théorie du « poisson dans l’eau », des guérillas classiques est que ces sociétés guerrières ne désirent nullement accéder aux commandes, mais vivre de déprédation, de pillages et de rançons. Le noyau central de cette nouvelle forme de conflictualité est formé du seigneur de la guerre, maître des milices qui étend ses réseaux plus ou moins clandestins, crée une économie parallèle de plus en plus puissante, instaure un semblant d’ordre, de sécurité, distribue prébendes et emplois.
Bertrand Badie passe au crible la revanche de ces entrepreneurs de guerre qui savent capter à leur profit les allégeances déçues ou dispersées, les identités déstabilisées, les fonctions politiques inaccomplies. Ces milices ne datent d’ailleurs pas d’aujourd’hui comme l’atteste le mouvement des Maï-Maï au Kenya au cours des années 1950. Dans le modèle clausewitzien le but de la guerre était de terrasser l’ennemi, souvent à l’issue de la « bataille décisive ». Mais aujourd’hui l’adversaire paraît fragmenté, disséminé et instable, quand on parvient encore à l’identifier. Tel est le cas de Boko Haram, ou la contre-socialisation violente sur lequel il s’étend. Souvent ces mouvements se situent au carrefour du militantisme politique et de la simple criminalité, cas du mouvement pour la survie du peuple ogoni (MOSOP) qui s’est constitué au Nigeria en 1990.
Peut-on le suivre pour autant lorsqu’il estime que ces convulsions, qui au total n’occupent que des espaces somme tout réduits ou délaissés, vont conduire à une réorganisation profonde du système international ? Peut-être même à la rupture la plus substantielle que le système westphalien ait eu à affronter depuis sa création en 1648. Bertrand Badie en est persuadé et insiste sur l’urgence de définir un nouveau multilatéralisme. Celui-ci ne doit plus se borner à aménager les rapports entre États, les briques traditionnelles de l’ordre mondial. Il doit se donner pour objectif d’aboutir à une véritable intégration sociale internationale, l’injustice sociale étant devenue la cause principale des guerres. Le diplomate ou le soldat, chers à Aron doivent se muer en sociologues, sinon en psychosociologues. Le politico-militaire de jadis conclut-il, se jouait dans un temps court (ce fut le cas, en 1870, mais qu’en fut-il de 1914-1918, de 1939-1945 !), alors que les forces nouvelles d’intersociabilité ne s’accomplissent que dans la durée, celle de la restructuration des ordres sociaux et de la transformation des imaginaires. La guerre est un caméléon avait déjà écrit Clausewitz, le mérite de Bertrand Badie est d’en avoir décrit avec brio et profondeur bien des contours et d’ouvrir des pistes nouvelles d’analyse, qui devraient s’avérer fécondes.






